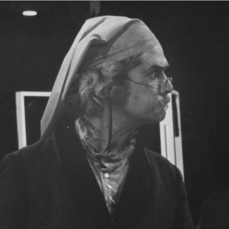Entrer dans le texte
Ni « out », ni « in », Jean-Luc Lagarce appartient à la génération du « off ». II vient après. Nombreux sont les cinquantenaires d'aujourd'hui qui pourraient en témoigner : pour les jeunes gens de cette génération-là cela s'est joué à quelques années. On connait Musset et son « enfant du siècle » : « Derrière eux, le passé..., devant eux, l'aurore d'un immense horizon, et entre ces deux mondes quelque chose de semblable à l’Océan qui sépare le vieux continent de la jeune Amérique, je ne sais quoi de vague et de flottant... » Être « mal tombé », venir trop tôt ou trop tard, entre-deux. II faut nager. Cinq ou six ans suffisent. Ainsi naître en 1957, dans le dernier remous des baby boomers », n'est déjà plus comme naitre en 1950.
1945 : génération d’Ariane Mnouchkine, Jean-Pierre Vincent, Patrice Chéreau — ils ont vingt ans ou plus en 68 : en 1967, le jeune Théâtre du Soleil présente La Cuisine de Arnold Wesker à Medrano (63 400 spectateurs). 1957 : quand ceux-là arrivent en âge de créer, le terrain est pris. En 1978, Jean-Luc Lagarce crée « Ia Roulotte » du nom de la première troupe fondée par Jean Vilar. Le nom, dans sa modestie, est tout un programme. A la même époque, en Avignon », on envahit les garages — Ia cour d'Honneur est occupée par des grands (frères) déjà consacrés.
Génération du « off ». De l'entre-deux : rejetant, comme leurs aînés, l'Institution ; portés par l'esprit de 68 ; mais à l'écart des nouveaux lieux où se fixe déjà le nouveau théâtre (la Cartoucherie, les scènes de Ia décentralisation). « Off » donc. Pas « out », pas « in ». Ce non-lieu, la force de Jean-Luc Lagarce est d'y élire domicile. Telle est la Roulotte. Sa destination est le voyage ; son but habiter ce vide. Le théâtre est une entreprise nomade funambule, suspendue entre ciel et terre, c'est-à-dire entre subventions et « petits boulots ». A l'utopie du collectif (celle du Soleil, du Campagnol...), Jean-Luc Lagarce substitue, comme d'autres de ses camarades de l'époque, l'utopie du singulier. Elle demande plus que du courage.
Utopie du singulier. Elle est d'abord dans l'écriture — dans laquelle on tombe comme dans la nuit ; l'écriture est un travail solitaire — et cette solitude est en même temps un choix : qui fait résistance, nargue, provoque ; l'artiste s'affiche très vite comme un « solitaire intempestif ». On la retrouve, deuxièmement, dans l'aventure de la Roulotte, qui n'est pas un phalanstère mais une histoire de rencontres et d'amitié, un « nuage » comme la troupe dont Nous, les héros nous en renvoie l'image amusée. S'il y a une « situation » de Jean-Luc Lagarce, celle-ci s'ordonne autour d'un concept, l'inexistence, et d’une question : "Comment exister l'inexistence ?"
On n’est pas loin d'Hamlet, dont Ia figure hante son écriture : comment être (plutôt que « ne pas être » ? ) comment devenir ce que I’on est ? remettre le temps sur ses gonds » ? Comment ne plus être de trop » ? A ceci près qu'ici la question emporte une exigence de plus (Hamlet, en réalité, ne découvre pas autre chose) c'est qu'il faut échapper à l'inexistence sans nier la fibre qui Ia constitue, et donc en la conservant. Exister, par conséquent, sa vie sans Ia changer, sans la « remplir », sans rien offusquer de la solitude initiale, du vide constitutif. Cela vent dire concrètement : se faire reconnaître sans se croire arrivé, faire quelque chose de soi sans devenir quelqu'un.
L'utopie du singulier commande ainsi tout ensemble une écriture et une éthique. C'est celle de la fraternité, de la modestie, celle de ('humour ne pas se prendre au sérieux, ramener la vie à un jeu avec ses loteries, son cabotinage, ne pas y croire, ne pas s'y croire, ne pas « se la jouer ». Être responsable aussi, comme quelqu'un qui sait « se tenir à sa place » avec et au milieu des autres. Quant à l'écriture, elle doit être comme la toile de Pénélope, se défaisant à mesure qu'elle se tisse, se détissant à mesure qu'elle s'entoile. Une forme « métamorphique », se contestant elle-même, suspendue entre ensemencement et décomposition, entre « donne et autre donne », occupant le milieu entre le silence (où il n'y a rien) et le cri (où il y a tout).
Le « retrait » donc, l'effacement, l'humour - politesse du désespoir : le signe fait sens en « faisant signe » comme un signal (d'alerte, de détresse), le discours est un fanal dans la brume, l’action une succession de minutes (le mot vient du latin minus) - des mi-lieux sans début ni fin, des instants sans bords, suspendus dans le non-lieu de la mémoire, dont ce caractère (...) s'impose comme étant l'emblème. Suspension, épochè, ces morceaux de souvenir ne doivent pas nous faire oublier le continent qui manque, le fleuve d'oubli qui les baigne, l'inexistence dont ils s'extraient, tout dégouttant de nuit, suspendus sur le fil de la pensée. Funambules de l'être.
L’Épilogue ou comment sortir de soi en restant en soi ?
" Épilogue
Louis – « Après, ce que je fais,
je pars. Je ne reviens plus jamais. Je meurs quelques mois plus tard,
une année tout au plus.
Une chose dont je me souviens et que Je raconte encore (après j’en aurai fini) :
c'est l’été… (…) c'est pendant ces années où je suis absent, c'est dans le sud de la France.
Parce que je me suis perdu, la nuit dans la montagne, je décide de marcher le long de la voie ferrée.
Elle m'évitera les méandres de la route, le chemin sera plus court et je sais qu'elle passe près de la maison où je vis.
La nuit aucun train n'y circule, je ne risque rien et c'est ainsi que je me retrouverai.
À un moment, je suis à I'entrée d'un viaduc immense. Il domine la vallée que je devine sous la lune,
et je marche seul dans la nuit,
à égale distance du ciel et de la terre.
Ce que je pense
(et c’est cela que je voulais dire)
c'est que je devrais pousser un grand et beau cri,
un long et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée, que c’est ce bonheur-là que je devrais m’offrir,
hurler une bonne fois, mais je ne le fais pas, je ne l’ai pas fait ».
Je me remets en route avec seul le bruit de mes pas sur le gravier.
Ce sont des oublis comme celui-là que je regretterai. "
Comment sortir de soi en restant en soi ? Comment « l'ouvrir » ? Louis, à ce moment pourrait le faire : suspendu entre ciel et terre, il est comme un oiseau. Personne ne le voit. II domine le monde endormi. Pourquoi ne hurle-t-il pas ? Quelle pudeur, quelle frayeur le retiennent ? Euphémei ordonnent les héros grecs quand ils commandent qu'on se taise. Euphémei, c'est tout ensemble « parle-bien » et « tais-toi » ; c'est le silence commandé quand la parole serait trop criante, trop vulgaire. Impudique, blessante, laide. Le monologue de Louis nous met sur les rails de cette « parole viaduc » ce qu'il y a au cœur des mots, ce n'est pas ce qu'ils disent (Louis ne révélera pas son secret), c'est leur silence ou plutôt ce « hurlement » qu'ils passent sous silence. C'est ce pont qui va de rien à très peu – « seul le bruit de mes pas sur les graviers » – en enjambant des gouffres. Euphémisme. D'où l'énigme posée à l'interprète comme au nageur de fond : comment « détendre » cet air comprime sans déchirer le sac des phrases (des poumons), comment faire entendre le hurlement que le silence « contient » ? Se souvenir de cet « oubli » ? Comment exister l'inexistence ?
Mise en jeu et en voix : Exercice de chronométrage
La « parole viaduc »
Dire cette page ('Épilogue, page 10). Chronométrer le temps qu'il faut pour dire cette page. Deux minutes, cinq minutes. Comparer les temps. La dire vite. La dire lentement. Puis de plus en plus vite. Repérer quand l'accélération est impossible.
Ce texte nous apparait dans sa définition contradictoire :
- une seule et longue phrase, qui doit donc être émise d'un seul souffle et en une seule poussée du ventre ;
- de brusque solutions de continuité, qui faillent la longue phrase en une ligne pointillée.
Problème : combien durent les silences entre chaque segment ? Quel sort réserver aux points, aux virgules ? Faut-il baisser la voix sur les points, la maintenir sur les virgules ? Mais que faire alors des points quand ils sont à l'intérieur des vers, et des virgules quand elles sont à l'enjambement ?
Points, virgules — on notera leur variété :
- points et virgules à l'intérieur des vers,
- points et virgules en fin de vers, le passage offre quatre accidents rythmiques. C'est tout. II n'y a pas d'autres pulsations rythmiques. II n'y a pas, comme chez Claudel, de ces furieux conflits entre la syntaxe et la prosodie :
« Par ces cheveux
Splendides, imprégnés par l'aurore... » ;
- le poème, chez Lagarce, découle du parler ; l'enjambement se produit aux jointures naturelles de la syntaxe. Le poétique est dans cette parole qui se pose.
Qui se pose d'abord dans une accentuation particulière du rythme du parler qui produit comme une aggravation de la parole ordinaire : les mots retentissent soudain autrement ; ils deviennent graves. Cette accentuation du rythme, marquée par un agrandissement du silence, immédiatement compensée par l'impulsion qui lui succède, engendre une théâtralisation naturelle de l'acte de parole. Dans les deux cas, il s'agit de rythme et, pour trouver ce rythme, le problème est d'avoir à chaque instant conscience de ce qui se passe dans ce qu'on dit.
Comment régler le débit ? L'exercice exige, en d'autres termes, de l'interprète qu'il change ses habitudes de parler : il ne parle plus seulement pour dire ce qu'il a dans la tête ou sur le cœur (selon l'approche psychologique habituelle), il s'étonne de ce qu'il dit à mesure qu'il le profère, il fouille de tous ses yeux l'espace que les mots ouvrent devant lui : cette sensation physique fusionne ici tout naturellement dans l'image du moi funambule. L'acteur est un acrobate diseur de mots. On passe de la logique de l'expression (qu'est-ce que je veux dire ? quel est mon sentiment ?) à la dynamique de la performance (aural-je la force d'aller au bout de mon fil ? aurai-je la force de « l'ouvrir » ?).
« À un moment, je suis à l'entrée d'un viaduc immense,
il domine la vallée, que je devine sous la lune... »
Le ressort du rythme est certainement dans la vision : il faut « se faire voyant », il faut voir le viaduc qui s'ouvre dans la nuit, sentir la fraîcheur de l’été, imaginer l'apesanteur du vide, les petites lumières de la vallée — et injecter ces images mentales au fur et à mesure qu'elles se détachent des mots qui les déclenchent (ni avant, ni après) à l'intérieur de la diction.
Mentaliser le texte, développer les images comme on développe une photo. II y faut du temps : ce temps donne le tempo — l'exacte mesure de la quantité de silence nécessaire. Le diseur a dans sa tête l'instrument pour régler son débit. Quand il s'arrête entre deux segments, sa pensée en travail, le diseur-funambule ne perd pas le fil. II fond le pointille en une longue phrase émise d’une seule poussée du ventre. II est sur la « parole viaduc ». Existant son inexistence.
Quand faut-il fermer sa phrase ?
Le travail peut s'appuyer sur cette leçon de Jouvet. Louis Jouvet, classe du 24 avril 1940, a Viviane : « Dans la vie, quand tu parles, tu ne mets pas de points, tu continues ton discours. Tu expliques ce que tu as à expliquer et tu passes d'une phrase à l'autre sans arrêt. C'est la même chose au théâtre. Dès que tu fermes tes phrases, dès que tu mets des points, tu arrêtes le mouvement. II ne faut fermer la phrase que pour une affirmation importante, que lorsque quelque chose est fini. » Tragédie classique et théâtre au XXème siècle, Gallimard, 1968, p. 118.
Distinguo théorique
De ce travail sur le débit de la phrase, on peut tirer deux concepts :
- Concept n° 1 : dire n'est plus interpréter. L'objet (le sens) ne préexiste pas à la diction ; il en est le résultat. Cela ne veut pas dire qu'il faille cesser d'analyser les textes (que faisons-nous ici d'autre qu'analyser ?) ; mais que le travail d'analyse a pour fonction de délimiter le cadre de l'expérience qui le suit : ce n'est pas elle qui trouve - elle fixe ce qu'on cherche pour qu'on puisse le trouver (on ne trouve que ce qu'on cherche). À charge ensuite pour le diseur d'accomplir ce travail de profération-mentalisation du texte et de transformer cette diction en une véritable performance s'effectuant devant nous.
- Concept n° 2 : « trouver le ton » n'est plus « mettre le ton ». La notion grecque, étymologique, du tonos : tension, se substitue au concept psychologique. Le travail laisse de côté le personnage et se concentre d'abord sur Ia profération matérielle du texte (ici son chronométrage). Tonos : le problème est de trouver le niveau de «tension » à partir duquel les différents segments s'électrisent — et où le texte « prend. L'opération s'effectue à son niveau, qui n’est pas psychologique : elle crée dans l'interprète une disposition mentale qui entraine à sa suite des émotions. Mais le sentiment, encore une fois, n'est pas posé en premier comme une donnée bien établie que l'interprète devrait viser ; il arrive à Ia fin. Comme une grâce, ou un « supplément d’âme », en fonction de Ia sensibilité de chacun.