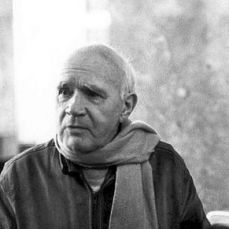- Edward Bond, « La Raison d’être du théâtre » in La Trame cachée, op. cit., p. 197.
- Edward Bond, « Notes sur Café », in La Trame cachée, op. cit., p. 258.
- Edward Bond, « Notes sur le Théâtre en milieu scolaire », in La Trame cachée, op. cit p. 94.
- Vassili Grossman, Vie et Destin, 1960, Pocket, coll. Pocket Blanche, 1984, p. 382 sqq.
Edward Bond a la particularité d’être l’un des seuls grands auteurs contemporains de théâtre à avoir écrit un répertoire spécifique pour la pratique du théâtre à l’école. C’est que les deux mots sont pour lui synonymes : « L’œuvre dramatique, qu’elle soit tragique ou comique, a deux finalités : “connais-toi toi-même” et “deviens toi-même” 1. » Le théâtre n’a pas à produire des modèles de savoir mais la vie, ou à défaut ses exemples : « Tout ce que nous pouvons faire c’est chercher à nous connaître nous-mêmes. L’œuvre dramatique nous aide à le faire quand elle traite de l’extrême, car c’est là qu’on trouve les questions qui nous définissent 2. »
Le théâtre s’offre ainsi comme le lieu – ou, en terme plus bondien, le site – de la formation de soi. Le théâtre en effet chez Bond n’est pas seulement un outil de cette recherche de l’humain, de cet idéal d’un homme qui redécouvre son humanité, il en est l’instrument principal, redonnant ainsi toute sa place à l’imagination dans le processus éducatif : « Le théâtre est le lieu où la réalité est rendue possible. Les pièces que les jeunes gens écrivent, interprètent et regardent sont les épures du monde où il leur faudra vivre 3. » Cette double affirmation de l’alchimie créatrice de la scène est le cœur du « bondisme », comme programme et révélation profonde : Fabriquer du possible – c’est-à-dire le monde –, dans le futur et par le moteur de l’imagination, dans la dynamique d’une jeunesse qui se décline et se retrouve alternativement et identiquement dans l’écriture, l’interprétation et le regard. Le théâtre, en avance d’un geste et d’un temps, imité par le monde. Nul doute qu’un tel programme, qui semble d’emblée inscrit dans l’espace symbolique et pragmatique constitutif du théâtre, peut être une menace comme une promesse – une expérience, dont tout est à attendre.
Aussi, plus que toute autre œuvre théâtrale, ou autant qu’une autre, mais avec une conscience suraiguë de cette nécessité, l’œuvre de Bond demande, pour être comprise, à être jouée : comprendre et jouer sont, simultanément, les deux traductions intimes d’une même histoire. La logique augustinienne de la foi tient dans cette formule paradoxale : « Crois pour comprendre. » La conscience théâtrale d’Edward Bond pourrait être de même facture, sinon de même esprit : « Joue pour comprendre. »
Une expérience théâtrale paroxystique et paradoxale
Les Pièces de guerre prennent comme point de départ, ou comme horizon, l’anéantissement nucléaire. Ce lieu est effectivement le nôtre : « Nous sommes tous – même ceux qui sont nés plus tard – des survivants de Babi Yar et d’Auschwitz et d’Hiroshima » écrit Edward Bond. Que faire, que dire après la catastrophe ? Et faut-il encore écrire, ou pire : jouer ? Cette question, qui anime depuis quelques décennies la critique philosophique, et surtout qui lancine et harcèle la création esthétique, qui poursuit, Érinye sans âge, l’artiste, et lui fabrique sa mauvaise conscience – cette permission non encore donnée de produire malgré tout de la beauté –, nous la connaissons bien.
Mais le mal vient de plus loin. Et les réponses ? Sans âge, elles aussi, et adéquates seulement lorsqu’elles prennent justement la forme de l’œuvre d’art. Depuis Les Perses d’Eschyle, plus précisément depuis la presque première des tragédies de guerre, lorsqu’il s’est agi de représenter les perdants, la plainte, et de réfléchir sur la défaite et l’horreur des vaincus, plus que sur les triomphes des vainqueurs. Vis-à-vis exigeant, exposition douloureuse, et parfois au-delà du supportable : c’est l’expérience que fit Phrynichos, un autre tragique, qui vingt ans avant Les Perses, voulut porter sur scène un désastre intime, La prise de Milet par les Perses et qui fut condamné par les Athéniens à verser une amende colossale pour avoir ravivé le souvenir d'une calamité nationale. Les répliques culturelles aux séismes de la guerre et le retour de la question de confiance posée à l’homme, nous les avons toujours sentis, au théâtre, après les guerres de religion, après les luttes de la Révolution, après les guerres napoléoniennes, après celles aussi du XXè siècle.
Réfléchir sur la catastrophe est donc un acte éminemment théâtral, un acte d’écriture aussi. Mais cette fois, l’écriture et le théâtre ne sont plus aux prises avec une catastrophe de plus : ils doivent, selon Bond, affronter quelque chose d’absolu, d’absolument radical. Dès lors, l’expérience théâtrale proposée au spectateur est à la fois paroxystique et paradoxale : paroxystique, parce qu’elle doit incendier la scène tout en évitant les effets spectaculaires, parce qu’elle ne peut que la dé-théâtraliser en plongeant le spectateur, pour un moment et par le discours, en état de choc, avant que ne s’exerce dans cette tragédie sans cartharsis ni distanciation brechtienne son jugement critique. Ni Büchner, ni Kantor. Sans jamais directement représenter la guerre dans sa réalité militaire — nous sommes toujours après, ou à côté des affrontements guerriers —, Bond nous donne à éprouver plutôt un état de guerre permanent, révélateur des failles de notre propre société et de la perte du lien social. Un état, plutôt qu’une action. Le théâtre mis en état de siège par la guerre. Là est le propre de ce grand théâtre de texte : c’est le discours qui peine à mettre en ordre le chaos perçu et subi, c’est lui qui doit représenter le fait que l’état de guerre est excès, débordement, défi à la rationalisation – outrance et outrage faits à une éthique plus ou moins implicite.
Plutôt que de produire des images frappantes – et se distinguant ainsi d’un autre théâtre de la catastrophe qui cherche à la prendre sur le fait et dans l’action, dans sa performance même, quitte à alimenter parfois une certaine fascination morbide plus qu’une réflexion ou un jugement impérieux –, le théâtre d’Edward Bond s’affirme paradoxalement, comme l’auteur lui-même, littéraire et théâtral, mais aussi « incurablement optimiste ». Les Pièces de guerre, en dépit de leur radicalité et de leurs choix narratifs et thématiques peuvent aussi être lues comme une œuvre classique, qui donne toute sa place au discours, à l’état de guerre, au temps indéfini, à l’espace improbable. Dans un « champ d’après la bataille à volonté » – comme l’on dit pour Racine « un palais à volonté » –, dans les « paysages dévastés » des entités se parlent, se pensent, mais s’adressent bien plus à ce qui s’est passé qu’à eux-mêmes, pour savoir ce qu’il est encore possible de faire, lorsque la pièce de guerre sera accomplie. C’est donc durant toute la pièce comme à la toute fin du spectacle que le spectateur peut, avec tout ce temps que Bond lui prête, penser l’accomplissement, réfléchir à ce « tout est accompli » contemporain, peut-être pour qu’en fin tout advienne. Et durant tout ce temps de crise, temps étal et temps d’urgence, les questions majeures qui occupent l’homme social, et les problèmes fondamentaux qui occupent l’humain, sont posés.
Shoah, bombe atomique, désastres de l’humain mènent alors aussi bien à un futur peut-être possible qu’à différents passés considérés comme fondateurs : le sacrifice selon Bond et selon saint Matthieu, bien sûr, le « tout est accompli » jeté sur la scène du crime, sur ce sombre Golgotha sans Christ, mais aussi, encore en amont, la présence d’une humanité saisie par l’hybris ou prise au piège de la faute tragique, et qui, pourtant, se tient debout. Mais qu’on ne s’y trompe pas, Bond n’imite ni Sophocle, ni Eschyle, et il est bien loin d’Euripide : « Ce n’est pas pour imiter les Grecs, dit-il – mais Athènes a posé les problèmes fondamentaux de l’humanité et maintenant le théâtre retourne vers eux. » Bond n’imite pas, il prend ce qu’il y a de plus profond, et de plus radical, il agit par son discours, en auteur soucieux de la scène, et pose là, face au public, sur l’avant-scène de la cité, les questions de l’humain, de l’inhumain, du juste et de l’injuste, celles qui sont au cœur du théâtre bondien comme au centre du théâtre grec. Car imiter une réponse, composer un chant avec variation savante et hommage de l’artiste à son modèle sont une option diamétralement à l’opposé de la vocation d’un théâtre qui n’invente pas ses questions - bien sûr elles sont obstinément et violemment là - mais tâche de fabriquer une réplique forte, une riposte à l’horreur qui soit un peu à la hauteur de cet événement qui dure - un contre-courant, un contre poison.
Et toujours, Edward Bond vise le centre afin de concentrer les états, les paroles et les situations pour qu’ils soient infiniment disponibles au spectateur et qu’ils entrent, pratiquement (sur la scène), littéralement (par les mots mêmes), et littérairement (selon les effets stylistiques) dans son point de vue. Si bien que la fulgurance de l’empathie, l’accès, même fugitif, à ce que l’autre en lui peut porter de moi-même, et moi-même de l’autre, installe une sorte de forme tragique : cette forme pauvre et vagabonde de la « bonté folle » des hommes, hors de tout lien religieux ou social, vive même dans les temps terribles, qui désespère, puis refonde la polyphonie du théâtre à sa source. Vassili Grossman la définissait ainsi, dans Vie et Destin : « Elle est, cette bonté folle, ce qu’il y a d’humain en l’homme, elle est ce qui définit l’homme, elle est le point le plus haut qu’ait atteint l’esprit humain. La vie n’est pas le mal nous dit-elle 4. » C’est ainsi que, d’une perspective tragique, instruite à la fois par la faute antique et par toutes les fautes modernes, nous sommes entraînés, par le texte, la scène et toute cette empathie qu’elles produisent, à nous tourner vers la vie. Les plus terribles des désastres ont donc une fin, qui est l’homme.
C’est pourquoi Bond doit être lu, compris, joué, et même étudié, parce qu’il pose de manière moderne et puissamment scénique, les questions d’aujourd’hui avec des réponses de demain. Non pas les questions anecdotiques du temps présent, mais celles qui nous importent et qui importent à ceux qui nous suivent.