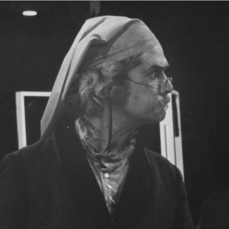a) Dans ce chapitre d’ouverture, La Bruyère apparaît en tant que lecteur critique (cf. 56). Ce chapitre, souvent sérieux, est destiné à nous donner, à nous, lecteurs, les critères d’appréciation pour juger de la valeur de cet autre ouvrage de l’esprit que sont « Les Caractères ». Or, ce que nous voyons, c’est que les critères esthétiques sont inséparables des critères éthiques à l’œuvre dans l’analyse des caractères : tout choix stylistique a des implications morales, et tout comportement se traduit par un langage qu’il appartient au lecteur - critique - d’analyser : être sensible à un défaut de de justesse, à une faute de goût, c’est la première qualité du bon lecteur.
Il y a donc un critère tout-puissant, c’est la bienséance, c’est-à-dire la convenance : c’est, par rapport à l’ineptie de la réaction automatique du sot, l’adaptation du comportement et du langage aux circonstances.
Quel est le critère de cette convenance ? c’est la nature : dans la conversation comme dans l’art, c’est sur elle qu’il faut se régler, une nature définie comme simplicité sans apprêt et bonté. Aussi n’y a-t-il qu’un bon goût et un seul (10), au nom duquel il faut bannir l’emphase et l’enflure (cf. 7, 8, 13), et rechercher au contraire le mot juste : c’est là le but décisif : « penser et parler juste (2) ; trouver la « bonne expression », qui sera la seule bonne (17)
b) Mais la réalité n’est pas si simple ni la réalisation si facile. Et La Bruyère se pose la question de savoir ce qui produit le plus d’effet sur le lecteur ; il s’aperçoit qu’il y a une justesse d’expression commandée par la raison, mais qu’il y a aussi un art de s’adresser à la sensibilité, ce qui entraîne toute une série de remarques qui tendent finalement à distinguer trois catégories :
- L’absence de naturel et de simplicité, l’enflure, qu’il condamne absolument.
- La langue juste d’un ouvrage « parfait ou régulier », mais qui souvent justement laisse froid (7, 18, et 30, où il constate avec surprise que le plus grand chef d’œuvre dramatique, Le Cid, a été aussi celui qu’on a justement le plus critiqué. La Bruyère met à jour le problème réel du style comme celui de la valeur d’une œuvre : la convenance ne suffit pas, au contraire il faut de temps en temps des irrégularités ; l’écrivain réagit avec le langage comme avec ses « caractères » : ce qui l’intéresse, c’est l’irrégularité, l’excès, le frappant, et en même temps, c’est ce qu’il condamne au nom de l’expression juste !
Donc une contradiction entre le désir d’être conforme au « goût », et le désir d’impressionner par la nouveauté (cf. l’opposition en 38 entre le style froid et élégant de Térence, et le feu accompagné de jargon et de barbarisme chez Molière) Voir aussi la réflexion 61
- La catégorie qui lui permet de conceptualiser cette tension entre justesse et innovation percutante, c’est celle de sublime ; Boileau aussi réfléchissait sur la question dans sa traduction du Traité du Sublime : chez les Anciens, il s’agissait d’une typologie des genres (classer les genres par rapport au sublime : il y a des genres plus sublimes que d’autres, comme la tragédie par exemple) Mais les classiques étendent le concept en se demandant (ce sera aussi le problème de Balzac, ou Hugo, et même de tout le romantisme) si le sublime peut appartenir à n’importe quel genre. Et il est évident que La Bruyère qui fait de la satire revendique la possibilité d’atteindre au sublime cf. 65 : pas de « grands sujets » (réservés à la tragédie ou à l’épopée) mais des « petites choses relevées par la beauté du génie et du style ».
Le sublime, c’est d’abord un concept qui appartient à une rhétorique de l’effet : c’est ce qui élève le lecteur (cf. étymologie du mot) (voir 31). Or cet effet, c’est finalement la seule règle à respecter, et c’est ce qui prouve la maîtrise du créateur. Voilà pourquoi Corneille, malgré tant de négligences montre son génie (54). Et donc quelquefois le sublime est le contraire de l’art (61 : « ils sortent de l’art pour l’ennoblir, s’écartent des règles si elles ne conduisent pas au grand et au sublime). Ainsi le sublime, c’est la vérité saisie dans sa meilleure expression linguistique ; or pour La Bruyère ce qu’il s’agit de révéler c’est le vrai : les œuvres ne doivent pas se contenter de plaire.
C’est ce qui explique que La Bruyère ne demande pas une simple reconnaissance esthétique de son œuvre, ce serait confondre fins et moyens (57, où il montre qu’un ouvrage est sans intérêt s’il n’apprend rien, et que l’on écrit que pour exprimer « des pensées nobles qui renferment un très beau sens ») Quant au lecteur il ne doit pas se limiter à apprécier « la finesse du tour », ce n’est là que le moyen pour conduire au vrai. Et ce « beau qui conduit au vrai doit se tenir aussi bien en dehors de la froideur, du laconisme (29) contrefaçon du sublime, profondeur illusoire, que de l’enflure de l’asianisme (on oppose la sobriété de l’atticisme à l’enflure de l’asianisme).
Il faut noter pour finir les allusions à la querelle des Anciens et des Modernes. En 15, il y a une défense des Anciens, qu’on ne saurait surpasser, sinon en les imitant, ce qui explique l’apparente contradiction entre « Tout est dit… » et « Je l’ai dit comme mien » : deux façons de justifier l’écrivain qui à la fois peut « glaner » c’est-à-dire ramasser ce qui a été laissé après la moisson des Anciens (justification des fragments) et imiter (donc ici les Caractères de Théophraste) : la seule façon de surpasser les Anciens, c’est de reprendre les mêmes sujets, les mêmes formes mais dans un style personnel ; donc pas d’originalité sinon stylistique (ce qui aboutira à une réelle originalité).