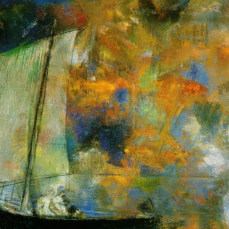Ce court chapitre évoque certains aspects de la vie à Paris (il y a des noms de quartiers, on y voit la Seine, les Tuileries…), et il est logique, dans la mesure où La Bruyère s’en est pris dans le chapitre précédent aux nouveaux riches, qui imitent la noblesse de la Cour, qu’il s’en prenne ici aux riches bourgeois de la ville. On retrouve ici cette même répugnance à accepter la mobilité sociale (le dernier fragment 22 est un modèle de l’idéologie conservatrice). Ce qui frappe l’écrivain, c’est d’abord le caractère vide d’une vie faite pour la parade. Parade d’autant plus ridicule que chacun essaye d’imiter celui qu’il n’est pas. Les femmes elles non plus ne sont pas épargnées pour un comportement identique. Et pour finir son chapitre, La Bruyère oppose l'âge d’or champêtre et frustre au luxe insolent des bourgeois.
Une vie superficielle bâtie sur la parade
Le fragment 1 dit clairement que le but d’une rencontre n’est pas la conversation (à l’inverse de ce qui se passe à la Cour) mais la vue : on se voit pour se jauger : a-t-il plus ou moins que moi ? son « équipage » (très important dans tout le chapitre) est-il supérieur au mien ?
On se parle sans rien se dire : on est « sur le théâtre » (3), car il faut parler non pour celui qui écoute mais pour les passants. Et La bruyère de dénoncer ces contacts qui n’en sont pas.
Même absence de sociabilité chez Narcisse (cf. texte expliqué) ou encore dans le fragment 20 où est décrite une suite de mouvements qui s’annulent « : on entre que pour sortir, et on ne sort que pour rentrer, et voilà comme on perd son temps. Tout est fait pour la parade cf. 9 (les six chevaux de l’équipage) ou bien en 6 (au lieu de rêver dans son carrosse, il faut faire comme si on était un homme très occupé, pour le faire savoir…).
La ville est donc « le théâtre de la vanité » (11), théâtre limité à un quartier du reste, (donc fausse notoriété) et vanité consistant à se ruiner !
Deux éléments antithétiques
Dans cette vie superficielle on observe un cloisonnement étanches entre les différentes classes ou coteries (4), ou groupement qui peuvent être aussi sectaires qu’éphémères (cf. la « petite Robe » et la « grande Robe ». Mais paradoxalement, chacun n’a qu’un rêve, c’est d’appartenir à la classe à laquelle il n’appartient pas. Chacun passe son temps à imiter celui qu’il n’est pas. « Imiter » est le mot qui revient le plus souvent : « Paris, pour l’ordinaire singe de la Cour… ». Les avocats imitent les juges (5), on imite les « petits-maîtres » de la Cour, prenant donc de la Cour « ce qu’elle a de pire », et de moins noble : « vanité, mollesse, intempérance… etc » et ainsi on devient « des copies fidèles de très méchants originaux ».
Même chose (11) quand de simples particuliers veulent faire les Princes, ou que des magistrats (noblesse de robe) prétendent à une noblesse de vieille souche.
Là encore se conjuguent deux aspects de la satire : l’humour devant ce luxe étalé sans discernement, mais condamnation morale de ceux qui n’utilisent leurs titres que pour s’enrichir et changer de classe, c’est-à-dire devenir de bons partis pour de jeunes nobles désargentés, cf. Théramène en 14.
Les femmes
Quelques fragments sont consacrés aux femmes de la ville : leur curiosité indiscrète (2), leur attention uniquement portée sur la richesse (15). La Bruyère dénonce (16) une fatuité (elles font une grossière imitation de la Cour) qu’il juge plus condamnable que la grossièreté des femmes du peuple ou que la rusticité villageoise, car c’est là de « l’affectation » : et donc une sorte d’hypocrisie.
L’âge d’or
En contrepoint, une évocation de la simplicité des anciens temps : quand ce raffinement n’existait pas dans les villes, et quand on connaissait mieux le monde rural ; la ville est devenue un « non-lieu », elle singe la Cour, et elle a perdu le contact avec les choses de la nature ; On y mène une vie anti-naturelle (cf. une fois de plus la description de l’étude sombre de l’homme de loi). Donc une transformation des mœurs, avec cette possibilité pour tous d’accéder à une certaine « grandeur qui entraîne la disparition de ce qui constituait la stabilité de la société.
Conclusion
La Bruyère là-dedans, où est-il ? Cet observateur acharné, ce « grand spectateur » ne partage-t-il pas le même reproche qu’il fait aux citadins en 1 « l’on ne peut se passer de ce même monde que l’on n’aime point et dont l’on se moque » : dont on peut voir deux sens d’abord parce que par rapport à la vie oisive des Nobles, c’est là le monde qui travaille, (la noblesse de robe, les financiers), qui fait marcher le pays, mais aussi parce qu’il y a là la manifestation d’un attachement ambigu à un « spectacle » dont on est le premier critique, en même temps qu’un spectateur captivé cf 13 qui parle du « spectateur de profession » : si La Bruyère n’apparaît pas directement dans ce fragment, il y a là une belle construction en abîme : nous, lecteurs voyons l’écrivain passer son temps à voir des gens voir, où qu’il aillent, un homme qui (comme l’écrivain) passe son temps…à voir ! (il s’agit d’un portrait à clé où les contemporains reconnaissaient le prince de Meckelbourg).
Explication du fragment 12 : Narcisse
Le plan et la syntaxe
Un paragraphe bref, où l’on voit un procédé de style caractéristique de La Bruyère : la juxtaposition : toutes les phrases sont simples, à part une seule relative, courtes et sans liaison, excepté la dernière phrase. Cette parataxe apparaît d’autant mieux que chaque phrase commence par le pronom « il » : Narcisse une fois nommé, l’auteur s’en tient à ce « il » dont le caractère peu personnalisé est en accord avec la totale insignifiance du personnage dépeint. Les phrases toutes bâties sur le même patron syntaxique tendent à reproduire le conformisme social, l’absence totale de fantaisie du personnage.
Le texte s’ouvre et se ferme sur deux phrases similaires et renversées : matin-soir // mort-vie : de même que « il se lève le matin pour se coucher le soir », « il meurt après avoir vécu » : dans la phrase d’ouverture, l’idée de but introduite par le « pour » souligne l’absurdité de cette existence, et dans la phrase conclusive il en est de même pour la circonstancielle de temps à l’infinitif, qui n’est qu’une lapalissade. Le caractère totalement impersonnel de ce « personnage » fait que l’écrivain ne peut rien dire d’autre que « Il est vivant…il a vécu, il est mort ». et pourtant tout un paragraphe lui est consacré. Que dit-il ?
L’emploi du temps
Les notations temporelles qui encadrent le texte donnent le ton : cette vie est extrêmement structurée de l’extérieur par le déroulement du temps. L’existence de Narcisse se confond avec la succession des heures (le matin, le soir), ou plutôt, c’est le respect d’un emploi du temps invariable qui semble structurer Narcisse, un être soumis au temps, comme les animaux, alors que par définition l’homme est celui qui cherche à lutter contre le temps. Il faut donc relever ici tout un vocabulaire de la ponctualité et du temps, seule donnée objective qui produise un changement chez Narcisse : « il a ses heures de toilette… (comme une femme…), il va tous les jours… fait régulièrement… chaque soir… ponctualité religieuse » : monotonie et régularité apparaissent aussi dans la reprise du verbe neutre « faire » repris à tous les temps, et souligné par les adverbes temporels (demain, aujourd’hui, hier). L’ensemble montre l’invariance de ce retour de l’identique : Narcisse est une machine qui ne se pose aucune question (d’autant plus que le point de vue reste toujours extérieur).
L’homme social
Tel qu’il se présente, il est comme une caricature de l’honnête homme : pieux, d’un bon commerce, cultivé. Or le caractère mécanique de sa piété en ôte toute l’authenticité, le « commerce » est réduit à une relation de jeu : ni relation affective avec autrui, ni conversation (on ne le voit pas parler), mais seulement une « place » : tiers, ou cinquième ; encore une fois, ce qui le définit est un comportement tout extérieur. Quant au jeu, le risque pourrait en être un piment, mais la régularité de cette activité comme la régularité de la somme risquée le suppriment. Pour ce qui est de la culture, on ne sait au juste s’il en a ou non, La Bruyère emploie le verbe très neutre « lire » : activité notée par un œil extérieur. Mais retient-il ce qu’il lit ? qu’en pense-t-il ? L’absence d’intériorité fait de cette lecture une activité sociale nécessitée par rien d’autre que par l’instinct d’imitation : faire comme les autres ; les autres lisent, je lis ! Le caractère mécanique de la lecture est souligné par l’adverbe « exactement » qui veut dire que rien ne l’intéresse particulièrement. Noter la différence entre le présent « il lit » (répétition quotidienne de la lecture du journal) et le passé composé « il a lu » (les livres). Les auteurs cités sont secondaires, mais c’est un « panaché » d’une culture : tragédies, romans, philosophie, histoire, poésie. Dans cette description, Narcisse ne semble pas très différent d’une simple machine enregistreuse.
Enfin les femmes : on ne sait s’il a du plaisir ou non d’être avec elles : là encore le parti pris de l’extériorité a fait préférer l’emploi d’un verbe de l’activité à un verbe de l’affectivité : « il se promène avec… » aucun sentiment, mais une promenade là où il faut être vue en compagnie d’une femme.
Conclusion
Donc voilà le portrait féroce d’une vie mécanique seulement réglée par les divisions sociales du temps. Avec La Bruyère, l’homme perd sa conscience, il est réduit à être un « animal social ». L’écrivain a peut-être médité la formule d’Aristote prenant le terme de « Zôon » (être vivant) dans le sens restrictif de « animal » (c’est-à-dire « dépourvu de sentiments »), et assimilant ses activités à de simples instincts sociaux, (comme des fourmis ou des abeilles) dont le caractère nécessaire supprime toute possibilité de variation.
Portrait féroce qui en définitive pose une question fondamentale : l’homme peut-il être autre chose qu’un animal social ? Sa vie échappe-t-elle à toute possibilité de fantaisie ? Toujours est-il qu’ici l’écrivain fait la satire de cette vie de son époque marquée par la régularité des rites sociaux, et par l’absence d’intériorité : l’intériorité du sage capable de transformer le temps objectif en durée subjective.
Tout comme la valeur esthétique d’un spectacle est détruite si l’on pense aux machines qui le créent, de même l’humanité de l’homme se trouve anéantie si l’on découvre que son comportement est soumis à des règles et principes auxquels sa volonté et sa conscience n’ont aucune part. Un automatisme du comportement qui apparaît d’emblée lui aussi comme de façon automatique dans la structure et le rythme des phrases du texte.