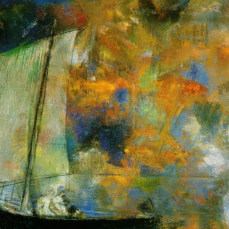Les références sont celles de l'édition J. Dagen, collection Folio-Classique.
Le roman à l’époque de Marivaux
Au XVIIe on trouvait deux formes de « roman » : le roman baroque, touffu et à tiroirs (roman pastoral avec des conversations galantes sur l’amour, et roman héroïque avec des situations et des personnages extraordinaires) et la nouvelle historique, avec des personnages appartenant à la réalité historique, une intrigue simplifiée (une trame unique) et une analyse psychologique qui prenait le pas sur le récit d’aventures). Enfin il y avait une forme parodique, c’était le roman comique (burlesque) où la réalité était prosaïque et la vérité triviale et comique.
Au XVIIIe, on méprise ce genre hérité du siècle précédent : une littérature de femmes, frivole, immorale et pleine d’invraisemblances. On va avoir tendance par conséquent à transformer le roman en genre vrai qui raconte comment l’individu (et non pas le noble, qui par définition n’a pas d’histoire, sinon celle de sa lignée) peut faire sa place dans une société en pleine évolution . C’était du reste être conforme au goût de la classe dominante, c’est-à-dire, de la bourgeoisie, dont le seul « héroïsme » était celui du quotidien.
Ce souci de vraisemblance d’autre part explique qu’on privilégie le Roman-mémoire à la première personne ; il se donne comme un récit vrai et non une fiction (d’où le procédé fréquent d’un manuscrit retrouvé…que l’auteur n’a fait que publier). Et donc le narrateur ne sera jamais omniscient, ce qui entraîne des zones d’ombre, parce qu’à l’inverse du narrateur extra-diégétique qui peut nous éclairer sur l’ensemble des personnages, ici le narrateur, Je, est toujours présent et tout-puissant, c’est le seul sujet, tout le reste dépend de son regard (cf. J. Rousset, Narcisse romancier) et de la limitation de ce regard. Donc tous les autres personnages ne sont plus que des objets. Dans La vie de Marianne, on ne saura par exemple jamais la vérité sur les sentiments de Valville). Mais nous verrons comme le fait d’être finalement le seul « sujet » est important et décisif dans l’objectif de Marianne. Cependant, comme chez Marivaux, la prise de conscience claire de ce qu’on est se fait toujours a posteriori, il y aura une distance entre celle qui raconte et la Marianne héroïne décrite, et donc on retrouve, dans ce système narratif, la distance, mais sur un autre plan, entre la narratrice et les autres personnages. Pour résumer quand la narratrice s’efface et que Marianne est l’actrice principale, il y a représentation de l’autre à travers les signes qu’il émet, et quand la narratrice analyse ses réactions passées, c’est l’introspection qui préside à la connaissance de soi, et le maximum de lumière est projeté sur le moi (surtout s’agissant d’une coquette comme Marianne).
Les dates du roman
La publication s’est échelonnée sur plus de dix ans, le roman présentant une forme ouverte, inachevée : c’est un des problèmes du romancier Marivaux plus apte à montrer des crises (cf. son théâtre) que des évolutions. Plus profondément, on y reviendra, cet inachèvement pourrait être dû au problème que pose l’ascension de l’individu, et qui n’est pas encore résolu, parce que la société hésite encore pour savoir si la valeur de l’individu peut l’emporter sur la noblesse de sang. Or c’est là un des problèmes fondamentaux du roman, où la question est posée sans précisément s’y voir apporter une réponse claire.
- 1731 Marivaux a 43 ans Première partie de la vie de Marianne
- 1734 Deuxième partie et publication du Paysan parvenu
- 1735 Troisième partie
- 1736 Parties 4-5-6
- 1737 Parties 7 et 8
- 1739 neuvième partie apocryphe
- 1741 Parties 9-10-11
- 1745 Partie 12 (et une suite en perspective…)
Une voix qui parle : Marianne
Marivaux construit un appareillage complexe pour faire apparaître Marianne comme la vraie narratrice du livre :
D’abord un « avertissement » où « l’auteur-éditeur » prétend n’avoir rien inventé, n’avoir même pas trouvé lui-même le manuscrit (« je le tiens d’un ami… ». Et de plus, ajoute-t-il, si c’était quelque chose d’imaginé, ce l’aurait été dans le goût de l’époque, avec plus de faits que de morale, ce qui n’est pas le cas pour ce texte. (Marivaux a toujours une visée « morale », on dirait « anthropologique » dans son œuvre) ;
Ensuite un second intermédiaire, « l’ami » prend la parole dans « l’avertissement », assurant que lui-même n’est pas « auteur », et qu’il a trouvé ce manuscrit « dans une armoire pratiquée dans l’enfoncement d’un mur ». La seule chose qu’on apprenne c’est que ce manuscrit est d’une écriture de femme. Donc un manuscrit « trouvé », comme l’enfant « trouvé » dont Marianne raconte l’histoire.
Ces prises de paroles permettent à Marivaux d’affirmer ses choix : il répond aux critiques futures de ses lecteurs en s’élevant contre le préjugé de la séparation des genres : ce n’est pas parce que ce sont des « mémoires » qu’il faut renoncer à y mettre des « réflexions ». Pour l’écrivain, le roman est une forme qui demande la liberté, et qui échappe à un ordre. Là encore nous voyons une coïncidence avec le caractère de Marianne ; c’est d’ailleurs au nom du réalisme qu’il se défend : si le roman n’est pas un lieu de fiction, il doit être le reflet direct de ce que Marianne a vécu ou pensé : « Marianne n’est pas un auteur, c’est une femme qui pense, dont la vie est un tissu d’événements qui lui ont donné une certaine connaissance du cœur et du caractère des hommes. Donc c’est parce qu’un sujet parle d’une voix qui lui est propre que ce qu’il nous raconte de son destin est senti comme vrai : face à lui-même le personnage ne se ment plus.
Ainsi la voix à la première personne est le fondement du vrai (c’était l’inverse au XVII pour qui le « moi est haïssable »). Le Privé s’affirme comme essentiel. Mais (et à l’inverse du romantisme) cette valorisation de l’intime va de pair avec l’exaltation de l’espace social de communication. Et ce sera la contradiction dans laquelle se débattra Marianne :la vérité de son être dépend-elle d’autre chose que d’elle-même ? D’un côté elle sait qu’elle ne doit qu’à elle-même sa réussite, elle sait qu’elle est forte et énergique, mais de l’autre, elle veut à tout prix être reconnue comme membre de la noblesse : une âme d’élite, ou une héritière des traditions établies, qui les respecte ?
Ainsi nous sommes laissés seuls en face de Marianne, sans cette présence souvent ironique que le narrateur adopte souvent envers ses personnages. Il n’y a pas de coupure essentielle entre les deux Mariannes, et cette intimité qui nous est dévoilée sert de garant à la vérité dite par la narratrice.
Une voix qui parle à quelqu’un
Ces lettres s’adressent à l’amie (que Marianne connaît depuis une douzaine d’année), assez proche pour qu’elle connaisse le secret de Marianne (« N’oubliez pas que vous m’avez promis de ne jamais dire qui je suis. Je ne veux être connue que de vous. Il y a quinze ans que je ne savais pas encore si le sang d’où je sortais était noble ou non »). Ainsi l’amie sert de caution au récit puisqu’elle en sait plus que le lecteur, ce qui est un bon motif pour que Marianne ne lui dise pas ce qu’elle sait déjà et donc que le lecteur n’en soit jamais informé.
Il y a donc, par l’intermédiaire de ce secret, une complicité entre ces deux femmes, ce qui explique un emploi fréquent du pronom personnel « nous » dont on ne sait jamais s’il renvoie à elles deux ou à la seule Marianne. Quant au lecteur, il va s’identifier d’autant plus facilement à l’interlocutrice, et partager avec elle les pensées intimes de Marianne.
Ces confidences presque à bâtons rompus transforment le récit des aventures de Marianne en un dialogue très spontané, d’autant que Marianne ne veut pas être « auteur » (« Peut-être devrais-je passer tout ce que je dis là, mais je vais comme je puis, je n’ai garde de songer que je fais un livre, cela me jetterait dans un travail d’esprit dont je ne sortirais pas. Je m’imagine que je vous parle, et tout passe par la conversation » p. 90). Autrement dit, la conversation permet de tout dire, ne filtre rien, et confère encore plus d’authenticité aux propos de Marianne. En cela Marivaux est bien un des meilleurs représentants de l’esprit de ce siècle, où les salons pratiquaient avec tant de plaisir et de brio l’art de la conversation.
L’ensemble du texte est donc du discours qui se divise en :
- Récit de ses aventures
- Réflexions dialoguées avec la lectrice
- Dialogues rapportés des personnages
(ce qui explique le nombre de tours parlés, d’ellipses, de questions, ou la syntaxe quelquefois lâche, une liberté d’allure conforme du reste à l’image que se fait le siècle de la femme, plus spontanée, moins raisonnable.)
Or, comme ce récit est orienté vers un destinataire, et que Marianne est une coquette, il va s’instaurer entre les deux personnages (que ce second soit l’amie ou le lecteur) un rapport de séduction où la narratrice joue dans l’écriture le même rôle que Marianne joue dans la vie avec son amie. Et la véritable aventure du livre, c’est la transformation de la narratrice en romancière, c‘est-à-dire dans ce cas l’affirmation d’un JE (ce qui est précisément le but de Marianne : dire qu’elle est un JE, un Sujet, qu’elle a le droit de parler, le sujet d’énonciation du récit). Ainsi la continuité entre les deux niveaux de signification, est ce narcissisme, cet amour de soi complaisamment étalé, une volonté de plaire qui ne manquera pas de poser le problème de la sincérité, car ce que nous voyons, c’est toujours ce qu’elle veut bien montrer…pour que l’amie (et donc le lecteur) ait une bonne opinion d’elle-même.
Ainsi, expliquer ce texte, ce sera examiner le travail du romancier, ici Marivaux, le narrateur-régisseur, pour comparer ce qui en résulte implicitement avec ce que disent explicitement les deux Mariannes, l’héroïne et la narratrice (qui est la véritable héroïne de l’histoire).
Conclusion : ce roman repose sur un double leurre :
- Marianne a l’air de parler, or elle écrit
- Le lecteur croit entendre une femme, or c’est Marivaux
Pourquoi ce choix du narrateur ? Pour deux raisons
- Parce que la littérature masculine est censée être plus sérieuse, plus savante. Or ici Marivaux se permet constamment des digressions, qui donnent toute la souplesse qu’il veut à son récit : la féminité est liée à l’oralité (cf. la littérature des contes que l’on raconte aux enfants), au refus du roman codifié, à une envie de liberté pour faire apparaître ce que tous les codes font taire, c’est-à-dire la subjectivité de l’être et sa vérité, par de là la logique.
- Mais aussi parce qu’il y a un rapport entre la coquetterie de la femme au sens où elle veut paraître être belle sans apprêt, et celle de quelqu’un qui comme Marivaux a toujours refusé d’être « auteur » cf. dans la première feuille du Spectateur français- le journal qu’il a écrit pendant des années et dont il était l’unique rédacteur- « Pour moi, ce fut toujours mon sentiment : je ne suis pas auteur, et j’aurais été fort embarrassé de le devenir » Marivaux, comme Marianne, recherche, avec le même art, au nom de la vérité, le naturel du style.
Une voix qui se livre à l’analyse de soi
En général, l’analyse rétrospective suppose un va-et-vient entre ce qu’on est, la connaissance qu’on a de soi, et ce que nos réactions vis-à-vis des autres nous apprennent sur nous. Or la situation particulière de Marianne, l’héroïne, c’est qu’elle ne sait pas du tout qui elle est, c’est ce qui explique l’importance du monde, et de la société : en y trouvant une place, elle essaiera de comprendre sa nature.
Un roman des origines
Les prémices du roman correspondent à l’essence du roman par excellence. Selon Marthe Robert, « tout roman perpétue le roman familial que fait l’enfant qui découvre la réalité et se découvre enfant trouvé ou adopté, auquel sa vraie famille se révèlera un jour avec éclat ». Marianne, enfant trouvée, rêve de retrouver la noblesse de ses origines. Mais on ne saura jamais si ce rêve se réalisera, ou si ce n’est qu’un fantasme de la narratrice. Car, ce qui intéresse Marivaux, c’est moins une aventure réelle que l’aventure d’une conscience, et la construction d’un « moi » face aux épreuves de la vie.
La situation de départ est idéale : une enquête sur soi justifiée par l’ignorance de ses origines. : « D’où je viens ? » : ce qui veut dire, à cette époque « Qui suis-je ? » c’est-à-dire « A quelle lignée j’appartiens ? » : il n’y a pas à proprement parler de sujet autonome. La réponse sera dans l’écriture de son histoire et ce que comprendra Marianne, c’est que les deux questions et leurs deux réponses ne sont pas équivalentes : sans savoir d’où elle vient, elle saura qui elle est : elle saura qu’elle est celle qui est capable de s’assumer comme sujet indépendant de son origine « Je suis » : la seule existence du JE est d’être un JE sujet d’énonciation. Et non pas un être d’origine noble et donc dépendant d’une famille : De ce point de vue, on comprend que l’aboutissement du roman ne puisse être la connaissance du « secret » des origines de Marianne, sa noblesse. Marivaux refuse de suivre cette piste romanesque. Mais il y a bien un aboutissement dans l’histoire intime de Marianne, ou plutôt un double aboutissement, au niveau de Marianne l’héroïne, toujours à la recherche d’une mère, quand elle est quasiment « adoptée » par Madame de Miran, et au niveau de la narratrice qui comprend que son identité est d’être celle qui dit « Je » ; si tout le récit de Marianne a un but apologétique qui tend à prouver que c’est à juste titre qu’elle prétend avoir du sang noble, dans son retour sur elle-même, elle découvre qu’elle est douée d’une force vitale, d’une énergie qui l’a fait être ce qu’elle est, une âme d’élite, qui voudrait donc être jugée pour elle-même, et non par rapport à une pseudo-noblesse (d’autant que son contact avec les autres nobles lui ont appris que la noblesse n’est pas forcément synonyme de « belle âme » !).
On peut donc lire ce récit comme l’enquête que fait la narratrice sur elle-même, mais une enquête maîtrisée et aboutie, qui est une réitération de celle de Marianne l’héroïne, sur ses origines, et l’ensemble du roman apparaît comme la répétition plus ou moins étoffée mais toujours « vraie » du même récit d’origine, à des interlocuteurs sans cesse différents, jusqu’au dernier, « La Vie de Marianne », raconté à la Comtesse, comme si les deux Marianne se rendaient compte qu’il suffit de raconter son histoire pour qu’elle soit digne d’être racontée, ou sur le plan psychologique, comme si l’origine fantasmée devait constamment être dite pour devenir réalité. On peut dire que l’histoire s’arrête quand les autres ont accepté comme vrai le récit de ses origines, donc que le fantasme est devenu réalité. Est-ce vrai ou pas ? On ne le saura jamais, car tout ce que nous avons lu, c’est cette recomposition d’une réalité par sa narration, au niveau de la jeune Marianne comme de la narratrice. Toutes les deux à la fin disent « Je » parce qu’elles ont compris que la seule façon d’avoir un nom, c’est, pour l’enfant sans nom de dire « Je ne sais pas qui je suis », et pour la narratrice, de devenir sujet d’énonciation de sa propre histoire, autrement dit qu’elle comprenne que l’important n’est pas dans l’énoncé, mais dans l’énonciation.
Les variations du récit
A. Il y a 13 récits des origines
- Récit de la narratrice I p. 62-63
- Récit en forme de réflexion II p. 135-136
- Récit à la prieure (et à Mme de Miran) III p. 210
- Billet à Valville III p. 217
- Récit de Marianne à Valville IV p. 254
- Récit de madame Dutour à mademoiselle La Fare V p. 328
- Récit de Valville en réponse V 330
- Marianne à l’abbesse VI 364
- Récit de madame de Miran à sa famille VII p. 396
- Récit de Marianne à la Varthon VII p. 429
- Récit des misères de Marianne par Varthon VIII p. 465
- Paroles de Marianne à l’officier VIII p. 500
- Récit de la religieuse IX p. 50
Il faut souligner la place centrale du récit de Marianne à la Varthon (p. 429) (cf. commentaire de texte) : la narratrice comprend que la réalité qu’elle présente est de plus en plus romancée, et ce qui apparaît est tellement loin du réel que ce réel va revenir en boomerang cf. p. 465 les critiques de Varthon : « Il y a bien de petits articles que vous ne m’avez dit qu’en passant et qui sont extrêmement importants, qui ont ou vous nuire… » C’est que la vraie force de Marianne, comme on l’a déjà dit n’est pas dans l’énoncé, dans le contenu de ses paroles, mais dans l’énonciation, et c’est précisément parce qu’elle est capable de transformer sa vie en roman qu’elle est sûre de sa valeur. D’un côté la Marianne du passé devient personnage de roman, et le sujet de l’énoncé se fige parce que l’histoire tant de fois reprise est désormais aboutie, et de l’autre le sujet qui parle prend conscience qu’il a créé un personnage. Mais… ce n’est pas si simple parce qu’il s’agit malgré tout de la même personne, et si l’on peut donc dire que la Marianne narratrice écrit le roman de Marianne, dans ce roman tout est fait pour magnifier l’héroïne, prouver sa noble origine, et qu’elle n’est pas une simple aventurière. Le sous-titre du roman « Les aventures de la Comtesse de *** » nous le laisse sous-entendre, avec ce titre de « Comtesse » mais une vraie comtesse écrirait-elle des « aventures » ? Ce ne sont pas des récits d’aventures que laissent les nobles à la postérité, mais des « Mémoires » : les aventures supposent une origine populaire, un personnage parcourant tous les milieux, une ascension sociale éventuelle, les Mémoires sont l’enregistrement d’une vie de celui ou celle qui n’a pas dérogé à son milieu. Le lecteur de fait ne connaîtra jamais le secret de l’origine de Marianne, et d’autant plus que dans tout le livre le comportement de Marianne n’est jamais très clair. Quelquefois la narratrice qui se voit avec la distance du temps analyse et explique ce comportement ; mais jusqu’à quel point son explication est-elle juste, ou lucide ? N’oublions pas qu’elle veut toujours séduire sa lectrice. C’est la question qu’il faudra toujours se poser dans ces passages où le récit rétrospectif se double d’une analyse de soi (cf. commentaire de texte). Mais d’autres fois elle laisse volontairement le lecteur dans l’incertitude et ce silence sur ses raisons d’avoir agi de telle ou telle manière ne devra pas manquer d’être expliqué.
B. Comparaison des différents récits
On peut considérer La Vie de Marianne comme la diffusion, ou plutôt l’histoire de la diffusion de la vie de Marianne, et cette histoire, c’est l’histoire de son origine, histoire qu’elle utilisera à son avantage alors que précisément son origine d’enfant trouvée aurait pu la desservir.
Et elle s’en sert de toutes les façons,
- Soit qu’elle la cache sciemment pour créer un effet de romanesque propre à exciter l’amour (Récit 2 p. 135)
- Soit qu’elle joue sur l’incertitude de ses origines, mais l’effet produit reste le même (cf. le billet à Valville : récit 4 p. 217)
- Soit qu’elle assure volontairement de la certitude de sa noblesse. Mais le croit-elle ? La Marianne héroïne semble en être persuadée, bien plus cependant que la narratrice.
En tout cas, l’aboutissement du roman sera qu’il n’y aura plus de doutes sur ses origines (Madame de Miran le reconnaîtra elle-même) : on passera alors d’une fiction à une réalité, et c’est ce processus qui intéresse Marivaux.
Comment donc Marianne réussit-elle à convaincre de sa noblesse ?
1) Marianne interlocutrice (Récits 3 et 5).
Le récit originel, fait au début du livre par la narratrice (p. 62), se divise en trois temps :
- le récit qu’on lui raconte (un texte déjà constitué, avec des mots repris)
- a narration qu’elle fait de la mort de la sœur du curé
- la narration de ses aventures jusqu’à son renvoi de chez la lingère ;
C’est par rapport à ces trois moments que peuvent s’évaluer les différents récits qu’elle fait.
Récit 3 : (à la Prieure et avec Madame de Miran qui l’entend) (p. 210) :
Marianne est au plus bas, mais dans l’église elle est aperçue par Madame de Miran (il y a entre elles deux comme un coup de foudre amoureux cf. « et nos yeux se rencontrèrent »…) puis elle est conduite au couvent où devant la prieure et Madame de Miran ; elle va faire le récit de ses malheurs. Quel effet veut-elle produire ? Marianne ne le dit pas. Pourtant on peut relever cette phrase : « Là finit mon petit discours ou ma petite harangue dans laquelle je ne mis d’autre art que ma douleur et qui fit son effet sur la dame ». Le diminutif tend à la faire regarder avec sympathie et à la disculper de toute intention intéressée, ce qui en réalité est le cas et qu’elle dément, par dénégation, ou plutôt dont elle se disculpe en mettant cet « art » sur le compte de sa douleur : la demande de secours lui fait spontanément (dit-elle) trouver le ton qu’il faut.
Récit 5 (p. 254) (à Valville mais aussi devant Madame de Miran) Le dispositif énonciatif est plus complexe : il y a deux auditeurs dont l’un (Mme de Miran) a déjà entendu un premier récit. Mais Marianne a déjà fait la conquête de la mère et du fils, et elle doit dire à Valville ce qu’elle a promis à Mme de Miran : qu’il ne songe plus à l’épouser parce qu’elle entre au couvent. Et elle doit le dire parce qu’elle saisit intuitivement qu’elle n’a pas intérêt à agir contre les desseins de Mme de Miran, qui la protège et l’entoure de son affection. Le but de ses paroles est donc de détourner Valville de son projet de mariage (d’autant plus que Mme de Miran écoute), et elle doit très sincèrement le faire (« Je n’avais que les grâces que je n’avais pu m’ôter, c’est-à-dire celles de mon âge » p. 250 donc pas de coquetterie supplémentaire pour charmer Valville). Elle comprend qu’elle doit absolument donner l’impression d’être sincère. Mais est-ce là être sincère ? Car le discours produit bien un effet, mais contraire à celui qu’il devait faire : les deux auditeurs sont émus jusqu’aux larmes, et Valville s’exclame « Ce qu’elle vient de me dire est-il propre à me détacher d’elle ? » (p. 257). La « sincérité », ici, la vertu, a servi les intérêts de Marianne, c’était l’arme la plus propre à s’attacher Valville (cf. les analyses de La Rochefoucauld : la vertu ici est au service de l’égoïsme, et de la volonté de vivre). Ainsi Marianne a réussi ce tour de force de dire la vérité de telle façon que ceux qui l’écoutent ont la réaction inverse que cette vérité est censée produire : la raison invoquée pour la séparation se retourne pour Valville en une raison de poursuivre son dessein de l’épouser ; plus elle s’est abaissée, plus elle s’est grandie…
Les contenus :
a- Les circonstances de sa naissance : dans le récit originel (p.62), la narratrice parle de l’attaque d’une voiture par des brigands. Elle ne mentionne pas ses parents mais seulement « des hommes » qui voulant résister furent tués comme les trois autres « personnes » qui étaient dans la voiture, et parmi elles deux femmes, et la jeune Marianne qui crie, à demi-étouffée sous le corps de l’une des deux « elle mourut sur moi et m’écrasait ». Elle évoque aussi la présence d’un « laquais » (donc au service d’une famille noble) qui meurt peu après. Et tout le reste est conjecture : qui est la mère de Marianne, celle qui était fort bien mise, ou celle qui était habillée en femme de chambre ? En tout cas tout le récit est auréolé de mystère (cf. la fréquence des modalisateurs « qui paraissait… l’apparence…comme le serait… », les verbes déclaratifs peu sûrs (« on prétend ») le mystère (« cela n’apprenait rien ») et l’horreur, dans un récit dont l’introduction par la narratrice « je dis la vérité comme je l’ai apprise de ceux qui m’ont élevée » est un gage de vérité, puisqu’il se donne presque comme une citation.
- Récit 3 : Ici il y a des différences, car le récit est centré sur Marianne : « je n’avais que deux ans…mes parents… » Mais ces personnes étaient-elles bien ses parents ? il y a moins de romanesque. Marianne veut montrer surtout comment elle s’est retrouvée toute seule, gardant cependant assez de lucidité pour introduire l’idée que ses parents sont nobles (cf. « leurs domestiques y périrent aussi )(dans le premier récit, on ne parlait que d’un seul « laquais ».)
- Récit 5 : « Il n’y a qu’à considérer qui je suis… » et plus loin « voici ce que je suis devenue » : ici la perspective a complètement changé : Marianne oppose sa nature à ce que le hasard a pu la faire devenir. Elle a déjà dit dans son billet à Valville « Je suis peut-être votre égale ». Elle n’insiste plus sur ses origines, car elle a compris que ses interlocuteurs étaient déjà convaincus de sa noblesse, et elle passe très vite sur le mystère de ses origines pour donner un tableau de l’ensemble de sa situation.
b- Son séjour chez la sœur du curé
Récit originel : on y voit déjà une appréciation (« très bonne famille »), la présence d’un couple sororal (un frère et une sœur), et une « tendresse vertueuse » qui relie Marianne à la sœur du curé – déjà un premier rapport de séduction établi, qui anticipe sur celui qui reliera Madame de Miran à Marianne.
Récit 3 : Marianne veut susciter la pitié pour un être très recommandable ; donc la sœur du curé devient « une sainte personne, d’une bonté infinie » (Marianne s’adresse à la Prieure, et elle emploie à dessein un vocabulaire chrétien), puis elle explique les raisons de leur voyage et de sa présence à Paris. Remarquer les tournures totalisatrices « j’ai tout perdu » ou restrictives (« je n’avais que deux ans…il n’y eut que moi… »). Enfin, la mort de sa protectrice « elle est morte dans une auberge… » : apitoiement sur cette mort dans un lieu de passage, et la mention de l’argent dérobé.
Récit 5 : La « bonté » de la sœur du curé devient « compassion » (elle veut insister sur le fait qu’elle n’est qu’une pauvre orpheline dans le but de détourner d’elle Valville). Elle élimine une des deux raisons du voyage à Paris : dans le récit 3, c’était à la fois pour une succession et pour placer Marianne ; ici elle ne mentionne que la succession : elle se met en position avantageuse. Enfin « elle m’a laissée dans une auberge » l’éclairage est sur elle ; pathétique d’être abandonnée dans un lieu trivial : « Je ne suis rien » (qui est donné comme une raison de ne pas l’épouser, alors que cette situation fait naître l’émotion)
c- La suite de ses aventures
Dans le récit 3, deux impressions sont volontairement données : fatalité (c’est une victime) et naïveté (cf. syntaxe, tournures, vocabulaire…). Notons que cette naïveté n’omet pas de donner des preuves de sa sincérité : ainsi la robe qui avait servi de faire valoir (c’est grâce à elle que Madame de Miran a tout de suite jugé de la noble condition de Marianne) pourrait faire croire qu’elle ment, donc elle s’empresse dire de qui elle la tient. Et il y a des silences volontaires (aucune mention de Valville)
Dans le récit 5, elle montre qu’elle ne mérite aucune considération, cf. le pronom personnel qui la représente est le plus souvent en position de cod (« m’a tuée, m’a mise, m’a abandonnée…) mais elle développe l’épisode de l’église, parce qu’elle sait que Mme de Miran l’écoute : s’adressant à Valville, elle s’adresse implicitement à Madame de Miran pour lui dire de façon indirecte toute sa gratitude et lui renouveler les signes de son affection…et faire fondre son cœur !: Voyez comme je suis bien sous tout rapport, et pourtant je ne vais pas être votre belle-fille » c’est dire explicitement qu’elle n’est rien, (et qu’elle doit tout à sa bienfaitrice) mais implicitement c’est apitoyer ses deux auditeurs. Noter que ce qu’elle dit n’a rien à voir avec ce qu’elle avait promis de dire, à savoir « je ne peux vous épouser parce que je vais rentrer au couvent », ce qu’elle remplace par « je ne peux vous épouser parce que je ne suis qu’une pauvre chose et que je dois tout à Mme de Miran » ce qui veut dire implicitement : je ne suis plus une orpheline, j’ai une mère, donc vous pouvez m’épouser !!Tout ce qui est fait pour détourner Valville est en fait destiné à l’attirer !
Ce discours pose le problème de la sincérité : ce qu’elle dit est dit très à propos pour toucher ses auditeurs, mais en même temps, la suite nous montrera qu’elle dit vrai et qu’elle a vraiment le sentiment d’avoir retrouvé une mère. D’ailleurs dans ce discours elle dit de Mme de Miran « Elle agit avec moi comme si j’étais votre sœur » où l’on voit ce désir d’une famille reconstituée entre mère, fils et fille, ce qui laisse présager la suite pour Valville).
Donc une sincérité qui sert toujours ses intérêts, et cette force de l’instinct vital qui se sert de la vertu pour survivre.
Conclusion : des récits toujours vrais, mais des omissions, des styles différents. Il ne faut jamais oublier que la situation est reproduite au niveau supérieur entre la narratrice et sa lectrice : le récit est toujours produit en vue d’un effet.
N.B. I.Piste de plan pour le texte 254 (Récit 5) : Enjeux : Quel effet veut produire Marianne ?
Première partie : un entretien « commandé », deuxième partie « une demande retorse, troisième partie « un nouveau statut familial »
II. Voir les commentaires rédigés n°1 et 2
2) Le récit des origines dit par d’autres interlocuteurs
IL s’agit essentiellement du récit fait par madame Dutour et par Valville, deux récits qui se succèdent immédiatement. Au moment où Marianne pense avoir atteint son but (mariage avec Valville, invitation dans la haute noblesse) elle est « démasquée » par la Dutour : c’est que, d’un point de vue extérieur, elle est vraiment être prise pour une aventurière. Pourtant, ce n’est pas là ce qui menace Marianne, mais quelque chose d’autre, de plus complexe.
La question est de savoir ce qui se passe quand un autre énonciateur prend en charge ce discours de Marianne, fruit de ses fantasmes, quand il est mis en circulation, (comme une monnaie, puisqu’il a valeur d’échange) et lui revient.
Les deux récits sont très différents, et c’est ce que veut Marivaux qui cherche à faire parler la Dutour comme la femme du peuple qu’elle est, et Valville comme un jeune noble amoureux. Leur différence « illocutoire » (l’effet produit sur les auditeurs) est bien marquée : après les paroles de la Dutour, Marianne, les genoux tremblants se laisse tomber dans un fauteuil, pleure et soupire, Mlle La Fare garde les yeux baissés, gênée, elle ne dit mot. Valville fait alors sortir Mme Dutour, tandis que Marianne précise : « J’étais comme une personne accablée ». Et Valville refait le même récit, ce qui entraîne une nouvelle réaction de Mlle La Fare : « Voici un récit qui m’a remuée aux larmes » et de proposer à nouveau son amitié à Marianne, le tout finissant sur des pleurs généraux, pleurs qui terminent ainsi la cinquième partie du livre.
En quoi cet épisode fait-il avancer cette question lancinante (dont Marianne prétend que ce n’est pas une question puis qu’elle affirme constamment sa noblesse) : « Qui suis-je ? » (Quelle est mon origine ?)
A. La répartition des différents épisodes
Leur ordre est différent : la Dutour commence par la fin, ce qui fait apparaître l’épisode parisien comme un fait, et non comme une conséquence malheureuse du funeste accident originel.
D’autre part on observe un rapport de longueur inverse dans les différents épisodes : Valville revient trois fois sur l’origine, en finissant par une maxime générale. La Dutour se borne à une exclamation « la pauvre orpheline ! » et sans un mot sur l’accident fatal, elle dit qu’elle ne sait pas qui est Marianne et que son prénom lui a été donné par la sœur d’un curé. Au contraire, et c’est naturel, la Dutour, pour prouver qu’elle connaît Marianne (répondant par là à Mlle La Fare qui lui a dit « Vous vous trompez sûrement, vous ne savez pas à qui vous parlez ») multiplie ensuite les détails précis : son placement chez elle, le « paquet de hardes », le mouchoir blanchi…Valville résume tout cela par une seule phrase, bien courte : « Un religieux la présenta à mon oncle ».
Donc d’un côté Valville corrobore le nom de Climal, cité par la Dutour, mais de l’autre, il dissipe le mauvais effet de la phrase de la Dutour : « C’était Monsieur de Climal qui l’y avait mise ». Pour Valville la présentation de Climal par le religieux est un acte de charité, car on ne peut soupçonner un homme d’église de l’avoir fait pour autre chose ! Ainsi s’opposent deux Marianne, l’une, une fille de boutique, et l’autre une victime de la fatalité, et surtout une fille de haute naissance, car c’est surtout sa noblesse qui apparaît dans les mots que choisit Valville.
B. Les deux façons de parler
- Énonciation : Marivaux, manifestement, a pris plaisir à imiter la langue parlée des gens du peuple : des exclamatifs (Ah, pardi, Eh, merci de ma vie, que diantre…etc.) On est dans la comédie et dans la vulgarité. Peu de phrases affirmatives aussi, mais des questions, des exclamations, des proverbes ; enfin une implication maximale de l’énonciatrice dans son discours.
Dans le discours de Valville, il y a du pathétique, et nous sommes dans le registre tragique (« Si je la perds, je pers la vie »), et Valville fait un récit objectif, sans s’impliquer dans son discours.
Conséquence : La Dutour, s’imbriquant elle-même dans ses propos sur Marianne la contamine de sa vulgarité et de son prosaïsme ; au contraire Valville construit une Marianne avec des clichés romanesques. Marianne existe sans lui, avec des mots expressement choisis pour la rendre la plus respectable possible.
- Énoncé : car le plus important, ce sont les mots choisis : mots du registre prosaïque d’un côté (pension, apprendre le négoce, nippes, paquet de hardes, fille de boutique…) et de l’autre un registre élevé (carosse de voiture, domestiques…) avec des éléments de romanesque qui font apparaître Marianne comme une jeune fille très noble alors qu’elle n’est qu’une vulgaire enfant trouvée dans la bouche de la Dutour.
C. Les épisodes choisis
Deux épisodes les plus développés et traités différemment : les vêtements et la naissance.
La Dutour ne ment pas mais se borne à la plate réalité des faits : rien n’est faux et tous les détails concrets l’attestent (cf. le mouchoir blanchi) et au « qui suis-je ? » elle donne une réponse bien décevante. Au lieu d’apparaître différente de tous les enfants trouvés, Marianne rentre dans la plate médiocrité : « En un mot comme en cent, qu’elle parle ou qu’elle ne parle pas, c’est Marianne, Marianne sans nom… » Précisément pour la Dutour, qui n’a pas la finesse des classes supérieures, ce qui compte n’est pas la qualité de la langue mais la réalité des faits, qu’elle énonce, face à la représentation fantasmatique que Marianne veut donner d’elle-même. Et cette contradiction est terrible pour Marianne qui croyait jusque-là à son « roman ». Voilà donc comme on peut me percevoir ! voilà ce que je suis ! non pas l’image que je veux donner, mais celle qu’on a de moi ! terrible désillusion sur sa nature : il est donc possible de ne pas voir que je suis de noble condition ! Remarquons le silence absolu de la narratrice sur la réaction de Marianne.
Ainsi la princesse redevient Cendrillon. Au lieu de permettre de dévoiler la noblesse du Moi, le discours de Dutour dévoile sa trivialité (les nippes, le mouchoir, Marianne échevelée…) et ôte au récit de l’origine toute sa dignité romanesque.
Au contraire Valville va avoir à cœur de persuader Mlle La Fare de la noblesse de Marianne : il ne ment pas lui non plus, mais il habille la vérité d’un récit qu’on ne connaît par ailleurs que par la narratrice et Marianne, donc déjà peut-être enjolivé, par toutes sortes d’embellissements : ainsi le « carrosse de voiture, le nombre de domestiques, les « gens de condition », la précision inventée « tombée sur le corps de sa mère » (le récit premier ne le spécifiait pas). Puis « ses parents voyageaient avec plusieurs domestiques de tout sexe » Valville ne ment pas lui non plus en disant « domestiques de tout sexe » mais il se garde de spécifier qu’il y avait donc au moins une femme qui pouvait être la mère de Marianne (ce qu’il a déjà exclu en distinguant bien « ses parents » des « domestiques ».
Quant à l’épisode avec Climal, il est remarquable que Valville préfère évoquer toutes les circonstances antérieures (« élevée par sa sœur morte….sans secours…etc) plutôt que s’attarder sur l’histoire de Climal.
De façon générale, Valville parsème son récit de suppositions en sa faveur « Elle est fille de qualités, on n’en a jamais jugé autrement », « Peut-être est-elle plus noble que moi » « Le rang dans lequel on a bien vu qu’elle était née… » ou encore « les égards qu’elle mérite de tous les gens honnêtes » Qui est ce « on « tant de fois répété, et qui sont ces « gens honnêtes » (= « bien nés ») si ce n’est ceux qui justement sont différents de la Dutour ?
Ainsi Valville remet Marianne sur son piédestal. Elle redevient une princesse par la grâce des mots. Toute trivialité a disparu, c’est une héroïne romanesque dont le « secret de la naissance » augmente le charme sans laisser place à aucune suspicion. Le récit fantasmatique premier est même étoffé.
On peut tirer de tout cela deux conséquences, l’une sur le plan du rapport du langage avec la réalité, l’autre sur la réponse à la question lancinante du « qui suis-je ? »
-Sur le plan du rapport langage-réalité
On peut constater que globalement les deux récits sont justes, et plus précisément que l’un est tout ce qu’il y a de plus vrai, mais ne dit pas tout (celui de la Dutour cf. les circonstances de la mort des « parents ») et que l’autre ne ment pas non plus mais omet aussi certaines choses (à propos de Climal) ou bien interprète d’une façon avantageuse les faits (cf. le mot « suite » au lieu du seul « laquais » qui déjà peut-être devait remplacer le mot plus simple de « serviteur »).
La leçon à en tirer, c’est de se demander ce que veut dire « parler sincèrement » : les mots ne servent-ils pas toujours à exposer une interprétation préalable ? Et cette oscillation du statut de la vérité va rejaillir sur l’ensemble du récit de Marianne : si ces deux récits sont si différents, pourquoi Marianne, même sans le faire exprès, ne travestirait-elle pas les faits ? Peut-on se fier à tout ce qu’elle raconte, surtout que nous ne connaissons les faits que par son seul témoignage.
-Sur la question « qui suis-je ? »
Par conséquent Marianne, et le lecteur comprennent que c’est la manière de dire qui compte, et non pas ce qui est dit : moins l’énoncé que l’énonciation, et c’est ce en quoi Dutour se trompe quand elle dit « Qu’elle parle ou qu’elle ne parle pas, c’est Marianne… » Non, quand Marianne parle, c’est une jeune-fille noble qui s’exprime, cf. devant la famille de Valville. Peut-être le fait d’entendre alternativement ces deux récits fait-il comprendre à Marianne l’origine de sa force : si j’affirme que je suis noble, c’est que je suis capable de l’affirmer (et non que je le suis vraiment), et le « qui suis-je » ne sera plus désormais le synonyme de « quelle est mon origine » : même si la seconde question reste sans réponse, la première en a une, celle qui consiste à s’affirmer comme le sujet d’énonciation capable de prétendre à la noblesse, noblesse qui par conséquent ne sera plus celle du sang, mais celle du cœur cf. ce que dit le ministre dans la grande réunion familiale (p. 407) « la noblesse de vos parents est incertaine, mais celle de votre cœur est incontestable, et je la préfèrerais, s’il fallait opter ».
En conclusion, deux mouvements contradictoires : plus elle est sûre d’elle, plus elle comprend que sa vraie capacité est de s’affirmer comme un JE, comme un sujet, mais plus le lecteur la reconnaît comme telle, moins il adhère peut-être à la réalité fantasmée qu’elle énonce.
La Vie de Marianne : l’intimité retrouvée (cf. Demoris Et. Litt. 1991)
Exposé du problème
Marianne perd à deux reprises sa famille. Elle en retrouve une (elle y est d’ailleurs l’objet d’un triple désir) ; mais sur le point de se marier, elle s’aperçoit de l’infidélité de Valville. Elle renonce à lui mais reste dans sa famille, et elle devient en quelque sorte la sœur de Valville puisqu’elle tient à garder celle qui veut être sa mère à elle aussi. Ainsi le roman d’amour annoncé ne s’accomplit pas, Marivaux lui substituant une solution régressive (retrouver un nid familial). Qu’est-ce qui amène l’écrivain à faire un tel choix ?
La Mère Confidente
A l’époque où paraissent les seconde et troisième partie de son roman, donc au moment où dans le roman est introduite Mme de Miran, Marivaux écrit plusieurs pièces de théâtre qui traitent également des relations mère-fille. Dans La Mère Confidente, il y a un véritable couple, celui que forment la mère et la fille : la mère envahit tout le champ affectif y compris tout l’espace affectif de sa fille Angeline. Elle n’hésite pas à se poser ouvertement en rivale du jeune homme aimé par sa fille : « Lequel aimes-tu le mieux, ou de cette mère qui t’a inspiré mille vertus, ou d’un amant qui veut te les ôter toutes ? » Et le pire, c’est qu’elle gagne ! Elle fait renoncer sa fille à l’enlèvement qui avait été projeté, et son amant s’incline : « Je me range de son parti, et me regarderais comme le plus indigne des hommes si j’avais pu détruire une aussi belle, une aussi vertueuse union que la vôtre » (remarquons le terme employé « union » ! (heureusement in fine, la mère consentira au mariage, Marivaux est optimiste !) Quant à cette « union », elle est qualifiée de « vertueuse » non que le couple mère-fille ne soit fondé d’abord par un rapport de filiation, mais parce qu’il apparaît comme un choix réciproque. Or la pièce est contemporaine de l’invention du personnage de Mme de Miran. Et le problème qu’y pose Marivaux, c’est de savoir si cette relation (qu’on appelle en psychologie « identification primaire » le fils voulant être comme le père, et le père, ou la mère voulant voir un autre lui-même dans l’enfant) peut compter plus que le choix amoureux. La suite normale de cette interrogation conduit à notre roman : le désir d’un tel rapport peut-il se développer hors des liens du sang ? Nous étudierons donc la nature particulière de cette relation entre Mme de Miran et Marianne.
Les relations entre Marianne et Mme de Miran
- La scène du coup de foudre (pp204-205)(« J’étais alors assise….et elle sortit »)
Soulignons d’abord l’importance de la « parure » qui ne fait que rehausser « la bonne façon » (le mot est répété, et le paragraphe qui suit développe la même idée : « on aime à aider les gens distingués »), et donc provoquer l’attendrissement de Mme de Miran devant ce qui est donné comme « un tableau » (cf. « la posture de la personne du monde la plus désolée ») : Marianne ne s’aperçoit qu’elle est regardée qu’au bruit que fait Mme de Miran en se retirant : « Je voulus voir qui c’était ». Et la petite scène se termine par « Et nos yeux se rencontrèrent » : la rencontre offre toutes les caractéristiques de l’échange amoureux (scène beaucoup plus pure sur ce plan que la rencontre en deux temps avec Valville). Il y a là quelque chose qui se passe, qui est de l’ordre affectif, et dont l’importance va rejaillir sur tout le reste du roman.
- La grande scène de la quatrième partie (pp. 228 et suivantes)
(Rappelons qu’il s’agit de la scène où Mme de Miran présente Marianne à Mme Dorsin qui a voulu la connaître, et où, sans savoir qu’il s’agit de la même Marianne, Mme de Miran, raconte que son fils refuse la jeune fille qui lui est destinée parce qu’il s’est entiché d’une inconnue).
Or précisément par la suite, et juste avant cette grande scène, Marivaux-Marianne font un portrait-hommage de Mme de Miran (où l’on a reconnu Madame de Lambert) mais où est soulignée son absence de toute séduction : « Aussi n’avait-elle guère d’amants, mais beaucoup d’amis et même d’amies ». Elle est aussi loin de la vie sexuelle que l’était la sœur du curé. Puis Mme de Miran va présenter Marianne à Mme Dorsin et elles ne cessent de complimenter Marianne. Or cette femme, dont on vient de dire qu’elle était en dehors de la sphère du désir montre de façon claire son attirance pour Marianne (de même d’ailleurs dans la scène du « coup de foudre » Marianne, réciproquement, avait, elle aussi, été attirée (mais jusqu’où peut-on la croire ?) par cette femme dont elle nous dit (p. 223) que « ce quelque chose de si bon et de si raisonnable dans sa physionomie avait pu nuire à ses charmes). Elle l’appelle à plusieurs reprises « ma fille », veut même la toucher (mais Marianne, au parloir du couvent, est derrière une grille, donc elle ne peut que lui passer trois ou quatre doigts !) et s’exclame : « Oui, Marianne, je vous aime…Je vous ai appelé ma fille ; imaginez-vous que vous l’êtes et que je vous aimerai autant que si vous l’étiez ». Et Marianne, à son tour essaie de lui baiser la main « dont elle ne put m’abandonner que quelques doigts ». Et même après que Marianne aura reconnu que « la petite aventurière » qui a détourné Valville et elle-même ne font qu’un, son humilité, ses pleurs désarment sa bienfaitrice, et, en lui tendant une troisième fois sa main s’exclame : « Oui, c’est ma fille plus que jamais ! ».
Et il y a dans cette scène comme une superposition d’une part des sentiments de Mme de Miran pour Marianne avec ceux de Valville pour la même Marianne et de l’autre des sentiments de Marianne pour Valville avec ceux qu’elle éprouve pour Mme de Miran : au « Je vous aime et vous le méritez bien » (p. 229) correspond (p. 242) qu’il faut aider Valville à « surmonter un amour que vous ne méritez que trop qu’il ait pour vous, et dont je serais moi-même charmée » Les sentiments de compassion qu’éprouve Mme de Miran pour Marianne coïncident avec le désir amoureux de Valville. Et inversement (p. 245) Marianne dit de Valville : « C’est un jeune homme si doux, si bien fait, qui vous ressemblait tant ! et je vous ai aimée aussi dès que je vous ai vue » (mais peut-on la croire vu ce qu’elle a dit de l’absence totale de charme de Mm de Miran !). En tout cas, là aussi il y a coïncidence de deux sentiments. Ajoutons encore le troisième membre de la famille, Climal, le propre frère de Mme de Miran, pour qui Marianne est aussi objet de désir : « Juste ciel, que m’apprenez-vous » dit Mme de Miran, « quelle faiblesse dans mon propre frère ! »
Il y a ainsi entre les membres d’une même famille comme une identification à un même objet, et c’est ce qui intéresse Marivaux : Mme de Miran comprend l’amour de Valville parce qu’elle se met à sa place, et elle est d’autant plus émue qu’elle voit que son fils (et son frère) l’ont précédée dans son choix : elle s’identifie à eux pour posséder le même objet.
Quant à Marianne, au début de l’entretien, elle est quasiment cynique : « Petite aventurière » (elle reprend le terme utilisé par Mme Dorsin pour désigner celle qui en réalité est Marianne) « le terme était de mauvais augure. Je ne m’en tirerai jamais, me disais-je », et elle joue son va-tout, elle prend le risque de sacrifier son amour pour Valville en montrant la lettre qu’elle vient de recevoir, donnant à Mme de Miran ce privilège de « la mère confidente ». Et quand Mme de Miran, charmée s’exclame : « C’est ma fille plus que jamais ! » quelque chose se passe : « Un moment de silence qui fut si touchant que jamais je ne saurais encore y penser sans me sentir remuée jusqu’au fond de l’âme » : l’émotion est encore actuelle au moment de la narration. C’est qu’on assiste à la naissance d’un véritable amour filial qui va prendre le pas sur le désir ; d’ailleurs la narratrice, peu après qu’elle a dit qu’elle renonçait à Valville, constate l’absence d’une douleur profonde : « Qui m’aurait vue m’aurait crue bien triste ; et dans le fond, je ne l’étais pas, je n’avais que l’air de l’être, et à me bien définir, je n’étais qu’attendrie » (p. 248)
- La véritable histoire d’amour du livre
De fait, le même renoncement aura lieu, et avec le même attendrissement sur elle-même, à la suite de l’infidélité de Valville. C’est que pour Marianne le plus important est l’affection de Mme de Miran. Il ya là quelque chose de mystérieux dans cet amour réciproque : Marianne le remarque « C’est quelque chose d’incompréhensible que ses bontés pour moi » et « Je ne vivrais point si je vous perdais…je n’aime que vous d’affection…je ne tiens sur la terre qu’à vous » (p. 403). D’un côté une femme qui témoigne plus d’amour pour Marianne que pour son propre fils, et cette jeune fille qui se trouve plus en sûreté auprès d’une mère qu’auprès d’un amant ; Marianne le dit elle-même : « J’aurais tout enduré hormis d’être abandonnée d’elle… » « J’ai mille fois plus encore songé à vous qu’à lui…c’était ma mère qui m’occupait, c’est le cœur de ma mère qui m’est le plus nécessaire… » (p. 414)
A la fin de son histoire avec Valville, au lieu d’être désespérée, Marianne est assez paisible et attendrie (« Je rentrai plus attendrie qu’affligée » p. 492), d’autant qu’elle sait qu’elle restera avec Mme de Miran. Il faut comparer cet état d’esprit à ses réflexions, plus cyniques, quand elle apprend l’infidélité de Valville quelques pages auparavant (p. 460). Si elle s’en consolait assez rapidement, elle avait réalisé soudain qu’elle n’habiterait plus dans l’appartement qu’ avait promis Mme de Miran à sa future belle-fille « Je songeai que non seulement Valville était un infidèle, mais que Mme de Miran ne serait plus ma mère ! ne point occuper cet appartement qu’elle m’avait montré chez elle ! …De cet appartement j’aurais passé dans le sien, quelle douceur ! et il fallait y renoncer » (p. 460). On voit comment la certitude de rester avec Mme de Miran lui fait reconsidérer beaucoup plus paisiblement l’infidélité de Valville !
Il y a ainsi comme une rivalité entre Valville et sa mère. Et on comprend bien que Valville, supplanté dans le cœur de Marianne par sa mère fuie cette situation où Marianne apparaît comme une sœur (cf. le retour obsédant de « ma mère …ma fille…) et il préfèrera à Marianne une anglaise en détresse pour faire reconnaître son identité propre. Il fuit exactement la gêne de n’être qu’un appendice de sa mère. C’est dans cet effacement de Valville que le roman trouve son achèvement, car Mme de Miran relaie à la fois le projet de protection de Climal, mais en tout bien tout honneur, et le rôle affectif d’un Valville devenu infidèle.
- Le tête-à-tête Marianne-Mme de Miran (septième partie p.415-416)
Cette scène est très importante : Valville est présent, mais il n’assiste qu’en témoin à l’intronisation de Marianne dans la famille. On y voit d’abord comme un jeu où Marianne, chaque fois que Mme de Miran lui offre un objet répond toujours qu’elle préfère, à tout ce qui lui est offert, l’amour de sa « mère » :
- Mme de Miran lui offre la bague, mais Marianne avisant un portrait de Madame de Miran : « Je vois un portrait que j’aimerais mille fois mieux que la bague…cédez-moi le portrait, je vous rendrai la bague »
- Puis Mme de Miran lui offre une bourse pour y mettre son argent : « Où mettrai-je tout l’amour, toute la reconnaissance que j’ai pour ma mère… »
La question ici n’est pas de savoir jusqu’où va la sincérité de Marianne. Le sait-elle elle-même ? On y reviendra. Le plus important est l’identification qui se produit à ce moment-là. Mme de Miran jouant le rôle de Valville ou de son propre mari, ou de Marianne elle-même : elle met la bague au doigt de Marianne (à la place de Valville), elle lui donne une bourse, et lui désigne ses appartements : « Je veux lui montrer l’appartement que j’occupais du vivant de votre père » (donc ici Marianne prend la place de Mme de Miran). La réaction de Marianne reste toujours identique : « Ah ! ma mère ! quels délices pour moi ! songez-vous que cet appartement-ci me conduira dans le vôtre ! » Peut-on supposer que Mme de Miran occupe, elle, l’appartement de ce père dont il est fait mention ici pour la première et la dernière fois dans le livre ? C’est-à-dire, dans ce cas, qu’elle occupe symboliquement par rapport à Marianne la place de l’époux, Marianne étant de son côté une autre Miran, jeune et aimée, mais installée dans un lieu qui lui permet de retourner à la mère, de s’abriter dans cet espace-ventre métaphorique -bien différent de cet écrasement par le corps de sa « mère » dont elle fut victime dans l’accident originel). On voit toute l’ambiguïté de cette intimité qui est à la fois un rapport fondamental à l’espace prénatal, et en même temps qui se substitue au rapport conjugal.
En tout cas voilà une relation qui correspond à une double demande (Mme de Miran et Marianne), même si elle est fondamentalement dissymétrique, parce qu’on peut là encore se poser le problème de la sincérité de Marianne (surtout si on compare ce passage à celui dont nous avons déjà parlé p. 460). La réponse ne peut pas être claire, car le cœur humain est plein de contradictions, Il y a là un mélange inextricable entre l’amour de soi et l’amour de l’autre, sauf à dire que la solution finale est régressive, et montre une satisfaction non dissimulée à jouir du bien-être que procure à Marianne sa protectrice.
On ne peut pas, pour terminer, ne pas revenir à Molière, dont le Tartuffe fut peut-être une des sources d’inspiration de Marivaux, et rapprocher la relation entre les deux femmes de la relation Orgon-Tartuffe, une passionnelle, qui ne se donnait pas pour sexuelle, mais qui présentait aussi, comme ici, certaines caractéristiques de l’amour. Chez Marivaux, il n’y a pas de mystification de Mme de Miran par Marianne, à l’inverse de Tartuffe, mais ce mode de relation est présenté comme essentiel ; et le problème que se pose l’écrivain Marivaux, c’est de savoir s’il y a un langage pour cet amour-là. Comment le dire ? une passion en dehors de la sexualité est-elle possible ? et si ce n’est pas le cas, Marianne joue-t-elle alors plus ou moins consciemment avec une véritable « passion » de sa protectrice à son égard ? Est-elle alors aussi hypocrite qu’un Tartuffe ? Cependant cette hypocrisie éventuelle sert aussi le bonheur de Mme de Miran…
Conclusion
Nous voyons donc dans ce livre une réflexion sur l’affectivité qui circule à l’intérieur d’une famille, et précisément entre deux femmes qui reproduisent le rapport mère-fille, chacune pouvant voir dans l’autre comme une identification, une projection de soi-même. Ce rapport inter-subjectif est entre sujets, deux sujets qui éprouvent des sentiments d’amour réciproque : on n’est plus dans un temps (XVIIe) où le désir ne s’éprouve que comme une manifestation de l’amour de soi, et où le bonheur de l’autre ne compte pas, l’autre n’étant que l’objet du désir (cf. Nemours pour la princesse de Clèves ou les héros raciniens). Aimer, c’est aussi savoir aimer l’autre, et donc passer par le désir de l’autre pour l’aimer, c’est aussi y trouver de la satisfaction pour soi : le tempérament optimiste de Marivaux fait aller l’amour de soi avec l’amour de l’autre.
Si Marivaux s’intéresse à ce problème dans le cadre familial, c’est que la famille est conçue comme une intimité nouvelle où précisément circule cette énergie affective dont il se demande en quoi au juste elle consiste : jusqu’à quel point est-elle colorée de désir ? (c’est ce qui pose le problème de l’inceste). Quelle est la part d’investissement libidinal dans les relations familiales ? mais Marivaux ne fait qu’effleurer la question, c’est encore un classique, qui ne veut pas aller trop loin dans une exploration susceptible de bouleverser les codes religieux et moraux : « Peignez la nature à un certain point, mais abstenez-vous de la saisir dans ce qu’elle a de trop caché, sinon vous paraîtrez aller plus loin qu’elle, ou la manquer » (Cabinet du philosophe, vingtième feuille).
Disons donc que Marivaux détecte la présence d’une énergie désirante qui ne se laisse pas canaliser par les voies autorisées du choix de l’objet amoureux et qui pour se libérer passe par les voies autorisées de l’affectivité familiale en rejouant avec l’autre des rapports d’identification pré-oedipiens.
C’est ce qui justifie la présence de l’histoire de Mlle de Tervire (onzième partie du livre), où l’on voit une mère en quête d’une fille (réciproque de l’histoire de Marianne), et une attirance réciproque pour une jeune-fille qui se révèlera sa fille. Ici l’attirance réciproque est justifiée par les retrouvailles mère-fille. Mais peu importe : que le rapport mère-fille soit réel ou non, c’est par ce lien affectif qu’il passe, et il reste toujours ambigu. Et la superposition de cette dernière histoire avec celle de Marianne montre qu’il y a la présence d’un même amour dans les deux cas, même si dans celui de Marianne cet amour ne repose pas sur un rapport de filiation réel.
La Vie de Marianne : Parures et effets (chapitre en forme de plan)
Il faut d’abord souligner l’importance des signes de reconnaissance dans cette société de l’apparence qu’était la société du XVIIIe. Et par conséquent l’importance de la parure et de la coquetterie. Un des enjeux du roman, c’est que Marianne veut faire comme les autres, être intégrée en apparaissant comme une jeune fille de noble origine, mais que, (et cela de plus en plus au fil du roman) elle revendique le droit d’être elle-même. Ainsi le vêtement, blason de l’appartenance sociale va servir de pierre de touche à cette ambivalence : il compose le fil de l’intrigue, il agit comme révélateur, et il prend une valeur métaphorique de La Vie de Marianne
L’importance narrative du vêtement (de la première à la cinquième partie)
A. Un fil qui court tout au long du roman
Dès le début le vêtement sert à marquer la noblesse de l’origine : « j’étais vêtue d’une manière trop distinguée pour n’être que la fille d’une femme de chambre » (p. 62, récit originel). Et la seule chose qu’elle apprenne chez la sœur du curé c’est de faire de « petites nippes de femmes, industrie qui m’a bien servi dans la suite » (p. 67) c’est-à-dire non seulement pour trouver du travail, mais pour savoir s’habiller !
Enfin c’est au sort de ses vêtements que son malheur apparaît « une partie du linge fut volé… » (p. 75) et « Je laissai vendre des habits… » (p. 76) et quand on connaîtra la coquetterie de Marianne, on comprend l’étendue de ses regrets !
B. Le séjour chez la lingère
Ce n’est évidemment pas anodin qu’elle soit chez une « lingère » ; et c’est là que les vêtements deviennent la trame de l’intrigue :
D’abord Climal lui offre des gants, puis elle va choisir avec lui un habit (p. 92) « noble et modeste, et tel qu’il aurait pu servir à une fille de condition qui n’aurait pas eu de bien » : l’habit, marqueur social : même sans beaucoup de bien, une jeune fille noble ne s’habille pas vulgairement., Enfin elle reçoit ce paquet de linge très fin qui nous est décrit (p. 99) Et après avoir décidé d’accepter ce présent sans répondre aux avances de Climal elle s’empresse d’essayer ces robes : « je me mis à m’habiller pour jouir de ma parure… » pour aller séduire le monde « Il me tardait de me montrer à l’église pour voir combien on me regarderait ». C’est là qu’elle rencontre Valville. Puis elle décide de tout rendre à Climal, et on la voit aux prises avec ses regrets : la scène est comique : elle tarde à faire le paquet, elle oublie d’y mettre la cornette, puis elle hésite à enlever, pour la rendre, la robe qu’elle porte (la robe de la séduction !), elle atermoie toujours (pp. 188-89) et elle a l’idée de ne rien faire immédiatement mais d’aller trouver le père Vincent : elle garde la robe et remet sa cornette ! La raison de ses tergiversations, qu’elle ne dit pas parce qu’elle n’en est peut-être pas consciente (et que la narratrice se garde bien de dire) n’est pas qu’elle hésite à faire preuve de vertu vis-à-vis de Climal, mais qu’elle veut garder Valville c’est-à-dire garder la robe !
Et après sa visite au Père, elle rencontre (toujours dans cette robe) Mme de Miran dans l’église.
Ainsi la robe a servi à la triple rencontre Valville-Climal-Miran, et elle ne s’en débarrassera (avec le « paquet de hardes » qu’elle renvoie à Climal) qu’après s’être assurée de la protection de Mme de Miran, non sans s’être une dernière fois servi du prétexte de ce paquet pour rentrer en contact avec Valville (p. 217)
C. Dernières occurrences
Mais c’est qu’elle a trouvé quelqu’un d’autre pour l’habiller : « Deux ou trois jours après…ma bienfaitrice m’y fit habiller comme si j’avait été sa fille… » (p. 220).
Mais c’est encore sur une histoire de linge que l’intrigue rebondit avec l’arrivée inopinée de la lingère chez Mlle La Fare.
Et le reste de ses péripéties va de pair avec les allées et venues de ses « hardes » qui la suivent ou non.
En tout cas, et de façon paradoxale, Marianne dans cette attention extrême à sa parure cherche à donner une impression de naturel,: toute l’astuce de Marianne est de séduire en cachant ses moyens de séduction : le comble de la coquetterie.
La parure, révélateur de l’individu
Le rapport au vêtement permet de révéler l’individu soit dans en tant qu’être de désir, soit en tant qu’être de désir, soit en tant qu’être féminin.
A) Un être de désir
Le vêtement a une double fonction : il montre d’abord le désir de posséder l’autre, en l’achetant, en quelque sorte, par l’intermédiaire d’un objet qui symbolise lui-même le désir (les gants d’abord puis le linge offerts par Climal. Remarquons que Madame de Miran (la sœur de Climal !) habille aussi Marianne. Mais le vêtement montre également le désir de plaire, d’être vue. Beaucoup de déclarations sur le plaisir de la séduction dans le livre, notamment dans le passage où elle hésite à rendre immédiatement le linge offert par Climal, et c’est sciemment, en vue de plaire en se montrant à l’église que Marianne garde sur elle la jolie robe qu’il lui a donnée. Ainsi la parure a d’abord une fonction sexuelle
B) Un être social
Ici encore la manière de considérer la parure est la pierre de touche de l’origine sociale :
- Une origine basse : c’est le cas pour la Dutour : la robe a d’abord une valeur marchande cf. quand elle conseille à Marianne de garder le linge offert (« Puisque vous ne possédez rien, je prendrais d’abord tout ce que M. de Climal me donnerait » p. 102), elle est même prête à lui acheter la robe quand Marianne veut s’en débarrasser : « Je vous l’achèterai » (p. 183) dit-elle parce que si Marianne sans les subsides de Climal redevient pauvre et que dans ce cas « Une robe ne convient plus à votre état » : la robe a une valeur qui fait qu’une pauvre ne peut pas la porter « Vous ne pourriez plus honnêtement la porter à cette heure que vous allez être pauvre… elle serait trop belle pour vous » (c‘est-à-dire qu’elle se la serait procurée par des moyens malhonnêtes). Mais remarquons que c’est surtout parce qu’elle la convoite que la Dutour veut acheter la robe !
- Une origine noble : au contraire pour Marianne la robe est précisément un signe qui n’a pas de valeur marchande mais qui est facteur de distinction sociale, et elle comprend que l’effet que produit sa robe est pour elle un atout important cf. p.204 au moment où Mme de Miran la voit pour la première fois : « Il est bon de plaire un peu aux yeux, ils vous recommandent au cœur. Etes-vous malheureux et mal vêtu ? ou vous échappez aux meilleurs cœurs du monde, ou ils ne prennent pour vous qu’un intérêt fort tiède ; vous n’avez pas l’attrait qui gagne leur vanité, et rien ne vous aide tant à être généreux envers les gens, rien ne vous fait tant goûter l’honneur et le plaisir de l’être, que de leur voir un air distingué » Nous voyons ici l’exact inverse du conseil donné par la Dutour. Et il faut comparer l’effet que Marianne produit sur Mme de Miran avec ce qui est dit par Madame Dorsin de la « petite aventurière » qui a tourné le cœur de Valville : « « une grisette ou tout au plus la fille de quelque petit bourgeois, qui s’était mise dans ses beaux atours à cause du jour de fête » (p. 231) « grisette, petit bourgeois »… tant qu’on n’a pas vu Marianne, et qu’elle n’a pas montré la parfaite convenance de sa parure avec sa personne on peut la suspecter. Mais dès qu’on la voit, son apparence, c’est-à-dire cette convenance entre ce qu’elle est et ce qu’elle arbore entraîne un préjugé de noblesse en sa faveur.
Ainsi la « noblesse » propre à Marianne (à l’inverse de la grossièreté de la Dutour) est-elle de ne pas considérer la robe comme valeur d’usage ni comme valeur d’échange, mais comme valeur symbolique, la robe devenant le signe extérieur de sa propre valeur, et de façon plus générale, le signe d’une appartenance sociale : Marianne anticipe par sa toilette le rang qu’elle postule. Il y a comme un syllogisme (faux) qui opère: si on me juge digne de la robe, dans la mesure où cette robe est celle qui marque l’appartenance à la noblesse, il s’ensuit que je suis noble !
C) l’Être féminin
Enfin, de manière évidente et récurrente dans le livre la robe montre la coquetterie des femmes : il suffit de noter les réactions symétriques de Marianne, de la Dutour et de Toinon devant les beaux habits offerts par Climal : plaisir des yeux, plaisir de plaire. Cf. p. 105
La parure, valeur métaphorique
De la parure à la coquetterie, on peut voir que c’est un art de plaire commun aux trois énonciateurs (les deux Marianne et Marivaux), et que c’est l’élément d’un code qui fonctionne comme un signe. Cf. Barthes (Système de la mode p. 23) « Mode et littérature disposent d’une technique commune dont la fin est de paraître transformer un objet en langage »
- Transformation d’un objet en langage
C’est ce que fait Marianne en transformant la robe en signe de sa noblesse ; mais un signe est-il suffisant pour être porteur de vérité ? Fonctionne-t-il pour cacher ou pour dévoiler ? cacher la roture ou dévoiler la noblesse ? Toute l’ambiguïté de Marianne se retrouve dans cette fonction de la robe-signe. Et cette ambiguïté se retrouve au niveau de la narratrice dans son discours : ce texte-tissu a-t-il pour fonction de dévoiler ou de cacher ? la question restera ouverte.
- Une technique
l’art de plaire est, comme l’art d’écrire, une technique : Marianne reconnaît son talent pour cela (p. 61 ou p.104 par ex ), talent inné dit-elle commun à toutes les femmes du reste, talent « qui peut se retrouver dans les femmes les plus sottes. C’est l’esprit que la vanité de plaire nous donne et qu’on appelle autrement dit, la coquetterie » (p. 113). La coquetterie est une technique en vue de susciter une réaction ; une rhétorique destinée à produire l’admiration : reportons ces propos sur la narratrice : elle n’est plus jeune, mais elle va poursuivre ce désir de plaire en écrivant, pour qu’on admire son esprit. Et elle met en place toute une rhétorique fondée sur l’arrangement de son histoire et sur l’effet produit.
Enfin, si c’est une femme que Marivaux a choisie pour narratrice, c’est justement pour que cette volonté de plaire, qui est celle aussi de tout écrivain, apparaisse comme naturelle, puisque pour lui, naturellement une femme fait tout pour cela. Et la forme de l’écriture ne sera pas apprêtée parce que précisément il faut montrer qu’on ne cherche pas à plaire pour mieux plaire (cf. Marianne). L’art de plaire consiste à cacher qu’on fait tout pour plaire, c’est-à-dire pour se montrer plaisante. Et voilà que sur le plan de l’écriture on retrouve le jeu cacher/dévoiler qu’on avait vu sur le plan des enjeux du comportement de Marianne.
Donc le vêtement, dans sa valeur de signe, comme dans la technique qu’il suppose et ce jeu du dévoilé/caché permet d’appréhender le livre dans son contenu comme dans sa forme (l’aspect souvent spontané de la forme étant lui aussi l’aboutissement stylistique recherché par Marivaux).