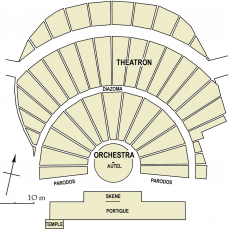Le paradis originel : l’Île des Bienheureux et l’Âge d’or
Les mythes antiques ont transmis la nostalgie d’un espace (temps / lieu) primitif où les hommes vivaient dans une harmonie parfaite avec la nature, sans peine ni contrainte. Ce « paradis » originel est un « jardin » (c’est précisément le sens du mot grec paradeisos) où tout vient à profusion : d’où aucun besoin, donc aucun travail, aucune envie, aucun conflit pour les heureux mortels qui y vivent en toute innocence, au sens premier du terme.
Les descriptions de ce locus amoenus (« lieu agréable » en latin) renvoient toutes à un espace compensatoire (l’homme s’y décharge symboliquement du poids de sa misérable condition) où l’eau et la clôture sont des images récurrentes fortement symboliques (l’espace primordial du ventre maternel, selon une interprétation psychanalytique rudimentaire) : bien entendu, l’île constitue ce lieu idéal « protégé » sous le double signe du liquide et du fermé. Ainsi dans sa deuxième Olympique (entre 490 et 446 avant J.-C.), le poète grec Pindare évoque le séjour des Bienheureux qu’il situe dans cette Hespérie (littéralement le pays du Soir) que représentait pour les Anciens l’extrémité occidentale du monde connu : « Les justes contemplent un soleil pur pendant la nuit, comme pendant le jour, et mènent une vie exempte de travaux, sans jamais fatiguer leur bras à fouiller la terre ou les profondeurs de la mer pour y chercher de misérables aliments. Mais ceux qui ont respecté leurs serments vivent mêlés aux favoris des dieux : ils ne versent pas de larmes, tandis que les parjures sont en proie à d’effroyables tourments. Puis, quand les hommes, après avoir habité trois fois dans l’un et dans l’autre monde, ont eu la force de tenir leur âme éloignée de toute injustice, alors ils suivent la route de Zeus jusqu’à la tour de Cronos ; et ils sont reçus dans l’Île des Bienheureux, que caressent les brises de l’Océan, et où rayonnent des fleurs d’or. » (traduction in Mythes grecs, Ariane Eissen, 1993). Cette Hespérie mythique, ce sera la Bétique de Fénelon et le pays « sauvage » de l’Arlequin de Delisle de la Drevetière (voir "Arlequin, une star en Utopie").
Dans le monde romain antique, c’est Saturne, divinité italique identifiée au Cronos des Grecs, qui aurait instauré le paradis de l’Âge d’or. Détrôné par son fils Jupiter (il a été sauvé par une ruse de sa mère Rhéa alors que Saturne, pour éviter de perdre le pouvoir, avait dévoré ses propres enfants), le dieu quitta la Grèce. Il vint s’installer sur le Capitole, à l’emplacement de la Rome future, où il fut accueilli par le dieu Janus. Saturne est donc considéré comme le roi des Aborigènes (les tribus primitives italiques), ancêtre des rois du Latium. Pendant toute la période de son règne, les hommes vécurent dans ce fameux Âge d’or devenu période mythique de félicité.
Dieu de la civilisation, Saturne enseigna aux hommes la culture de la terre, ce qui lui valait d’être honoré comme le dieu des vignerons et des paysans. Dieu des engrais, qui apportent au sol la fertilité, il présidait à l’ensemencement et protégeait les cultures, une fois qu’elles étaient confiées à la terre. Son attribut était une petite faux, qui lui servait à couper les moissons, à émonder les arbres, à tailler la vigne (il était représenté sous les traits d’un vieillard vêtu d’un ample manteau, sa petite faux à la main). Le mois de Décembre lui était dédié, car c’est l’époque où commence la germination, prélude lointain des moissons futures, et la fête des Saturnales consacrait le retour de son règne par un temps de licence carnavalesque.
Les Saturnales
Les Romains ont pratiqué « des formes de bonheur collectif dont certaines semblent constituer une sorte d’évasion des structures socio-politiques contraignantes, une recherche d’une dimension plus ou moins imprégnée d’un sacré diffus. Mais nous ne serions plus à Rome, si ces bonheurs collectifs n’étaient autorisés, légalisés, ritualisés par la société elle-même, comme si Rome avait senti le besoin de maintenir certaines soupapes visant à l’équilibre social. Comme bien d’autres sociétés traditionnelles, la société romaine a connu l’esprit de la fête, marquée par une certaine inversion des valeurs sociales. Mais elle a très soigneusement pris soin de limiter dans le temps cette sortie du quotidien. L’excès indispensable n’a jamais nui à l’ordre politique ni à l’action individuelle à Rome, le tempérament national y répugnait trop. Il est fort intéressant de constater qu’un certain nombre de rituels festifs, qui étaient l’occasion d’actes de transgression de l’ordre normal des choses, étaient fondés sur la pratique de travestis et de mascarades. » (Michel Meslin, L’Homme romain, Hachette 1978, rééd. Éditions Complexe, 1985).
La nostalgie de la vie « naturelle » des origines se manifeste dans ces ruptures rituelles avec le monde « civilisé » où « la fête est vécue comme le retour vers un monde sauvage, chaotique sinon primordial » (ibid.). C’est donc une sorte de retour à l’Âge d’or du temps mythique de Saturne (voir ci-dessus) que symbolise la fête des Saturnales (Saturnalia), célébrée lors de la clôture de l’année à partir du 17 décembre (l’année romaine primitive comptait dix mois, décembre - de decem, dix - étant donc le dernier), lorsque le grain stocké depuis la moisson était livré à la consommation. « On fêtait alors la levée d’un tabou frappant la nouvelle récolte. Des rites d’égalisation sociale, dans lesquels les maîtres servaient un banquet à leurs esclaves et le partageaient ensuite avec eux, marquaient dans chaque foyer une suspension du temps et des règles hiérarchiques. » (ibid.) - voir l’allusion de Sénèque à ce rite ancestral dans sa lettre sur les esclaves.
Pour un temps limité s’instaurait un état de totale liberté et d’égalité, à l’image du royaume de Saturne : « Non seulement les esclaves étaient servis par leurs maîtres, mais ils portaient leurs habits et des masques ; ils buvaient et jouaient ensemble aux dés. » (ibid.) Dans les garnisons, les légionnaires romains tiraient alors au sort un roi des Saturnales parmi les condamnés : paré des insignes royaux, il conduisait un important cortège pour aller se livrer en ville à toutes sortes de débordements orgiaques, autorisés par un « don spécial » de Saturne dont ce roi éphémère était l’incarnation terrestre. Après quelques jours de débauches collectives, le Saturne de la fête était mis à mort et tout rentrait dans l’ordre !
Par la suite, ce rituel, que l’on a pu rapprocher de l’Akitù (le Nouvel An babylonien), où l’on intronisait un roi de substitution, pendant que les esclaves devenaient provisoirement les maîtres, va se fondre avec les mascarades des calendes de janvier qui se répandront dans tout l’Empire romain à partir du IIIe siècle après J.-C. pour donner notre fête de Carnaval, de l’Épiphanie au mercredi des Cendres. On retrouve ainsi dans les festivités de Carnaval (de l’italien carnevale, « mardi gras », lui-même issu du latin médiéval carnelevare, « ôter la viande ») bien des aspects des Saturnales, entre autres la tradition du mannequin grotesque, Sa Majesté Carnaval, que l’on brûle le jour des Cendres. Quant aux masques, ils deviennent ici les signes tangibles d’un état « idéal », d’un bonheur impossible à atteindre dans les normes ordinaires imposées par la vie sociale.