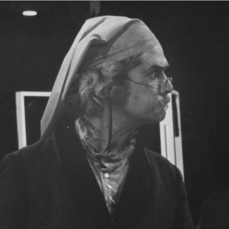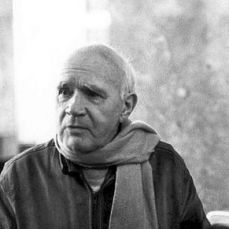Synthèse d’éléments tirés d’un ouvrage en préparation sur l’histoire des émotions au théâtre et au cinéma, rédigée en mars 2020
© Copyright 2020 Georges Forestier (Licence Creative Commons : diffusion et reproduction libres avec l'obligation de citer la source et l'interdiction de toute modification et de toute utilisation commerciale)
La tragédie est une imitation/représentation [mimèsis] d’une action noble, menée jusqu’à son terme et ayant une certaine étendue, au moyen d’un langage relevé d’assaisonnements d’espèces variées, utilisés séparément selon les parties de l’œuvre, imitation qui passe par les personnages du drame et non point par une narration, et qui en suscitant la pitié et la frayeur, opère la catharsis [épuration ou purgation] de ces mêmes émotions.
Aristote, La Poétique, Chapitre VI, 14 49 b 24-28
Le débat sur la catharsis n’en finit pas, et sans doute ne finira pas, n’en déplaise à l’auteur d’une récente étude dont le titre, « La véritable catharsis aristotélicienne1 », suggérait que son interprétation médico-physiologique du passage cité était de nature à mettre un terme définitif à l’affaire. On comprend qu’un contradicteur ait eu beau jeu de lui faire valoir2 que le caractère elliptique du passage de La Poétique consacré à la catharsis avait justement pour caractéristique d’autoriser depuis au moins quatre siècles une suite sans fin de débats interprétatifs qu’il serait vain de penser pouvoir trancher une fois pour toutes. Tant il est vrai que, comme le remarquait naguère Stephen Halliwell, « la controverse de la catharsis des cent cinquante dernières années a été marquée de la part de plusieurs interprètes, à un degré dont il est difficile de trouver un parallèle dans les études classiques, par un étalage de confiance en soi qui était pratiquement en proportion inverse de la qualité des témoignages à notre disposition sur le sujet3 », constat dont je reconnais d’autant plus la justesse que j’ai moi-même succombé à ce travers il y a quelques années4. C’est à ce titre que la position philologique de G. Scott et de C. W. Veloso5, tout isolée et extrémiste qu’elle peut être dans le concert de l’exégèse aristotélicienne, n’est pas sans intérêt du fait même de son caractère radical : décider que le membre de phrase contenant le terme catharsis serait une interpolation et qu’une édition « définitive » de La Poétique devrait supprimer une fois pour toutes le passage controversé semble en effet le seul moyen de mettre un terme à l’infini débat. Et il est bien vrai que, La Poétique s’apparentant plutôt à un ouvrage en gestation avec des parties plus ou moins rédigées issues de notes de cours, il n’est pas impossible que le terme ait été purement et simplement rajouté par les héritiers des papiers du philosophe à peu près à l’emplacement où ils se souvenaient que le maître avait l’habitude de parler de la catharsis. Un autre récent intervenant dans le débat a suggéré, pour clore avec modestie sa propre intervention sur la question, qu’Aristote lui-même et certains de ses successeurs auraient « cru au processus cathartique comme à un mythe6». La boutade en référence au beau livre de Paul Veyne n’exclut pas que la proposition, comme sur un autre plan celle de G. Scott et C. W. Veloso, puisse être prise au sérieux. Au demeurant, son auteur renvoyait à l’intelligente position d’un Pierre Corneille qui en 1660 se déclarait incapable de comprendre comment la catharsis pouvait opérer s’il fallait s’en tenir à l’interprétation exclusivement morale proposée à son époque – la « purgation des passions » considérée comme fin de la tragédie – et qui finissait par n’y voir qu’une belle invention d’Aristote pour répondre à la condamnation du théâtre qu’avait formulée son maître Platon dans La République7.
À ceci près que les doutes de Corneille avaient un sens face à un schéma de pensée qu’il voyait déboucher sur une impasse. Mais après trois siècles de réflexion philologique sur cette notion, nous n’en sommes plus là : adopter aujourd’hui une position sceptique ou carrément éradicatrice révèle que le débat sur la catharsis est empoisonné par un malentendu fondamental. La présentation des termes du débat donne l’impression que tout n’est qu’affaire d’interprétation, qu’il y a des « camps » interprétatifs8 qui s’opposent, chacun prenant tour à tour le pas sur les autres avant d’être temporairement relégué au second plan.
Il convient donc d’aborder le débat autrement. Mal placée, trop elliptique, manquant de cohérence avec le contexte, cette référence à une énigmatique catharsis n’en semble pas moins mettre en jeu une notion indispensable à tous ceux qui se penchent sur le fonctionnement et les effets de la tragédie – et plus largement des spectacles terrifiants que le cinéma et les séries télévisuelles ont progressivement développés depuis le XXe siècle. Elle paraît avoir du sens et être inscrite dans une appréhension cohérente du phénomène théâtral – du phénomène du spectacle en général. Reste à savoir quel sens et comment décrire le système dans lequel elle s’inscrit.
I. La catharsis comme malentendu
Considérer que l’existence ou l’effectivité de la catharsis puisse se situer sur le plan de la croyance est sans doute le plus clair indice de ce que le débat est empoisonné par un malentendu fondamental. Il tient au fait qu’avec la période contemporaine on est entré dans un nouvel âge de l’histoire des interprétations de la catharsis depuis que La Poétique a été redécouverte à la Renaissance.
Pour des raisons que nous verrons plus loin, la Renaissance a commencé par proposer une lecture morale de la catharsis, conçue comme une purgation des passions de l’âme, qui demeure mutatis mutandis dominante jusqu’à aujourd’hui. Cette idée, platonicienne puis chrétienne, selon laquelle le théâtre, pour être admis dans la société devrait avoir une fonction bénéfique, parut si évidente dans les sociétés encore largement chrétiennes de l’Europe du XIXe siècle, qu’on s’empressa d’oublier que plusieurs grands philologues français du XVIIIe siècle avaient proposé une explication de la catharsis non comme effet second (ou comme but de l’art tragique), mais comme processus9 interne à la réception de la fiction tragique ; cette explication dite « esthétique » vite oubliée, on revint à l’interprétation morale tout en inventant une nouvelle tradition interprétative à dominante médicale, tradition renforcée par le fait que la psychanalyse s’en est emparée pour faire de la catharsis le cœur de la psychothérapie. Dès lors, le conflit entre les deux courants, éthique et médical, a achevé d’enfouir complètement le souvenir de l’explication « esthétique » par les Français du XVIIIe siècle, au point que le retour de cette approche dans la deuxième moitié du XXe siècle sous l’impulsion de la grande édition de La Poétique par Dupont-Roc et Lallot est apparu et continue à être désigné comme une invention « moderne ». Il est significatif que, au cours des dernières décennies, les représentants des deux courants qui s’estiment « historiques » insistent sur cette prétendue « modernité », certains en tirant argument pour la juger moins légitime que les autres interprétations de la catharsis, et que seuls les spécialistes du XVIIIe siècle10 et quelques historiens des concepts esthétiques11 ont insisté sur l’ancienneté et la solidité de la réflexion des théoriciens français de l’âge des Lumières. J’y reviendrai.
Toujours est-il que ce nouvel âge de l’histoire des interprétations de la catharsis se caractérise par le fait que toutes les lectures du texte d’Aristote sont mises sur un même plan et qu’elles sont ainsi réparties en trois « camps », comme le rappelle Pierre Destrée dans son texte inaugural à un récent colloque, qui parle des camps « médical, esthétique et éthique12 ».
Pour comprendre le malentendu qui résulte de cette appréhension du débat et en mesurer la profondeur, il suffit de lire la première phrase de l’un des textes conclusifs au même colloque, dû à Carole Talon-Hugon : « Quel que soit le contenu donné à l’énigmatique notion de catharsis depuis Aristote, le phénomène désigné par ce mot consiste dans un effet extra-artistique produit par une expérience artistique13. » Un tel postulat révèle que, en fait, l’horizon de réflexion sur la question ne prend en compte que les interprétations éthique et médicale (avec toutes leurs ramifications et variantes et intersections, psychologiques, psychanalytiques, physiologiques) puisque ce sont ces deux traditions interprétatives qui se penchent sur la catharsis comme sur un effet extra-artistique. Or la troisième tradition interprétative – la lecture dite « esthétique », déjà proposée, j’y insiste, par les philologues français du XVIIIe siècle – dément catégoriquement ce postulat. La lecture esthétique explique justement, on va le voir, que, avant de désigner « un effet extra-artistique », la catharsis recouvre d’abord un phénomène qui est la condition même de réalisation de l’expérience artistique.
On aura compris que l’enjeu de la présente étude n’est pas de constater le malentendu ni de prétendre qu’une interprétation est meilleure que les autres. Il s’agit de tenter de dissiper le malentendu en montrant que les interprétations peuvent s’articuler entre elles pourvu qu’on comprenne qu’elles ne se situent pas sur le même plan14.
II. Cause du malentendu : l’évitement du paradoxe tragique
Il est, en effet, un point fondamental que les deux interprétations dominantes ne prennent pas (ou pas vraiment) en compte – comme si la chose allait de soi et comme si inversement Aristote était trop sérieux pour se préoccuper d’abord d’un processus intra-artistique qui (à première vue) n’offre pas matière à vaste spéculation philosophique. Ce point négligé est la résolution du paradoxe constitutif du plaisir tragique tel qu’il est défini par le philosophe : « le plaisir que doit produire le poète vient de la pitié et de la frayeur éveillées par l’imitation » (14, 53 b 21-24).
Or les lectures éthiques et médico-physiologiques ne peuvent pas faire l’économie de l’approche esthétique que je préfère appeler, pour ma part, « psychologico-esthétique ». Parce qu’il faut d’abord expliquer comment des émotions douloureuses peuvent se transmuer durant le cours de la représentation tragique en des émotions qu’on ressent en éprouvant du plaisir. Analyser la catharsis seulement comme un effet secondaire, destiné à purger l’âme et le corps du spectateur pour des raisons extérieures au plaisir tragique – ou destiné à lui apporter un bénéfice moral ou psychologique –, ne permet pas de résoudre cette question fondamentale : comment expliquer que lorsqu’un événement horrible s’accomplit sous nos yeux on est paralysé par une frayeur si insupportable et dévoré par des larmes si douloureuses qu’on veut vite s’en détourner, alors que le même événement horrible représenté provoque une frayeur et une pitié qu’on aime à ressentir. Posons la question en termes plus prosaïque et actuels : qu’ont pu ressentir les rares rescapés du naufrage du Titanic en regardant horrifiés depuis leurs canaux de sauvetage l’immense navire s’enfoncer dans l’océan en engloutissant vivants et morts, en écrasant et aspirant certains autres et en laissant la majorité périr d’hypothermie en quelques minutes ? et qu’ont ressenti en 1997 les spectateurs du Titanic de James Cameron, qui pour certains sont revenus vingt fois de suite dans la même salle de cinéma pour avoir à nouveau la gorge nouée de frayeur et verser des larmes de pitié ? C’est ce paradoxe-ci qu’il faut d’abord résoudre avant de se demander si le spectacle tragique peut avoir, en plus, des effets éthiquement ou physiologico-médicalement efficients sur le spectateur, donc des effets extra-artistiques.
On peut poser le problème autrement, car parmi les tenants des interprétations éthiques et médico-physiologiques certains ne méconnaissent pas le paradoxe, même s’ils sont conduits à le minimiser16. Si l’on réserve, comme ils le font en invoquant le texte de La Politique qui semble faire écho, le terme de catharsis au seul effet extra-artistique que leur paraît recouvrir la notion, comment nommer le phénomène de transmutation des émotions qui s’apparente pourtant bel et bien à une forme de purgation, purification, épuration comme on voudra ? pourquoi Aristote réserverait-il un terme ayant ces significations pour désigner un effet extra-artistique alors qu’il se penche dans sa Poétique sur les modalités uniquement artistiques des différents genres poétiques ? L’un des tenants de l’interprétation médicale demandait récemment si Aristote « aurait usé d’un terme imagé et aussi porteur de sens » pour désigner un simple phénomène esthétique17. Mais, justement, c’est là que réside tout le malentendu. Ce n’est pas un simple phénomène esthétique.
Encore une fois, n’est-ce pas rien de constater que les mêmes émotions ressenties devant un événement peuvent être douloureuses et quelquefois insupportables et devenir agréables lorsqu’elles sont provoquées par la représentation fictive de cet événement ? N’y a-t-il pas là un vrai problème philosophique susceptible d’attirer l’attention et la réflexion d’un penseur tel qu’Aristote ?
Car c’est un vrai problème philosophique, et il a été posé comme tel et par Platon et par saint Augustin – à ceci près que celui-ci l’a fait en termes chrétiens et que la condamnation (religieuse) qu’il a portée sur le phénomène a masqué l’extraordinaire clairvoyance avec laquelle il a posé le problème :
J’avais aussi en même temps une passion violente pour les spectacles du théâtre, qui étaient pleins des images de mes misères, et des flammes amoureuses qui entretenaient le feu qui me dévorait. Mais quel est ce motif qui fait que les hommes y courent avec tant d’ardeur, et qu’ils veulent ressentir de la tristesse en regardant des choses funestes et tragiques qu’ils ne voudraient pas néanmoins souffrir ? Car les spectateurs veulent en ressentir de la douleur ; et cette douleur est leur joie. D’où vient cela, sinon d’une étrange maladie d’esprit ? puisqu’on est d’autant plus touché de ces aventures poétiques que l’on est moins guéri de ses passions, quoique d’ailleurs on appelle misère le mal que l’on souffre en sa personne, et miséricorde la compassion qu’on a des malheurs des autres. Mais quelle compassion peut-on avoir en des choses feintes et représentées sur un théâtre, puisque l’on n’y excite pas l’auditeur à secourir les faibles et les opprimés, mais que l’on le convie seulement à s’affliger de leur infortune ; de sorte qu’il est d’autant plus satisfait des acteurs, qu’ils l’ont plus touché de regret et d’affliction ; et que si ces sujets tragiques et ces malheurs véritables ou supposés, sont représentés avec si peu de grâce et d’industrie qu’il ne s’en afflige pas, il sort tout dégoûté et tout irrité contre les Comédiens. Que si au contraire il est touché de douleur il demeure attentif et pleure, étant en même temps dans la joie et dans les larmes. Mais puisque tous les hommes naturellement désirent de se réjouir, comment peuvent-ils aimer ces larmes et ces douleurs ?
[…] J’étais alors si misérable que j’aimais à être touché de quelque douleur et en cherchais les sujets, n’y ayant aucunes actions des Comédiens qui me plussent tant, et qui me charmassent davantage que lorsqu’ils me tiraient des larmes des yeux, par la représentation de quelques malheurs étrangers et fabuleux qu’ils représentaient sur le théâtre. Et faut-il s’en étonner, puisque étant alors une brebis malheureuse qui m’étais égarée en quittant votre troupeau, parce que je ne pouvais souffrir votre conduite, je me trouvais comme tout couvert de gale ? Voilà d’où procédait cet amour que j’avais pour les douleurs, lequel toutefois n’était pas tel que j’eusse désiré qu’elles eussent passé plus avant dans mon cœur et dans mon âme. Car je n’eusse pas aimé à souffrir les choses que j’aimais à regarder : mais j’étais bien aise que le récit et la représentation qui s’en faisait devant moi m’égratignât un peu la peau, pour le dire ainsi, quoique ensuite, comme il arrive à ceux qui se grattent avec les ongles, cette satisfaction passagère me causât une enflure pleine d’inflammation, d’où sortait du sang corrompu et de la boue. Telle était alors ma vie : mais peut-on l’appeler une vie ? mon Dieu18.
Le ton de saint Augustin conduit presque toujours à déplacer ce texte du côté des réflexions sur la question dite, depuis le XVIIe siècle, de la « moralité du théâtre19 » et plus généralement de la condamnation de la fiction. Mais au départ ce n’est pas cela qui est en jeu : ce qui est scandale moral pour un chrétien – le scandaleux plaisir ressenti aux émotions est ce qui arrive lorsqu’on mène une vie sans Dieu –, et ce qui était déjà un problème éthique pour un Platon, qui reprochait à la tragédie de nous donner le plaisir de ressentir des émotions20, est d’abord un problème philosophique qui requiert une réponse philosophique ; en l’occurrence une réponse de nature psychologique. Ce phénomène que saint Augustin présentait comme « une étrange maladie d’esprit » – le fait que les hommes « veulent ressentir de la tristesse en regardant des choses funestes et tragiques qu’ils ne voudraient pas néanmoins souffrir » et qu’ils « veulent en ressentir de la douleur ; et [que] cette douleur est leur joie » –, Aristote avait tenté de trouver les termes adéquats pour le poser comme un problème et pour le résoudre.
À mon sens, parmi ses réponses, massivement disparues du fait de l’état de non achèvement de La Poétique, Aristote avait envisagé l’existence d’un phénomène (qu’il estimait de nature quasi médicale et que nous disons aujourd’hui d’ordre psychologique) qui au théâtre transforme la douleur en joie. Un passage qui faisait écho à celui de la Politique. C’est bien ce que concluait récemment Stephen Halliwell :
Quelle qu’en soit notre interprétation, la catharsis était sûrement une partie de la réponse d’Aristote à un vieux débat grec, ou un ensemble de débats, sur le pouvoir émotionnel de la musique et de la poésie, entre autres le pouvoir paradoxal qu’ont de tels arts d’offrir à l’esprit une profonde satisfaction par le biais de la description de la souffrance humaine21.
En définitive, pour en revenir aux « camps » interprétatifs dont parle P. Destrée, il n’y a donc pas trois « camps », mais deux : le vaste « camp » de tous ceux pour lesquels la catharsis décrirait un effet extra-artistique, et le petit camp de ceux qui l’analysent d’abord comme une opération inhérente au fonctionnement même des émotions esthétiques. Reste que les choses ne sont pas si simples, car le « camp esthétique » ne recouvre pas une seule position interprétative. Les principaux représentants du camp esthétique estiment que la catharsis tragique réside dans le décodage de la structure tragique elle-même et plus largement qu’Aristote s’en tient au plaisir procuré par la structure formelle d’une belle tragédie qui transfigure des émotions douloureuses en émotions agréables (point de vue majoritaire synthétisé dans l’édition de R. Dupont-Roc et J. Lallot).
Mais on peut aussi estimer (ce qui est mon point de vue) que la catharsis tragique est un phénomène de psychologie du public dans son rapport à l’expérience de la représentation des fictions, et non une propriété de la structure de l’intrigue tragique. Car on ne voit pas en quoi une « belle intrigue » de tragédie serait la garantie exclusive que les émotions sont transfigurées : les spectateurs qui versent des torrents de larmes en assistant à un spectacle médiocre ne sont pas le lieu d’une opération d’ordre cognitif qui, par la sensation de beauté, ferait comprendre qu’il s’agit d’un spectacle imitatif / ils sont le lieu d’un phénomène d’ordre psychologique, selon lequel c’est la conscience seule d’assister à une fiction qui assure l’amortissement cathartique d’émotions autrement insupportables. Contrairement à ce qu’affirmait récemment Sophie Klimis (2003, p. 474) on ne contemple pas une tragédie comme un tableau…
En même temps, les positions bougent : Stephen Halliwell, l’une des plus considérables autorités aristotéliciennes dans le monde anglo-saxon, en a longtemps exclusivement tenu pour l’interprétation éthique ; il reconnaît lui-même dans une étude assez récente que « dans l’interprétation de la catharsis, il est malencontreux de dissocier la psychologie de l’éthique et de détacher l’éthique de l’esthétique », ajoutant que « Si nous employons la catégorie d’esthétique, comme je propose de le faire, pour désigner la philosophie de l’art (mimétique), il s’ensuit qu’en ce sens la catharsis aristotélicienne est un concept esthétique. Mais cela ne veut pas du tout dire qu’il s’agit d’un concept dénué de signification éthique22 ».
Tel est le malentendu que je souhaiterais tenter ici de dissiper en montrant qu’il est le résultat de l’attention quasi exclusive portée à la lecture éthique de la catharsis par les interprètes d’Aristote depuis la Renaissance. Car lorsque Aristote écrit au livre VIII de La Politique : « Pour le mot catharsis, nous l’utilisons ici sans commentaire, mais nous en parlerons plus clairement dans les livres sur la poétique 23», cela semble signifier que La Poétique, telle qu’elle aurait pu nous parvenir si elle avait été achevée (ou si elle n’avait pas été mutilée), devait expliciter la notion de catharsis en plusieurs lieux du traité. Au moins deux lieux : celui où devait être expliqué comment des émotions douloureuses sont purgées de leur substrat douloureux pour être ressenties comme des émotions agréables ; celui, éventuel, où pouvait être expliqué comment sur certains sujets sensibles les émotions douloureuses peuvent être à la fois source de plaisir et en même temps source de « guérison », morale ou physiologique ; et peut-être un troisième passage, où aurait été esquissée l’idée qu’on aurait attendu plutôt dans La Politique, de la valeur éthique du processus cathartique pour les citoyens d’une cité comme Athènes24.
III. Origine du malentendu : les fins de la tragédie selon Aristote
Nous allons traiter de l’art poétique en lui-même, de ses espèces, considérées chacune dans sa finalité propre, de la façon dont il faut composer des histoires si l’on veut que la poésie soit réussie, en outre du nombre et de la nature des parties qui la constituent, et également de toutes les autres questions qui relèvent de la même recherche. (14 47 a 8-12)
Deux choses sont particulièrement claires si l’on veut bien lire cette phrase inaugurale de La Poétique sans idée préconçue. Tout d’abord, on ne devrait pas reprocher à Aristote « une méconnaissance, voire un déni de la nature propre du théâtre en tant que représentation scénique », comme on le fait volontiers25 : il s’intéresse dans ce traité aux différentes « espèces » de l’art poétique, à leur « finalité propre » et « à la façon dont il faut composer les histoires (muthos) si l’on veut que la poésie soit réussie26 ». Dans ce cadre, la tragédie n’est envisagée que comme l’une des espèces de la poésie et l’une des réalisations possibles des différentes formes de muthos, et c’est parce que ce traité nous est parvenu de manière très incomplète (à moins qu’il ne s’agît que d’un brouillon inachevé) que ce texte est souvent ramené à une réflexion sur la seule tragédie. Et si la tragédie en tant que représentation scénique est secondaire dans ce livre, ce n’est nullement par méconnaissance – Aristote était lié à Théodecte, l’auteur tragique le plus connu de son temps, et il a au moins entendu la voix de Théodore, célèbre acteur tragique, puisqu’il en parle dans sa Rhétorique –, mais parce que, selon la focale adoptée par le philosophe, donc du point de vue de l’art poétique, tout ce qui touche à la représentation scénique est extérieur à l’art de la composition du muthos, qui est l’objet du traité ; au demeurant, ne renvoie-t-il pas à sa Rhétorique pour ce qui touche à l’art de l’acteur (hupocrisis27) ? Aussi peut-il sans paradoxe donner à entendre que la tragédie est imitation/représentation (mimèsis) même lorsqu’elle n’est pas représentée. Non point parce qu’Aristote ne serait qu’un « lecteur », selon le jugement qu’aurait porté sur lui Platon ; mais parce que dans le cadre d’une réflexion sur les différentes espèces de la mimèsis poétique, la tragédie doit être évaluée sur le même plan que l’épopée. La meilleure tragédie, c’est le meilleur muthos possible, eu égard aux modalités propres du genre, au premier rang desquelles « sa finalité propre » (ou « son pouvoir propre », si l’on veut traduire autrement dunamin ekaston), sur laquelle je vais revenir.
En second lieu, cette phrase ne laisse aucun espace pour une réflexion sur les enjeux extra-poétiques de la poésie. Comme le reconnaissait Elizabeth Belfiore en ouverture à une étude récente,
Chacun sait que la Poétique d’Aristote ne parle pas de l’effet moral produit par la tragédie sur son public, contrairement à la République de Platon.
Mais elle ajoutait tout aussitôt, en bonne représentante du « camp éthique » :
Néanmoins, nous avons de bonnes raisons de supposer que dans cette œuvre, Aristote considère la tragédie comme moralement bénéfique28.
Certes, on peut le supposer – et j’en suis personnellement persuadé –, mais c’est une implication du même ordre que celle que proposait Corneille lorsqu’il concédait qu’une œuvre qui donnait du plaisir devait être automatiquement bénéfique :
Ainsi ce que j’ai avancé dès l’entrée de ce Discours, que la poésie dramatique a pour but le seul plaisir des spectateurs, n’est pas pour l’emporter opiniâtrement sur ceux qui pensent ennoblir l’art, en lui donnant pour objet, de profiter aussi bien que de plaire. Cette dispute même serait très inutile, puisqu’il est impossible de plaire selon les règles, qu’il ne s’y rencontre beaucoup d’utilité29.
On s’étonne aussi qu’Aristote ne laisse aucun espace au politique, dans la mesure où un des lieux communs les plus en vogue depuis le XXe siècle veut que dans la Grèce ancienne et particulièrement à Athènes le théâtre, et au premier chef la tragédie, ait été un art politique.
Ainsi, de présupposé en présupposé, on en vient à considérer qu’on serait en présence d’un point aveugle de La Poétique, derrière lequel se cacherait nécessairement ce qui échappe à l’évidence. Autrement dit, Aristote affirme n’envisager rien d’autre qu’une réflexion de nature poéticienne et il n’assigne donc aucun enjeu extra-artistique à la tragédie, mais en fait, suppose-t-on, il ne pouvait pas ne pas laisser entendre dans ce traité qu’il faut prendre en compte les fonctions extra-scéniques de la tragédie. Et cette idée, il l’aurait résumée d’un mot quelque peu énigmatique auquel on prête depuis le XVIe siècle une grande plasticité sémantique : la catharsis. Devenu un mot quasiment magique.
Revenons donc à la phrase qui le contient et demandons-nous si Aristote passe en revue successivement objet imité, types de discours, mode énonciatif, et pour finir processus émotionnel ; ou s’il considère le dernier point non comme un processus, mais comme la fin recherchée par la tragédie. L’enjeu de la divergence est considérable, ne serait-ce que pour la question fondamentale du plaisir « esthétique » : celui-ci est-il la fin de l’opération artistique, ou n’est-il que la condition sine qua non d’un phénomène dont le but serait la purgation des émotions ?
Il convient donc de se demander ici si Aristote se posait dans La Poétique la question de la fin de la tragédie. Rappelons tout d’abord qu’il estimait que les arts figuratifs, ceux qui « imitent » (c’est-à-dire représentent) les actions des hommes, procurent du plaisir à ceux qui les contemplent car c’est une pente naturelle à la nature humaine de trouver du plaisir aux représentations. Or le plaisir commun à tous les arts imitatifs revêt des espèces particulières à chaque art, qui résulte de ses modalités propres. Dès lors, dans la mesure où la modalité fondamentale de la tragédie consiste à représenter les malheurs de héros et susciter de ce fait des émotions chez les spectateurs, on conçoit que le plaisir éveillé par la représentation de la tragédie soit un plaisir d’une nature particulière. Un « plaisir propre », comme il le dit au chapitre XIV de la Poétique :
Car ce n’est pas n’importe quel plaisir qu’il faut demander à la tragédie, mais le plaisir qui lui est propre. Or, comme le plaisir que doit produire le poète vient de la pitié et de la frayeur éveillées par l’imitation, il est évident qu’il doit composer en inscrivant cela dans les actions. (XIV, 53 b 21-24)
Autrement dit, une tragédie a atteint sa fin lorsqu’elle présente une intrigue « imitative » disposée de telle sorte qu’elle puisse susciter chez le spectateur des émotions particulières qui lui font ressentir du plaisir.
Notons bien au passage qu’Aristote ne dit pas que le plaisir est la finalité du genre de la tragédie. Nulle part il ne pose vraiment la question de savoir « à quoi sert la tragédie ». C’est une question qu’avait agitée Platon pour qui la tragédie était un art dangereux, source de fausseté en tant qu’imitation du monde sensible et source d’ambiguïté dans le rapport du discours à la vérité, puisque tout discours dialogique est nécessairement contradictoire. Mais c’est surtout une question qui se posera avec acuité à l’ère moderne, dès lors que les poètes ont souhaité faire revivre un genre disparu, c’est-à-dire un genre a priori privé de toute tradition (donc de toute légitimité) civile et religieuse dans les sociétés européennes de la Renaissance. Pour Aristote, la question de la légitimité de la tragédie ne se pose pas : c’est un fait culturel (à l’origine cultuel et rituel) qu’il accepte comme tel, et aussi, en tant qu’art « représentatif », un fait naturel auquel il prête une valeur éducatrice ; comme il l’explique par la formule « la tragédie est plus philosophique que l’histoire », la tragédie possède même, en tant qu’art de composition qui réorganise la matière brute donnée par le réel afin de la rendre intelligible, une dimension méditative (gnoséologique) que ne possède pas la chronique historique entièrement soumise aux faits et qui est aussi source de plaisir. C’est donc aussi un fait, et non une finalité, que la tragédie produit du plaisir : plaisir imitatif – qu’elle partage avec les autres arts représentatifs – qui se double d’un plaisir propre, le plaisir émotif, dont l’intensité et la qualité dépendent de l’art du poète.
IV. La fabrication du malentendu : la confusion des passions à la Renaissance (purger TOUTES les passions)
On sait que pour Aristote qui a théorisé les passions aussi bien dans son Éthique que dans sa Rhétorique, tous les affects dont l’homme est touché et qui modifient son esprit et son jugement sont appelés passions. Et comme il le précise dans ses Politiques, « les émotions que ressentent avec force certaines âmes se retrouvent en toutes avec moins ou plus d’intensité […]30. » La colère est évidemment une passion, comme le sentiment amoureux, l’orgueil, l’ambition ou le sentiment de la vengeance. Mais aussi comme la crainte et la pitié, deux passions que l’on éprouve tout particulièrement lorsque surviennent des malheurs : on craint pour soi devant la menace que constitue le malheur ; on éprouve de la pitié pour celui qui subit un malheur qu’il ne mérite pas. Représentation de malheurs, la tragédie vise donc à éveiller chez le spectateur ces deux passions particulières. En soi, l’idée n’est pas nouvelle, puisqu’on la trouvait déjà dans un fragment de Gorgias intitulé Éloge d’Hélène, où il expliquait que la poésie (probablement entendait-il la poésie tragique) pénètre ses auditeurs de troubles émotionnels (pathèmata), « du frisson de la crainte, ou de cette pitié qui arrache des larmes, ou de ce regret qui éveille la douleur, lorsque sont évoqués les heurs et les malheurs que connaissent les autres dans leurs entreprises31 ». Et Platon avait dit à son tour dans Phèdre que la tragédie est apte à « manier à son gré la pitié ou au contraire la terreur et la menace et tous les sentiments du même genre. »
Ce qui est nouveau, c’est qu’Aristote, tout en ramenant à deux les passions propres à la tragédie – on tremble et on pleure –, cherche à comprendre et à théoriser leurs conditions d’apparition, de façon à permettre aux poètes de les toucher à coup sûr – ce qui est l’objet des principaux chapitres de la Poétique – ; c’est aussi que son raisonnement s’inscrit dans une réflexion générale sur la place des passions dans le discours – qui était au cœur de sa Rhétorique –, tout en s’efforçant de dégager la spécificité des passions propres à la tragédie. Ce qui est nouveau, enfin, c’est qu’il insiste sur le fait que ces deux passions, qu’il décrit ailleurs comme du côté de la douleur et non du plaisir, peuvent justement susciter du plaisir chez celui à qui la tragédie les fait éprouver.
Mais si tous les commentateurs d’Aristote, de la Renaissance au XVIIe siècle, ont bien vu que le philosophe s’attachait exclusivement dans sa Poétique à la pitié et à la frayeur, la plupart d’entre eux n’ont pu se résigner, du fait de leur formation rhétorique32, à les détacher de l’ensemble des passions, tant il est vrai que sur le plan éthique, il n’y a pas de différence entre les passions – tout ce qui est mouvement ou perturbation de l’âme étant passion. En outre, même dans sa Poétique, le raisonnement du philosophe s’inscrit dans une perspective rhétorique. Dans la mesure, en effet, où la poétique est la transposition au discours fictif de l’art de persuader qu’est la rhétorique, le poète tragique doit raisonner comme l’orateur qui cherche à émouvoir ses auditeurs en jouant sur les passions qui peuvent les atteindre. De ce point de vue, un spectateur est dans la même position que l’auditeur d’un discours oratoire : il doit être le sujet de mouvements de l’âme qui subjuguent sa raison.
À ceci près, cependant, qui fait toute la différence entre discours oratoire et discours théâtral : dans le premier cas, les passions dont on cherche à émouvoir l’auditeur font partie du processus persuasif auquel elles contribuent autant que la narration des faits, les preuves ou les raisonnements ; la persuasion est le terme, les passions ne sont qu’un des moyens d’y parvenir (il faut émouvoir l’assemblée ou le tribunal), de même que le plaisir procuré par la beauté stylistique et ornementale du discours. Dans le cas de la tragédie, le phénomène est inverse. Ce sont les passions du spectateur qui sont la fin de la persuasion. La persuasion consiste à rendre croyable au spectateur la fiction mimétique de telle sorte qu’il puisse éprouver les deux passions tragiques et ressentir ainsi le plaisir propre à la tragédie. Citons à nouveau ce qu’il écrivait au chapitre XIV de la Poétique :
Car ce n’est pas n’importe quel plaisir qu’il faut demander à la tragédie, mais le plaisir qui lui est propre. Or, comme le plaisir que doit produire le poète vient de la pitié et de la frayeur éveillées par l’imitation, il est évident qu’il doit composer en inscrivant cela dans les actions. (XIV, 53 b 21-24)
Or, dans la mesure où plus fort est l’effet de croyable, plus fort sera le pathétique propre à l’art de la tragédie, les passions éprouvées par les personnages de la fiction entrent de leur côté dans le processus persuasif au titre du vraisemblable ou du nécessaire : dans telle ou telle situation un homme ressent habituellement tel ou tel mouvement de l’âme ; dès lors, un personnage de fiction présenté dans une situation de même type devra manifester qu’il éprouve un même type de passion, si l’on veut que l’effet de croyable (le processus persuasif dans le cadre d’une fiction) soit le plus fort possible. Les passions « internes », celles qui sont prêtées aux personnages, sont donc l’une des conditions de la production des passions « externes », celles qu’il faut faire éprouver aux spectateurs.
Précisons que ce n’est pas une condition indispensable comme Aristote l’explique avec netteté au chapitre VI de la Poétique, célèbre développement qu’il faut compléter par un autre passage du chapitre XIV où il explique que le système des faits doit être disposé de telle sorte qu’un auditeur éprouvera les émotions tragiques en écoutant simplement le récit des événements :
La frayeur et la pitié peuvent assurément naître du spectacle, mais elles peuvent naître aussi du système des faits lui-même : c’est là le procédé qui tient le premier rang et révèle le meilleur poète. Il faut en effet qu’indépendamment du spectacle l’histoire soit ainsi constituée qu’en apprenant les faits qui se produisent on frissonne et on soit pris de pitié devant ce qui se passe : c’est ce qu’on ressentirait en écoutant l’histoire d’Œdipe34.
Dans la mesure où les deux passions tragiques peuvent et doivent être inscrites dans la dispositio même de l’intrigue – le poète doit disposer les événements dans le but d’émouvoir –, le système des faits se suffit à lui-même, sans que les « caractères », et donc les passions « internes », aient besoin d’intervenir dans le processus émotif. C’est pourquoi, lorsque Aristote passait en revue les six parties de la tragédie, il plaçait les caractères en second. Et c’est pourquoi, enfin, lorsqu’il s’est attaché aux caractères, assez brièvement, il n’est pas entré dans le détail des passions qu’ils peuvent ou doivent éprouver : c’eût été inutile dans le cadre d’une poétique, puisque deux autres sciences, la rhétorique et la morale, s’y emploient par ailleurs.
*
Il est frappant d’observer qu’il ait fallu attendre Corneille et Racine – des praticiens de la tragédie qui ont théorisé leur pratique dans leur relation à Aristote – pour rencontrer des auteurs capables de penser le système des passions dans la tragédie selon un raisonnement approprié à la tragédie, c’est-à-dire un raisonnement de nature poétique qui distingue l’intérieur et l’extérieur. Il y a d’une part la pitié et la frayeur, qui sont appelées par Corneille « les deux passions de la tragédie » et par Racine dans la préface d’Iphigénie « les véritables effets de la Tragédie », parce qu’elles sont suscitées par le spectacle du conflit tragique, comme on le voit sur le frontispice des différentes éditions des Œuvres de Racine, où, de part et d’autre de la Muse de la tragédie, deux putti figurent les spectateurs qui contemplent une scène tragique, l’un manifestant sa frayeur et l’autre essuyant ses larmes. Et dans le cadre de ce conflit tragique, il y a les passions que ressentent les personnages soit en s’affrontant soit en contemplant le désastre que produit le conflit qui les touche directement.
Si cette répartition n’a paru claire qu’à Corneille et Racine, c’est pour de multiples raisons : il y a le fait que jusqu’au XVIIIe siècle un même vocable – les passions – désigne les émotions que doivent ressentir les spectateurs et les affects fictifs qui sont prêtés aux personnages de la fiction ; le fait que ceux-ci peuvent influer sur celles-là ; le fait surtout que la tragédie a longtemps été conçue comme un art moral « qui a pour but la tranquillité de l’Âme puisque sa fin principale est de calmer les passions35 ». Mais, au fond, la source de cette confusion est unique : elle tient à ce que les poétiques de la Renaissance ont pour la plupart été conçues d’après le modèle rhétorique, y compris lorsqu’elles prétendaient gloser la Poétique d’Aristote.
C’est cela qui explique que les poétiques de la Renaissance et du XVIIe siècle – à l’exception notable de celles du Tasse et de Heinsius – se soient détachées si nettement d’Aristote. Plus exactement, elles ont suivi l’Aristote de la Rhétorique tel qu’il avait été complété et prolongé par Cicéron et Quintilien, sans voir les nuances capitales apportées par la Poétique sur le plan de la spécificité des passions tragiques et sur celui du caractère dispensable des passions internes dans le processus émotif.
Le développement des poétiques modernes dans le cadre de l’empire rhétorique se laisse aisément percevoir dans les quatre textes suivants, qui figurent autant d’étapes dans le parcours qui conduit à l’indistinction des passions et au brouillage de la hiérarchie établie par Aristote – brouillage que Corneille et Racine pour leur part sauront éclaircir.
Dans un passage célèbre de son Brutus, Cicéron décrivait ainsi la manière dont l’auditoire doit être transporté par les diverses passions sous l’effet de la parole du bon orateur :
[…] Il [l’auditeur] se réjouit, il se désole, il rit, il pleure, il accorde sa faveur, il méprise, il envie, il est poussé à la miséricorde, à la honte, au chagrin, il se met en colère, il s’étonne, il espère, il craint.36
Or comment Du Bellay définira-t-il le poète idéal dans sa Défense et illustration de la langue française ?
Celui sera véritablement le Poète que je cherche en notre Langue, qui me fera indigner, apaiser, éjouir, douloir, aimer, haïr, admirer, étonner, bref, qui tiendra la bride de mes affections, me tournant çà et là à son plaisir. Voilà la vraie pierre de touche, où il faut que tu éprouves tous poèmes, et en toutes langues.37
Ce phénomène de transposition a été remarqué depuis longtemps et il a été naguère rappelé par Gisèle Mathieu-Castellani dans son petit livre consacré à La Rhétorique des passions38. On discerne où il conduit : dans la mesure où la poésie est une, ses diverses espèces obéissent à la même logique et le poète tragique, s’il se veut poète, devra rechercher les mêmes effets que le poète idéal défini par Du Bellay. On aboutit ainsi au principe de « l’enfilure » défini par Montaigne :
Et il se voit plus clairement aux théâtres, que l’inspiration sacrée des muses, ayant premièrement agité le poète à la colère, au deuil, à la haine, et hors de soi où elles veulent, frappe encore par le poète l’acteur, et par l’acteur consécutivement tout un peuple. C’est l’enfilure de nos aiguilles, suspendues l’une de l’autre.39
Cette conception de la chaîne communicative des passions, qui s’étend depuis la composition par le poète jusqu’à la réception par les spectateurs, en passant par la déclamation des comédiens, se retrouve longuement développée en 1639 dans la Poétique de La Mesnardière :
Le Poète se les [les passions violentes] figure avec tant de réalité durant la composition, qu’il ressent la Jalousie, l’Amour, la Haine, et la Vengeance avec toutes leurs émotions, tandis qu’il en fait le tableau. Le coloris qu’il y emploie, est, s’il en faut parler ainsi, une Passion extensible, qu’il tire de sa Fantaisie, et qu’il couche sur le papier à mesure qu’il la décrit. Ensuite l’excellent Acteur épouse tous les sentiments qu’il trouve dans cet ouvrage, et se les met dans l’esprit avec tant de véhémence, que l’on en a vu quelques uns être si vivement touchés des choses qu’ils exprimaient, qu’il leur était impossible de ne pas fondre en larmes, et de n’être point abattus d’une longue et forte douleur, après avoir représenté des aventures pitoyables. Enfin l’Auditeur honnête homme, et capable des bonnes choses, entre dans tous les sentiments de la Personne théâtrale que touche ses inclinations. Il s’afflige quand elle pleure : il est gai lorsqu’elle est contente ; si elle gémit, il soupire ; il frémit si elle se fâche ; bref il suit tous les mouvements, et il ressent que son cœur est comme un champ de bataille, où la science du Poète fait combattre quand il lui plaît mille Passions tumultueuses, et plus fortes que la Raison. (p. 73-74)
La Mesnardière a beau conférer une couleur théâtrale à sa description, son texte n’en demeure pas moins rhétorique de bout en bout, dissociant sur les figures distinctes du poète et de l’acteur ce que Cicéron ou Quintilien disaient de la manière dont l’orateur devait lui-même éprouver dans l’inventio et exprimer dans l’actio les passions qu’il voulait faire ressentir par le juge.40
Du coup, le théoricien a beau prétendre adapter la Poétique d’Aristote à l’usage des poètes français, et reprendre l’idée que les deux passions principales de la tragédie sont la pitié et la frayeur : il commence à se livrer à un subtil distinguo, recommandant en tous poèmes tragiques la pitié qui fait verser les larmes et réservant la frayeur (qu’il appelle généralement terreur) pour les pièces qui mettent en scène de grands crimes41, distinguo qui révèle qu’il n’envisage pas ces deux émotions d’un point de vue poétique et qu’il les envisage d’un point de vue rhétorique, comme deux passions dissociables, parmi toutes celles que selon lui peut éveiller la tragédie.
V. Théorisation du malentendu : purgation morale et purgation médicale
Ce problème fondamental de l’indistinction des passions, fondamental en ce qu’il retentit sur l’interprétation même du genre tragique, ne se serait évidemment pas posé aux hommes de la Renaissance et du XVIIe siècle si Aristote avait expliqué dans sa Poétique que la frayeur et la pitié doivent subir une opération particulière, d’une part pour produire du plaisir – car, encore une fois, ce sont des passions qui, au plan éthique, sont considérées comme douloureuses –, d’autre part pour se distinguer de l’ensemble des passions qui peuvent entrer en jeu dans une tragédie. Or, alors même que la catharsis semble être présentée dans le célèbre passage du chapitre VI comme ce qui caractérise précisément l’exercice des passions spécifiques à la tragédie, le caractère elliptique du passage a justement conduit les commentateurs de la Renaissance et leurs successeurs à conforter leur conception rhétorique de l’indistinction des passions.
Ainsi La Mesnardière appuyait-il son idéal d’une tragédie multi-passionnelle sur l’interprétation morale de la catharsis aristotélicienne. Il l’annonçait dès son Discours préliminaire :
[…] la tragédie se propose pour son but la tranquillité de l’âme, puisque sa fin principale est de calmer les passions.
C’est qu’il faut bien, dans une société chrétienne qui réclame la tempérance des passions et dont la frange la plus austère condamne le théâtre présenté comme une école des passions vicieuses, justifier un art qui prétend pousser son destinataire à épouser toutes les passions éprouvées par des personnages violemment passionnés. Et c’est la même raison qui l’a invité à insérer, au beau milieu de son chapitre sur « Les Mœurs », une série de « Controverses Théâtrales » dirigées contre Castelvetro, et à s’opposer violemment à l’idée selon laquelle « la Poesia e stata trovata principalmente per diletto, e non per utilita, come Aristotele ha mostrato » (p. 164).
En fait, La Mesnardière ne faisait que revenir sur une ancienne dispute qui avait divisé les Italiens du XVIe siècle sur la question de savoir si la fin de la tragédie était l’instruction ou le plaisir. Car l’enjeu était le même un siècle plus tôt : à l’origine, il s’agissait de donner une légitimité à l’art profane dans le cadre de l’Église chrétienne, problème devenu véritablement essentiel à partir du milieu du siècle, à l’heure de la Contre-Réforme catholique. Et La Mesnardière tranchait de la même manière que l’écrasante majorité de ses prédécesseurs transalpins, en considérant que le plaisir n’est que « la voie dont se sert toute la Poésie pour instruire ses Auditeurs », invoquant les vers d’Horace – « Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci / Lectorem delectando, pariterque monendo » – pour les rapprocher de deux passages de la Poétique d’Aristote, l’un où il explique les hommes ont plaisir à s’instruire (chap. IV), l’autre qui est celui de la fameuse catharsis, interprété comme un effet moral.
On comprend donc ce qui a conduit la majorité des savants italiens et français à trancher en faveur de « l’instruction ». C’est qu’Aristote parle certes de plaisir, mais qu’il en parle presque toujours dans des phrases qui lient ce plaisir à la présence des deux passions tragiques. Or, outre qu’il ne semble pas expliquer comment il est possible que des passions douloureuses comme la pitié et la frayeur puissent se transmuer en source de plaisir, il lie ce terme d’origine médicale, la catharsis ou « purgation », à la production de ces passions. Il était donc facile d’articuler ces deux difficultés en appelant à l’aide perspective rhétorique et interprétation morale. La morale chrétienne, qui enseignait que les passions, loin d’être de simples mouvements de l’âme, sont des sortes de maladies spirituelles qui rendent l’homme esclave et le renforcent dans son état de pécheur, et qu’elles doivent donc être dominées ou éliminées42, trouvait dans l’idée d’une purgation des passions un argument pour accepter que la tragédie mît ces mêmes passions sur la scène et que certains pussent la présenter comme un art à fin morale. C’est à ce compte qu’en 1675 un jésuite proche de Racine a pu écrire que « La Tragédie est une peinture de la vie civile qui a été inventée pour le règlement des passions43 ». De son côté, la perspective rhétorique, qui liait étroitement ses trois finalités – placere, movere, docere (plaire, émouvoir, instruire) –, faisait du placere un auxiliaire des deux autres. Autrement dit, le plaisir dont parlait Aristote paraissait devoir être compris comme la condition de la purgation des passions.
Certes, Aristote parlait des seules passions tragiques. Mais l’ambiguïté de la formule employée – la purgation « de ces mêmes passions » peut se lire comme la purgation « des passions du même genre » –, jointe au phénomène de subversion de la poétique par la rhétorique dont j’ai parlé plus haut, permettait de comprendre en définitive : « purgation de toutes les passions du même genre ». Bref, un Aristote ainsi entendu allait finalement plus loin qu’Horace sur la voie de la moralisation de l’art – non point afin de rendre l’art moral mais pour justifier son caractère moral quasiment par essence.
On comprend qu’on puisse ainsi aboutir à la phrase fondatrice de ce qu’on devait appeler plus tard le système classique. Jean Chapelain, le plus grand théoricien français du XVIIe siècle, écrivait ceci en 1630 dans sa fameuse « Lettre sur la règle des vingt-quatre heures » :
Je pose donc pour fondement que l’imitation en tous poèmes doit être si parfaite qu’il ne paraisse aucune différence entre la chose imitée et celle qui imite, car le principal effet de celle-ci consiste à proposer à l’esprit, pour le purger de ses passions déréglées, les objets comme vrais et comme présents.44
La formulation est sans ambiguïté, tant le présupposé paraît entendu aux yeux de Chapelain : si dans toutes les pièces de théâtre (« tous poèmes ») l’imitation doit être parfaite pour produire un effet d’illusion absolue, c'est que le but de la « poésie imitative » est de « purger » l’esprit « de ses passions déréglées ». Chapelain ne dit pas lesquelles. Mais la réponse pour un homme de son temps va de soi : toutes les passions des hommes sont virtuellement déréglées et doivent être constamment tenues en bride, ce à quoi peut contribuer le théâtre.
En France, un siècle après Castelvetro, l’adversaire le plus redoutable de cette interprétation « purgative » a été Corneille, dans la mesure où il a exprimé ses doutes sur l’efficace de la catharsis, tout en considérant sans réserve d’une part que la frayeur et la pitié sont bien les deux passions constitutives de la tragédie, d’autre part qu’une bonne pièce de théâtre apporte automatiquement une instruction morale au spectateur. Car Corneille est le seul à avoir essayé de comprendre le fonctionnement de cette « purgation ». Seulement, en avouant son incompréhension devant la possibilité d’un véritable effet moral de la catharsis et en la considérant comme une « belle idée » qui avait permis à Aristote de défendre la poésie dramatique contre la condamnation de Platon, il n’a pas été capable de sortir de la perspective morale dans laquelle s’étaient enfermés tous les exégètes d’Aristote, pour tenter un autre type d’interprétation : il voyait bien que ça ne marchait pas, mais comme il estimait pour sa part que si la première fin de la poésie dramatique est le plaisir, elle n’en apporte pas moins un enseignement moral de façon indirecte, il n’a pas cherché à s’écarter de la tradition interprétative qui faisait de la correction morale par la voie de la catharsis le but de l’art, pour tenter de s’engager dans une autre perspective que la perspective morale45. Mais il ne semble pas que ses réserves, quoique spectaculairement formulées dans ses Discours qui ouvraient en 1660 les trois tomes de la grande édition collective de son théâtre, aient fait des émules avant le XVIIIe siècle.
C’est qu’un autre courant interprétatif avait commencé à se développer, qui se voulait sans doute plus philologique et qui centrait en tout cas la purgation sur les seules passions tragiques. Son initiateur, ou du moins son vulgarisateur, semble avoir été le savant hollandais Daniel Heinsius, dont on sait que la De Tragoediae Constitutione avait été diffusée, d’édition en édition, à travers toute l’Europe depuis 1611. Consacrant une bonne partie du chapitre II de son traité à la question de la catharsis de la frayeur et de la pitié, il en proposait l’interprétation suivante :
Ces deux passions, dans la mesure même où elle [la tragédie] les excite dans l’âme, elle les rabaisse insensiblement, autant qu’il le faut, tandis qu’elles s’élèvent, et les ramène ainsi à leur forme régulière [à leur état normal].46
Cette lecture – par-delà les hésitations de La Mesnardière47 – a été diffusée en France par Jean-François Sarasin, auteur en 1639 d’un Discours de la tragédie (d’abord publié en guise de préface à L’Amour tyrannique de Scudéry), qui pillait sans vergogne le traité de Heinsius. Repassant par les étapes du raisonnement de Heinsius, prêtant à Aristote l’idée que la tragédie serait « la règle des passions », qui est une formule de Heinsius48, il aboutissait à ce qu’il présentait comme sa propre traduction de la phrase d’Aristote :
La tragédie est l’imitation d’une action sérieuse, complète et juste dans sa grandeur, qui, par l’action, et non pas simplement par le discours, excitant la pitié et la terreur, en laisse après une médiocrité raisonnable dans l’esprit des spectateurs.
Notons en passant l’extraordinaire ambiguïté de la glose de Racine, qui, tout en se rapprochant de cette lecture, paraît bien s’éloigner de son point de vue moral ; loin de s’appesantir sur les vertus pédagogiques que Heinsius et Sarasin prêtaient à cette conception purgative de la catharsis tragique, il mettait en avant le plaisir – qu’il ait pris en considération les réserves cornéliennes, ou qu’en annotant l’édition d’un savant italien du XVIe siècle il ait pris en compte d’autres exégètes transalpins qui avaient estimé que la tragédie avait pour fin le seul plaisir :
La tragédie est l’imitation d’une action grave et complète, qui a sa juste grandeur. Cette imitation se fait par un discours, un style composé pour le plaisir de telle sorte que chacune des parties qui le composent subsiste et agisse séparément et distinctement.
Elle ne se fait point par un récit, mais par une représentation vive qui, excitant la pitié et la terreur, purge et tempère ces sortes de passions. C’est-à-dire qu’en émouvant ces passions, elle leur ôte ce qu’elles ont d’excessif et de vicieux, et les ramène à un état modéré et conforme à la raison.49
En tout cas, cette proposition (de date incertaine et strictement privée, puisque cette glose a été publiée pour la première fois au XIXe siècle) d’une épuration centrée sur les seules passions spécifiques à la tragédie, prélude à celle du Père Rapin, ami de Racine, qui, dans la lignée de Heinsius, écrivait en 1674 dans ses Réflexions sur la Poétique :
La tragédie rectifie l’usage des passions en modérant la crainte et la pitié, qui sont des obstacles à la vertu.
Ce qu’il éclaircissait un peu plus loin :
La tragédie se sert des aventures les plus touchantes et les plus terribles que l’histoire peut lui fournir, pour exciter dans les cœurs les mouvements qu’elle prétend, afin de guérir les esprits de ces vaines frayeurs, qui peuvent les troubler, et de ces sottes compassions qui peuvent les amollir […].50
Le but de l’art tragique est bien toujours de corriger les hommes (ce que ne disait pas Racine51). Mais la cure n’est plus de nature allopathique (la frayeur et la pitié comme remède aux passions contraires, complémentaires et finalement à toutes) ; elle est de nature homéopathique : éveiller la frayeur et la pitié pour en diminuer l’excès, c’est-à-dire éliminer chez les spectateurs ce qu’il y a de vain dans la frayeur et d’amollissant dans la pitié.
Soulignons au passage l’étonnante contorsion que révèle cette interprétation. Car Rapin estime ailleurs que la crainte et la pitié sont destinées aussi à ébranler l’âme du spectateur de façon à le rendre plus réceptif à l’émotion provoquée par l’identification aux passions ressenties par les personnages. Or ces passions-ci ne sont pas englobées dans le processus épuratif ; elles servent au contraire à produire une émotion dans laquelle « consiste tout le plaisir qu’on est capable de recevoir à la tragédie52 ». On est donc en présence d’une dissociation entre le but moral de la tragédie, où l’idée de « rectifier les passions par les passions mêmes53» ne concerne plus que la crainte et la pitié, et le but émotif centré sur le plaisir, dont relèvent toutes les autres passions – étant entendu que telle ou telle passion, comme l’orgueil ou l’ambition, en révélant les désastres où elles conduisent les héros de la tragédie, contribuent à la dimension instructive de la tragédie. Mais c’est là une bien curieuse conception, où l’on épure certaines passions sans dire clairement comment le spectateur peut se débarrasser de toutes celles qu’il a éprouvées en épousant les sentiments des personnages.
*
Toujours est-il que cette évolution de l’interprétation morale a permis le développement d’une nouvelle interprétation, « médicale » à partir du XIXe siècle54 – en fait elle était déjà esquissée par certains commentateurs italiens de la Renaissance –, qui a aujourd’hui de farouches et brillants défenseurs55. Elle prend sa source dans le passage des Politiques où Aristote annonçait qu’il traiterait de la catharsis dans la Poétique :
Les hommes sont tous plus ou moins sensibles à certaines affections de l’âme comme la pitié et la crainte, ou encore la transe religieuse, car cette émotion-là envahit complètement certains individus, mais, quand ils ont eu recours aux chants qui bouleversent l’âme, nous les voyons apaisés et guéris par les chants sacrés, comme s’ils prenaient une médecine ou un purgatif. Nécessairement, les gens sensibles à la pitié, à la crainte, et ceux qui sont émotifs en général, et les autres dans la mesure où ils participent à ces émotions, éprouvent ces effets : tous subissent une sorte de purge et ont un sentiment de légèreté joint à du plaisir ; c’est ainsi que les chants qui ressortissent à la purgation procurent aux hommes une joie qui ne fait pas de mal.56
S’il est vrai que les passions sont présentes à l’état latent en toutes les âmes et que certains individus les ressentent plus que d’autres ; s’il est vrai d’autre part que ceux qui se laissent envahir par la transe religieuse se voient entièrement bouleversés par les chants sacrés qui produisent sur eux un phénomène d’apaisement comme s’ils avaient reçu un médicament ou une purge ; s’il est vrai enfin que tous ceux qui éprouvent la pitié et la crainte (que ce soit de manière pathologique, ou ponctuellement) sont susceptibles d’éprouver les mêmes effets, c’est-à-dire de ressentir une forme de purge qui leur procure une sensation de légèreté mêlée de plaisir, c’est donc qu’il se produirait le même processus homéopathique que dans le domaine médical : les malades recouvrent la santé après qu’un médicament de même nature que leur mal aura créé un phénomène purgatif qui évacue le mal en même temps que le médicament. De là à en déduire que le spectateur de la tragédie, chez qui la pitié et la crainte sont éveillées par la représentation, se voit purgé en même temps des penchants excessifs qu’il pourrait avoir naturellement pour ces sortes de passions, il n’y a qu’un pas. Autrement dit, la tragédie possèderait en elle la capacité d’éliminer les troubles qu’elle engendre et de substituer ce faisant le plaisir à la peine liée à ces troubles.
Cette interprétation « homéopathique » est en soi tout à fait recevable (même si Aristote pour sa part est du côté de la médecine allopathique), et il est possible de soutenir, comme nous le verrons en dernier lieu, qu’elle permet d’expliquer pourquoi certains individus ont une propension toute particulière à rechercher les spectacles violents ou tragiques. Il n’empêche que, pour ce qui nous occupe ici, elle pose une difficulté considérable en ce qui concerne le phénomène de la catharsis tragique tel qu’Aristote l’évoque dans la Poétique. Plus exactement, cette interprétation « homéopathique » engage deux types d’interprétations qui posent l’une et l’autre un problème.
Pour l’une, le plaisir résiderait dans la purgation elle-même, en tant qu’élimination des excès pathogènes qui provoque un soulagement ; le plaisir est dans l’évacuation de la douleur. Mais cette interprétation, la plus courante, ne cherche pas à articuler ce « plaisir cathartique » avec le plaisir fondamental lié à toute activité mimétique dont Aristote explique le fonctionnement dès le chapitre IV de la Poétique et selon lequel « nous avons plaisir à regarder les images les plus soignées des choses dont la vue nous est pénible dans la réalité, par exemple les formes d’animaux parfaitement ignobles ou de cadavres » (48 b 10). Si déjà l’opération mimétique transforme ce qui est pénible dans la réalité en plaisir, que reste-t-il de spécifique à cette catharsis ?
La seconde interprétation, récente57, tient justement compte de cette contradiction et s’appuie même sur elle pour proposer une explication à la fois esthétique et médicale. Ce serait la dimension esthétique du plaisir tragique qui permet la réalisation de la catharsis. Comme l’explique P. Dandrey, en effet, il y a bien un « plaisir inhérent à la mimésis », qui est en outre « favorisé par la mise en œuvre parfaite du mythos tragique » (la composition dramatique) ; mais c’est ce plaisir de la « réalité épurée » qui permet de faire ressentir par le spectateur des émotions « supérieures à celles que pourrait provoquer le réel » : le plaisir empêche donc la purgation de paraître trop amère. Ce qui lui permet de conclure à une double finalité de la tragédie selon Aristote : « la Poétique d’Aristote avait fondé l’analyse des finalités assignées au spectacle tragique sur deux piliers, d’une part la jouissance provoquée par la mimésis maîtrisée, structurée et ornée, et d’autre part la purgation corollaire des surplus passionnels responsables de la mélancolie. »
Cette seconde interprétation, si elle résout élégamment le premier problème en prenant en compte la pensée d’Aristote concernant le plaisir mimétique, en pose en fait un autre, qui ressortit à la question que j’évoquais plus haut en commentant l’ambiguïté de la formulation du passage consacré à la catharsis dans la Poétique. La dissociation apparente entre la production des émotions et leur purgation peut en effet induire l’idée que les deux passions tragiques sont éveillées pour être purgées ; de ce point de vue, l’interprétation éthico-médicale rejoint l’interprétation morale qui a prévalu si longtemps. C’est-à-dire qu’à la question de savoir si l’ensemble de la définition de la tragédie livrée au chapitre VI définit seulement les modalités du genre tragique ou si elle définit à la fois ses modalités et sa finalité, elle répond en choisissant le second terme de l’alternative ; plus exactement, elle n’envisage même pas la possibilité d’une alternative.
Je passerai vite sur la récente approche proposée par W. Marx. Car malgré le détour par les problemata, son interprétation se résout en une simple variante des autres approches médicales, c’est-à-dire qu’elle exclut elle aussi toute réflexion sur le paradoxe tragique – c’est-à-dire toute réflexion sur le rapport entre la violence tragique et le plaisir de la violence – pour s’interroger sur le rapport entre la catharsis et le plaisir : « Aristote assigne à la tragédie une fonction cathartique, profitable au bien-être du spectateur58 ». On voit qu’en dépit du ton triomphal du titre de son étude – « La véritable catharsis aristotélicienne… » –, son approche, toute érudite qu’elle est, ne s’éloigne que de manière superficielle de la traditionnelle perspective éthico-médicale. Elle a cependant le mérite, qui la distingue fondamentalement des interprétations éthico-politiques dominantes, de ne pas négliger le fait que le but de la tragédie est de provoquer du plaisir en suscitant des émotions. W. Marx a bien vu qu’il fallait remettre les émotions (corporelles et donc irrationnelles) au centre de toute réflexion sur La Poétique. Ce faisant, il ne nous conduit pas moins dans la même impasse que les autres écoles interprétatives qu’il prétend réfuter.
VI. Les nouveaux humanistes du XVIIIe siècle : « lecture esthétique » ? ou première réponse au paradoxe tragique ?
« Comment peuvent-ils aimer ces larmes et ces douleurs ? », demandait saint Augustin ; quelle est cette « étrange maladie d’esprit », s’interrogeait-il ? C'est dès le XVIIIe siècle qu’une réponse, d’une acuité extraordinaire, avait été apportée par les nouveaux humanistes du siècle des lumières. Ainsi, dans les Réflexions sur la Poétique de Fontenelle (publié en 1742 mais rédigé, semble-t-il, dans la dernière décade du XVIIe siècle), on peut lire :
Il est certain qu’au théâtre la représentation fait presque l’effet de la réalité ; mais enfin elle ne le fait pas entièrement quelque entraîné que l’on soit par la force du spectacle, quelque empire que les sens et l’imagination prennent sur la raison, il reste toujours au fond de l’esprit je ne sais quelle idée de la fausseté de ce qu’on voit. Cette idée quoique faible et enveloppée suffit pour diminuer la douleur de voir souffrir quelqu’un que l’on aime, et pour réduire cette douleur au degré où elle commence à se changer en plaisir. On pleure les malheurs d’un héros à qui l’on s’est affectionné, et dans le même moment on s’en console, parce qu’on sait que c’est une fiction ; et c’est justement de ce mélange de sentiments que se compose une douleur agréable et des larmes qui font plaisir.
Ce commentaire se détache de toutes les interprétations antérieures de la Poétique en ce qu’il ne suppose pas qu’Aristote assigne quelque finalité extra-artistique à la fiction. Il reflète la conviction que la seule finalité explicitement présente dans le traité est celle du plaisir.59
Or les plus grands philologues du XVIIIe siècle, en particulier Du Bos et surtout l’abbé Batteux qui donna à deux reprises (et à près de cinquante ans de distance) des éditions bilingues (grec-français) de la Poétique arrivèrent aux mêmes conclusions. Lisons Batteux :
Comment s’opère cette purgation dans la Tragédie ? Par deux moyens, dont le premier, chez les Anciens était la musique ou le chant qui accompagnait la Tragédie [...] Le second moyen était l’imitation, qui, selon Aristote (chap. 4, 1) et selon la vérité, a cette propriété singulière, de nous faire aimer dans la peinture ce qui nous ferait horreur dans la réalité, comme des cadavres, des bêtes hideuses. Il ajoute que c’est le charme des Arts. C’est celui de la Tragédie. Si Phèdre dans son désespoir, se poignardait réellement à nos yeux, si Hippolyte était traîné par ses chevaux et déchiré sur les rochers, la pitié et la terreur que nous éprouverions, portées à l’excès, et mêlées d’horreur, seraient pour nous un supplice. La Tragédie vient à notre secours : elle nous donne la terreur et la pitié que nous aimons, et leur ôte ce degré excessif, ou ce mélange d’horreur que nous n’aimons pas. Elle allège l’impression, et la réduit au degré et à l’espèce, où elle n’est plus qu’un plaisir sans mélange de peine, Charan ablabè ; parce que, malgré l’illusion du théâtre, à quelque degré qu’on la suppose, l’artifice perce, et nous console quand l’image nous afflige ; nous rassure quand l’image nous effraie.60
On saisit la proximité de la réflexion entre les deux hommes. Leurs analyses les conduisent à la conviction que la seule finalité explicitement présente dans le traité d’Aristote est celle du plaisir et que c'est ce qui engage le régime des émotions.61
De fait, comme le rappelle le chapitre XIV de la Poétique, « le plaisir que doit produire le poète vient de la pitié et de la frayeur éveillées par l’imitation » (53 b 12-13). Il n’y a assurément pas dissociation entre les deux émotions tragiques et le plaisir. L’imitation artistique propre à la tragédie éveille la pitié et la frayeur qui ont la particularité dans ces conditions d’être source de plaisir, provoquant ainsi le plaisir propre à la tragédie. Dès lors, il n’y a pas deux étapes dans le processus, une étape qui serait liée au plaisir inhérent à l’imitation et une seconde étape qui serait celle de la purgation des passions. Le commencement du chapitre IV est particulièrement clair à cet égard :
Dès l’enfance les hommes ont, inscrites dans leur nature, à la fois une tendance à imiter […] et une tendance à trouver du plaisir aux représentations. Nous en avons une preuve dans l’expérience pratique : nous avons plaisir à regarder les images les plus exactes des choses dont la vue nous est pénible dans la réalité, par exemple les formes d’animaux parfaitement ignobles ou de cadavres. (48 b 4-10)
Comme l’ont remarqué ceux qui au XXe siècle ont revitalisé l’interprétation esthétique, et en particulier R. Dupont-Roc et J. Lallot dans leur édition, la seconde phrase est déjà une évocation du processus cathartique. Si nous avons plaisir à regarder des images de choses dont la vue est pénible dans la réalité, c’est bien que l’opération mimétique possède en elle-même des vertus cathartiques : la figuration de l’insupportable est non seulement supportable, mais elle peut produire du plaisir – dans la mesure évidemment où l’on peut reconnaître qu’il s’agit d’une figuration.
Et loin que ce plaisir inhérent à la mimèsis permette de susciter des émotions « supérieures à celles que pourrait provoquer le réel », comme le soutient P. Dandrey, il est au contraire rendu possible par le seul fait que ces émotions sont nécessairement inférieures, car « épurées » par la conscience de l’artefact. Car il n’y a justement pas d’émotions supérieures à celles que peuvent engendrer des événements réels62. Celui, en effet, qui serait le témoin d’un enchaînement d’événements qui conduirait un homme à tuer un autre homme, ressentirait effectivement frayeur et pitié. Mais exacerbées à un tel point qu’il en ressentirait une violente et insupportable douleur physique : gorge nouée, larmes compulsives et pour finir fuite horrifiée ou au contraire pétrification du corps. Le même enchaînement reçu comme une figuration artistique/artefact est non seulement supportable, mais il est susceptible d’être source de plaisir. En d’autres termes, la conscience, si minime soit-elle, du processus de figuration – qui rappelle le caractère fictionnel des événements tragiques au plus fort même du phénomène d’identification – ôte aux émotions ce qu’elles auraient d’excessif dans la vie réelle, de douloureusement insupportable : elle les « épure », et les transforme en plaisir.
Qu’on se souvienne de l’anecdote concernant la pantomime rapportée par Diderot. L’acteur anglais Garrick, l’un des premiers à avoir popularisé cet art en Europe, cherchait un jour à en démontrer, devant des contradicteurs, la puissance émotionnelle. Pour ce faire, il décida d’aller jusqu’au bout de ses possibilités de jeu, c’est-à-dire de tenter de gommer toute dimension fictionnelle de la saynète qu’il improvisa :
Poussé à bout, il dit à ses contradicteurs en prenant un coussin : « Messieurs, je suis le père de cet enfant. » Ensuite il ouvre une fenêtre, il prend son coussin, il le saute [= il le fait sauter] et le baise, il le caresse et se met à imiter toute la niaiserie d’un père qui s’amuse avec son enfant ; mais il vint un instant où le coussin, ou plutôt l’enfant, lui échappa des mains et tomba par la fenêtre. Alors Garrick se mit à pantomimer le désespoir du père. Demandez à M. de Duras ce qui en arriva. Les spectateurs en conçurent des mouvements de consternation et de frayeur si violents que la plupart ne purent les supporter et se retirèrent.63
Pour prouver la force de l’art de la pantomime, Garrick a cherché à faire aussi vrai que le vrai : simuler un accident atroce tel qu’il peut s’en produire tous les jours et placer les assistants dans une situation de confrontation aux plus terribles émotions « réelles », sensation de réalité permise par le fait que le coussin, une fois disparu au-delà de la fenêtre, n’avait pu qu’être définitivement oublié en tant que coussin pour réellement devenir un enfant mort. Or quel fut le résultat de cette fiction transformée en non-fiction par l’art muet d’un extraordinaire acteur ? Les émotions furent si violentes, souligne Diderot, « que la plupart ne purent les supporter et se retirèrent. » En forçant les spectateurs à perdre totalement la conscience d’être devant un spectacle fictif, Garrick avait coupé court au processus cathartique.
Dès lors, pour en revenir à la phrase d’Aristote si discutée, dire que « en suscitant la pitié et la frayeur, l’imitation opère l’épuration de ces mêmes passions », c’est laisser entendre que le phénomène de l’imitation artistique – en l’occurrence la représentation théâtrale d’une fiction – crée une distance qui amortit la puissance émotionnelle de la frayeur et de la pitié : la conscience du caractère fictionnel de ce qui cause ces émotions les purge de ce qu’elles ont de douloureux dans la vie réelle, les transfigurant ainsi en plaisir.
En somme la catharsis n’est ni une finalité, ni un procédé : elle est un processus, et, par là, elle constitue le régime normal de la tragédie.
VII. De la tragédie au cinéma d’horreur : esthétique et psychologie du public
Si la catharsis est le régime normal de la tragédie, elle est aussi le régime normal de toute forme de fiction dont le but est de provoquer du plaisir en suscitant de violentes émotions chez le destinataire du texte ou du spectacle. Comment comprendre sans faire appel précisément à cette interprétation de la catharsis qu’il puisse exister de nos jours un genre cinématographique, le film d’horreur, et que ce genre ait non seulement un public, mais un public composé d’individus « normaux », à qui l’idée de voir devant eux écraser un chat serait insupportable ? Certes, les émotions provoquées par la tragédie et celle provoquées par un film d’horreur sont en apparence radicalement différentes. D’une certaine manière elles avaient été d’emblée rejetées du domaine des arts de la fiction par Aristote, qui conseille d’éviter toutes les émotions issues non pas de l’histoire (du « système des faits », mais du spectacle lui-même. Or pour une large part, ce qui caractérise le film d’horreur, c’est une combinaison entre trois éléments : l’irruption d’une réalité dont le caractère hyperboliquement dangereux (et souvent fantastique) paraît sans issue imaginable pour le spectateur, une focalisation sur des victimes (effectives ou potentielles) parfaitement innocentes et une complaisance dans les « effets spectaculaires ». C’est justement tout ce que condamne Aristote pour qui les meilleures fictions sont celles qui produisent « simplement » la frayeur et la pitié – les émotions constitutives de la tragédie – et non point l’horreur et le dégoût. Ainsi condamne-t-il les intrigues où des innocents passent injustement du bonheur au malheur (ce qui est l’un des fondements du cinéma d’horreur) et tous les effets qui dépendent du seul spectacle, autrement dit, en termes actuels, tous les effets spéciaux.
Mais Aristote écrivait pour les Grecs du IVe siècle avant J-C. De même qu’il n’avait pu anticiper la lointaine abolition de l’esclavage, il n’a pu prévoir la naissance du cinéma et de ses extraordinaires possibilités d’illusion, et, de ce fait, des possibilités d’exacerbation des émotions. Car de la tragédie au film d’horreur, c’est bien de cela qu’il s’agit : d’une question de degré dans l’exacerbation des émotions, l’amateur de film d’horreur ayant besoin des spectacles les plus forts pour ressentir les émotions qu’un « humain moyen » ressent en contemplant un spectacle tragique « normal ».
Si l’on n’accepte pas de valider cette transposition, il faut alors expliquer comment il est possible d’expliquer qu’un individu normal, mais amateur de sensations fortes, puisse supporter des scènes monstrueuses, dont la seule évocation s’il les savait réelles, le paralyserait ou lui ferait perdre connaissance. C'est donc aussi ce qu’on peut objecter aux tenants des lectures morale et physiologico-médicale qui ne prennent pas en compte la dimension psychologico-esthétique de la catharsis : or, ce qu’il convient de faire ici pour le film d’horreur comme pour la tragédie, c’est de tenter en premier lieu de résoudre le mystère de la transmutation d’émotions difficilement supportables et même quelquefois insupportables en émotions agréables.
Autre question connexe. Comment se fait-il que l’on assiste aujourd’hui à une multiplication extraordinaire de ce type de cinéma, qui déborde désormais largement dans les séries télévisées ? Le succès persistant d’une série comme Walking Dead ((11 saisons à ce jour depuis 2010) pose le problème de façon plus aiguë encore, car les séries sont conçues comme un type de spectacle qui va chez le spectateur (et non comme le cinéma qui invite d’abord le spectateur à faire la démarche d’aller dans une salle de spectacle).
Bref, que la majorité des spectateurs ne supporte pas ce genre cinématographique s’explique par la recherche des effets d’horreur et particulièrement du réalisme le plus outrancier pratiquée par les réalisateurs : cette quête ne peut que produire chez la plupart une réaction horrifiée de même nature que celle que réussit à susciter le mime Garrick devant des spectateurs qui avaient perdu la conscience de la fiction mimétique. Mais qu’en est-il pour la minorité d’amateurs à qui ce genre est destiné ? prendre du plaisir à contempler des histoires terribles qui comportent des images montrant des corps humains en train de subir les pires amputations, expectorations ou éventrations ne peut s’expliquer que par le phénomène de l’épuration mimétique propre à toute représentation. Tout en étant pris par l’illusion au point d’avoir l’impression de partager les violentes émotions des personnages fictifs et tout en ayant l’estomac noué par la montée de la peur et le cœur serré par l’approche des larmes, l’amateur garde suffisamment de conscience d’assister à une figuration esthétique / un artefact pour ne pas s’évanouir ou quitter brusquement son fauteuil. Non seulement il ne souffre pas, mais il prend du plaisir sans pour autant cesser d’avoir peur : la souffrance potentielle a été « épurée » par le processus représentatif et les émotions peuvent être à la fois violentes et agréables.64
Ainsi entendue, la catharsis n’est évidemment pas un but comme le postulent toutes les lectures éthiques et médicales ; mais elle n’est pas non plus « un effet », comme le pensent quelques-uns. C’est une simple « opération » inhérente au processus de la représentation ; c’en est même la condition de possibilité, et pas seulement dans le cas des films d’horreur. Plus exactement, c’est la condition du plaisir tragique. En outre, une telle conception de l’épuration artistique retentit sur la conception même des passions. À côté de la dimension éthique et de l’utilisation rhétorique des passions se fait jour une dimension et une utilisation propre à la représentation des fictions tragiques, qui s’apparente à notre conception moderne de l’émotion esthétique. Simplement, pour sa part, Aristote se contentait – me semble-t-il – de parler de passions épurées.
Conclusion
On voit que la dimension psychologique est fondamentale dans le point de vue esthétique que je propose de lire chez Aristote, ce qui me conduit à soutenir, à la suite de Halliwell, que la Poétique s’appuie d’abord sur une psychologie du public. Car je souligne une dernière fois que les lectures de la catharsis comme « effet », d’inspiration médicale ou physiologique ou d’inspiration éthique, ne se préoccupent nullement de savoir à quel processus obéissent les émotions tragiques elles-mêmes. Comme je l’ai rappelé en citant le postulat de Carole Talon-Hugon, la grande majorité des interprètes de la Poétique en tiennent pour « un effet extra-artistique produit par une expérience artistique ». Or ce point de vue oblitère la question fondamentale de savoir de quelle nature est selon Aristote l’expérience artistique elle-même. Ne passe-t-elle pas par une véritable alchimie qui transfigure les émotions douloureuses de la frayeur et de la pitié en émotions non seulement tolérables mais qui constituent l’essentiel du plaisir ressenti à la vue d’une tragédie ? Dans la mesure où Aristote utilise un terme d’origine médicale signifiant purgation/épuration à l’endroit précis du texte où il parle des émotions, pour quelle raison ferait-il ici allusion à un effet extra-artistique produit sur le spectateur alors même qu’il ne s’est pas expliqué sur le processus intra-artistique qui transfigure les émotions douloureuses en émotions agréables ? Gageons que, comme il l’annonçait dans les Politiques, il devait en parler un peu plus longuement — ou un peu moins allusivement — en un autre lieu de la Poétique.
Cela posé, il reste à résoudre entièrement le malentendu en articulant le processus cathartique avec les effets cathartiques. Aristote avait-il prévu de parler aussi de l’effet extra-artistique des différents genres poétiques, et donc de la tragédie ? Car il n’est absolument pas exclu d’établir un lien entre le texte de la Poétique et celui de la Politique. Outre les effets éthique et politique, il est possible d’envisager un véritable effet « médical » — psychologique — des plus fortes émotions à l’œuvre dans les genres tragiques.
Qui ne connaît des personnes dont les inquiétudes causées par les mystères et menaces de la vie ou par leurs propres démons intérieurs sont apaisées lorsqu’elles peuvent s’endormir sur la lecture d’un livre excessivement violent ou la vision d’un film ou d’un épisode de série particulièrement horrible ou inquiétant ? Les deux conceptions de la catharsis sont ici en marche : si cette personne parvient à soutenir la lecture ou la vision d’une fiction terrifiante, c’est bien que les émotions suscitées par cette fiction sont épurées par la conscience de l’artefact ; c’est qu’ici est à l’œuvre le processus cathartique suggéré par Aristote dans cet elliptique passage du chapitre VI de la Poétique. Si cette même personne parvient à glisser agréablement dans le sommeil à l’issue de la lecture ou du spectacle terrifiant qu’elle a souvent tenu à supporter jusqu’au bout (tout en le jugeant par moments insupportable), c’est bien qu’effectivement l’excitation violente des passions de l’âme a des vertus curatives…
J’aimerais donc inviter les divers spécialistes à dépasser l’impasse actuelle dans laquelle le jeu des exclusions (une lecture contre l’autre) nous a enfermés durant longtemps. Comme j’ai pu le laisser entendre ci-dessus, l’interprétation psychologico-esthétique de la catharsis n’exclut pas les interprétations éthiques et politiques, car les unes et les autres ne se situent pas sur le même plan ; de même qu’elle n’exclut pas la lecture médicale suggérée par le passage controversé de La Politique. Si « l’auto-catharsis » de la frayeur et de la pitié permet de supporter les plus terribles et les plus tristes événements survenus aux héros du drame et de transmuer ces émotions violentes en plaisir, il n’empêche que faire ressentir de violentes émotions (toujours « épurées » pour être supportables) à certaines âmes peut leur permettre de trouver un apaisement à certaines dispositions psychologiques douloureuses.