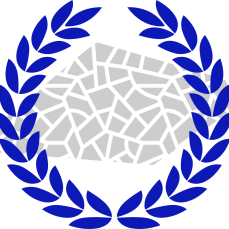Pour comprendre et analyser la crise sanitaire et la pandémie qui frappent aujourd’hui la plus grande partie du monde, des comparaisons avec les grandes pestes du Moyen-Âge viennent rapidement à l’esprit. L’antiquité paraît en revanche plus lointaine. Ce n’est pas que les textes anciens évoquant de grandes maladies qui s’abattent subitement sur toute une population manquent ; bien au contraire, il serait même vain de vouloir ici tous les répertorier. La relative mise à l’écart de l’antiquité du débat contemporain tient peut-être plutôt à ce que ces textes laissent le lecteur face à un sentiment d’étrangeté : il n’y reconnaitra bien souvent ni les noms des maladies qu’il connait, ni la phénoménologie de ce qu’il sait être une épidémie.
Les médecins grecs du Ve siècle avant J.-C. sont pourtant les premiers à utiliser fréquemment l’adjectif ἐπιδήμιος (epidêmios) et le verbe ἐπιδημεῖν (epidêmein). Τirées du mot δῆμος (dêmos), « pays, territoire », puis « peuple », ces formes composées désignent « ce qui se trouve dans le pays » selon le Dictionnaire étymologique de la langue grecque de Pierre Chantraine, ce qui réside chez un peuple. Platon utilise le verbe dans le Théétète pour évoquer la triste mais inévitable « localisation » du corps du philosophe dans la cité, quand son âme au contraire s’en échappe et cherche à s’envoler (173 e 3). L’image aura une postérité dans le grec chrétien, et pourra même, perdant son sens péjoratif, désigner la venue et le séjour du Christ rédempteur chez les hommes (Eusèbe, Préparation évangélique, V, 25). Le verbe permet de souligner l’opposition entre la résidence dans la cité et un séjour hors les murs (Xénophon, Le Banquet, 4, 31, et déjà chez Homère, Odyssée, 16, 28), qu’il soit motivé par un départ en campagne militaire ou une ambassade. Chez les médecins, le mot désigne donc naturellement l’installation sur un territoire de pathologies qui se répandent largement.
Les médecins grecs à l'origine de la notion d'« épidémie »
Comment les médecins anciens donnent-ils à voir le mal qui devient ἐπιδήμιος ? Les premières descriptions de telles maladies se trouvent dans les Épidémies I-III, un traité de la Collection hippocratique de la fin du Ve siècle, souvent perçu comme un des plus représentatifs de la médecine « d’Hippocrate ». Il est passé dans la tradition latine sous le titre De morbis popularibus. C’est dans des « constitutions climatiques » (en grec κατάστασις, katastasis, mot qui a aussi des usages politiques), de vastes tableaux climato-nosographiques des maladies advenues en un lieu et en une année donnés, que se déploient les descriptions des épidémies. Elles complètent des études de cas particulier de malades, minutieuses observations au chevet des patients, qui apparurent très modernes aux premiers médecins cliniciens du XVIIIe siècle.
Les premières pages des Épidémies I sont une de ces « constitutions ». Elles ne donnent certes pas à voir la maladie la plus spectaculaire de l’antiquité, même si elles culminent dans l’évocation d’une « phtisie » particulièrement létale, où certains ont reconnu une tuberculose dévastatrice. Ces lignes laissent en revanche affleurer des aspects fondamentaux de la conception hippocratique des épidémies. Elles ouvrent une fenêtre sur la réflexion qui est celle du médecin ancien quand il est confronté à des maladies qui frappent une population entière. La scène est sur l’île de Thasos, au large de la Thrace, où le praticien a établi ses quartiers vers l’an 410.
Texte grec issu de l’édition de Jacques Jouanna, Hippocrate : Épidémies I et III, Paris, Les Belles Lettres, 2016, traduction personnelle.
|
Γενομένης δὲ τῆς ἀγωγῆς ὅλης ἐπὶ τὰ νότια καὶ μετ’αὐχμῶν, πρωῒ μὲν τοῦ ἦρος, ἐκ τῆς πρόσθεν καταστάσιος ὑπεναντίης καὶ βορείου γενομένης ὀλίγοισιν ἐγένοντο καῦσοι, καὶ τούτοισι πάνυ εὐσταθέα, καὶ ὀλίγοισιν ᾑμορράγει, οὐδ' ἀπέθνησκον ἐκ τουτέων. Ἐπάρματα δὲ παρὰ τὰ ὦτα πολλοῖσιν ἑτερόρροπα καὶ ἐξ ἀμφοτέρων· τοῖσι πλείστοισιν ἀπύροισιν ὀρθοστάδην· ἔστι δὲ οἳ καὶ σμικρὰ ἐπεθερμαίνοντο· κατέσβη πᾶσιν ἀσινέως· οὐδ' ἐξεπύησεν οὐδενὶ ὥσπερ τὰ ἐξ ἄλλων προφασίων. Ἦν δὲ ὁ τρόπος αὐτῶν· χαῦνα, μεγάλα, κεχυμένα, οὐ μετὰ φλεγμονῆς, ἀνώδυνα· πᾶσιν ἀσήμως ἠφανίσθη.
Ἐγίνετο δὲ ταῦτα μειρακίοισιν, νέοισι, ἀκμάζουσι, καὶ τούτων τοῖσι περὶ παλαίστρην καὶ γυμνάσια πλείστοισι· γυναιξὶ δὲ ὀλίγῃσιν ἐγίνετο. Πολλοῖσι δὲ βῆχες ξηραὶ βήσσουσι καὶ οὐδὲν ἀνάγουσι· φωναὶ βραγχώδεες οὐ μετὰ πουλὺ· τοῖσι δὲ καὶ μετὰ χρόνον, φλεγμοναὶ μετ' ὀδύνης ἐς ὄρχιν ἑτερόρροπα, τοῖσι δὲ ἐς ἀμφοτέρους· πυρετοὶ τοῖσι μὲν, τοῖσι δ' οὔ· ἐπιπόνως ταῦτα τοῖσι πλείστοισιν· τὰ δ' ἄλλα, ὅσα κατ' ἰητρεῖον, ἀνόσως διῆγον.
Πρωῒ δὲ τοῦ θέρεος ἀρξάμενοι, διὰ θέρεος καὶ κατὰ χειμῶνα, πολλοὶ τῶν ἤδη πολὺν χρόνον ὑποφερομένων φθινώδεες κατεκλίνησαν· ἐπεὶ καὶ τοῖσιν ἐνδοιαστῶς ἔχουσι, πολλοῖσιν ἐβεβαίωσε τότε· ἔστι δ' οἷσιν ἤρξατο πρῶτον τότε, οἷσιν ἔρρεπεν ἡ φύσις ἐπὶ τὸ φθινῶδες. Ἀπέθανον δὲ πολλοὶ καὶ πλεῖστοι τούτων, καὶ τῶν κατακλινέντων οὐκ οἶδ' εἴ τις καὶ μέτριον χρόνον περιεγένετο· ἀπέθνῃσκον δὲ ὀξυτέρως ἢ ὡς εἴθισται διάγειν τὰ τοιαῦτα. |
La tendance de l’année ayant été toute entière aux vents du sud et aux sécheresses, tôt dans le printemps, en raison d’une année précédente contraire et soumise aux vents du nord, des fièvres brûlantes apparurent chez quelques habitants ; elles furent très régulières et ne provoquèrent d’écoulements de sang que pour un petit nombre de malades ; ils n’en moururent pas. Il y eut encore, chez beaucoup, des gonflements au niveau des oreilles, d’un seul côté de la tête ou des deux côtés à la fois. La plupart des malades, sans avoir de fièvre, resta debout. Certains eurent aussi un peu de température. Pour tous, la fièvre s’éteignit sans causer de dommages. Et personne n’eut d’excrétions purulentes comme dans les gonflements dus à d’autres causes. La forme des gonflements était la suivante : mous, grands, étendus, sans inflammation, indolores. Ils disparurent pour tous les malades sans laisser de trace. Cela arriva aux adolescents, aux jeunes gens, aux hommes dans la fleur de l’âge, et parmi eux, à la plupart de ceux qui allaient à la palestre et au gymnase. Le mal frappa peu de femmes. Chez beaucoup de malades il y eut des toux sèches mais qui ne faisaient rien remonter. Les voix s’enrouaient peu de temps après. Il y en eut aussi qui eurent, suite à la toux, des inflammations douloureuses aux testicules, d’un seul côté ou, pour d’autres, des deux côtés. Des fièvres chez certains, chez d’autres non. Ce fut douloureux pour la plupart. Mais les autres maladies qui se traitent chez le médecin, les habitants n’en furent pas atteints. Dès le début de l’été, durant l’été puis dans l’hiver, beaucoup de ceux qui présentaient déjà depuis longtemps un état phtisique s’alitèrent. Ensuite, chez nombre d’hommes pour qui l’on pouvait soupçonner cet état, le mal se renforça alors. Pour certains, la maladie commença à ce moment-là, fit sa première apparition, pour des gens dont le naturel tendait vers l’état phtisique. |
Malgré la mine d’informations que constitue l’édition critique commentée de Jacques Jouanna, la lecture d’un tel texte reste difficile. Les formes ioniennes peuvent sembler curieuses à qui ne fréquente pas assidûment Hérodote dans le texte ; le lexique est rare et technique (par ex. εὐσταθέα, ὀρθοστάδην) ; les noms de maladies n’ont pas d’équivalent exact dans la nosographie contemporaine et ont donné du fil à retordre aux spécialistes de paléopathologie qui ont voulu les identifier (φθινώδεες, « état phtisique », καῦσοι, « causus » ou « fièvres brûlantes »). Enfin le style asyndétique de l’auteur repose sur la suppression d’un certain nombre de sujets, qu’il faut restituer tant bien que mal. Les médecins anciens cultivent déjà, avant ceux de Molière, un idiolecte qui n’en fait pas les interlocuteurs naturels du citoyen lambda. Une fois surmontés ces obstacles, c’est le résultat intrigant de plus d’un an d’observations médicales, menées autour de l’an 410 sur l’île de Thasos, vers la fin de la guerre du Péloponnèse, quelque vingt ans après la grande « peste » d’Athènes, qui s’offre à nous.
Une explication des maladies
L’épidémie n’est pas présentée ici comme un phénomène inouï, radicalement nouveau, propre à semer le désordre dans la cité et à mettre en échec la rationalisation médicale. Lors de la « peste » qui frappa Athènes, si l’on en croit Thucydide, en l’absence de connaissances fiables, discours, récits et rumeurs accrurent le caractère terrifiant de la maladie. Le médecin hippocratique ne suppose pour sa part aucune origine étrangère du mal, aucun empoisonnement des sources et des puits pour justifier ces maladies très virulentes (vs. Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, II, 48, 1-2). L’épidémie n’est pas une catastrophe mais s’explique rationnellement. Le début du texte insiste ainsi sur la succession de deux années au climat fortement contraire. Ce mécanisme du chaud-froid, placé au début de la nosographie, rendra compte des pathologies, de même qu’il sert dans d’autres traités à justifier le déclenchement de la crise d’épilepsie (Maladie sacrée). Outre la cause climatique, affleure ici aussi une cause humorale ou idiosyncrasique (liée aux caractéristiques naturelles de chaque malade). C’est net à la fin du texte, à propos des phtisiques qui sont frappés par l’épidémie en fonction de la gravité de leur état antérieur. Une double explication par le climat et par le « terrain » pathologique propre à chaque patient est donc mise en œuvre. Comprendre la maladie demande aussi de la réinscrire dans le temps long. Le médecin ne se focalise ainsi pas seulement sur le mal le plus meurtrier, cette « phtisie » galopante estivale dont la suite du passage cité montrera qu’elle est une maladie pulmonaire aux complications particulièrement dangereuses. Il fait au contraire le tableau complet de toutes les affections qui ont eu lieu dans l’année et se sont répandues dans la population, y compris celles qui paraissent relativement bénignes, comme les premières fièvres brûlantes.
Façonné par cette logique explicative, le discours médical ne verse pas dans l’inquiétude, d’autant plus qu’il est rédigé post eventu. Le médecin ne manifeste pas non plus de frayeur devant la violence du mal, ni ne témoigne de pitié pour les morts pourtant nombreux qu’il recense. Sans le constat final plus expressif de la rapidité du mal à tuer (« je ne sais s’il s’en trouva pour résister au mal un temps normal »), on ne percevrait sans doute pas véritablement l’ampleur et la gravité de la crise sanitaire qui eut effectivement lieu à Thasos en cette fin de Ve siècle.
Des « épidémies »…
Est épidémique, selon le sens premier du mot grec, ce qui « réside » et « s’installe » dans une cité ou chez un peuple tout entier. Si les premières « fièvres brûlantes » n’ont pas touché largement les habitants de Thasos, les autres maladies répondent bien en revanche à cette définition : les pronoms πᾶς (pas), πολλοί (polloi) ou encore πλεῖστοι (pleistoi) viennent souligner régulièrement que presque tous sont frappés. Le médecin s’intéresse à des maladies générales mais sans toutefois se livrer à des constats uniformes et globalisants à leur sujet. Pour chacune d’entre elles, les réactions « immunitaires » différenciées de sous-groupes de patients sont décrites. Il y a un effort pour définir quelles catégories de la population sont particulièrement touchées par tel mal. C’est tout à fait net pour l’attaque « d’oreillons », la deuxième maladie de l’année, qui frappe principalement les hommes, et même plus fortement les plus vigoureux et les plus sportifs d’entre eux. Le médecin prend donc soin de cibler des groupes qu’on appellerait aujourd’hui « à risque ». S’il y a « épidémie » c’est enfin parce que les maladies décrites « dominent » et chassent pour ainsi dire les autres. Est en effet constatée de façon tout à fait remarquable, comme chez Thucydide (II, 51, 1), la disparition, lors de la crise épidémique, des affections les plus fréquentes habituellement (« mais les autres maladies qui se traitent chez le médecin, les habitants n’en furent pas atteints »).
... mais des épidémies sans contagion
Tout pourrait finalement laisser croire que nous sommes ici en terrain connu. Rationalisation de la pathologie et explication de la maladie par des causes, quantification (approximative certes, mais tout de même présente) de la « courbe » épidémique, symptomatologie précise des affections et identification des malades les plus « à risque ». Une science donc que cette ancienne médecine grecque, et qui plus est étonnamment moderne dans son protocole d’observation. Le vaste tableau que fait Thucydide de l’effondrement d’Athènes écrasée sous la maladie qui frappe les hommes comme du bétail (II, 51, 4) paraîtrait en comparaison de l’ordre de la science-fiction et pourrait sembler une dystopie produite à dessein pour effrayer.
Sans être totalement fausse, cette impression globale de scientificité pourrait toutefois laisser échapper un trait fondamental du texte : le médecin a l’air de méconnaitre le principe de la contagion. La façon dont il analyse l’épidémie d’oreillons est étonnante : « cela arriva aux adolescents, aux jeunes gens, aux hommes dans force de l’âge, et parmi eux, à la plupart de ceux qui allaient à la palestre et au gymnase. Le mal frappa peu de femmes ». Des spécialistes de médecine antique ont constaté que le praticien semblait là avoir rassemblé tous les éléments qui permettrait de conclure aisément à une circulation du mal. Il est en effet facile de deviner a posteriori, à partir de ces quelques notations, que le virus se transmettait à Thasos par la fréquentation de lieux où se pratiquent des sports qui imposent une grande promiscuité, comme la lutte à la palestre. Le faible nombre de femmes touchées va dans ce sens, sans qu’il soit besoin d’être expert en microbiologie pour le voir. Ne fréquentant pas, dans la plupart des cités antiques, les lieux d’exercice, elles ont été largement épargnées par le virus alors en circulation. Mais le médecin ancien n’en vient aucunement à une conclusion de ce type. Et il n’y a pas là simple prudence de sa part. Le rappel initial du fait que cette maladie touche des hommes en pleine forme (ἀκμάζουσι) et la focalisation de ses observations sur les testicules des patients laissent penser qu’il privilégie une explication par le « terrain » pathologique au détriment d’une explication par l’agent pathogène. Autrement dit, les oreillons frappent ces jeunes gens, non pas parce qu’ils se côtoient au gymnase, mais avant tout parce qu’ils sont des mâles et que la maladie requiert, pour s’aggraver et se consolider, la vigueur et la pléthore sanguine qui est typique des sportifs de bon niveau et des hommes dans la fleur de l’âge.
Ce médecin hippocratique fait donc, pour comprendre les épidémies, le choix du concept de terrain contre celui de la circulation du mal. Les conséquences théoriques et pratiques de cette conception sont nombreuses. Seront alors scrutés avant tout la « nature » (φύσις) du malade, son âge, son sexe, son régime, son alimentation au détriment de son existence en société, de ses contacts avec autrui ou du comportement du groupe auquel il appartient. Au plan métaphorique, dans le discours médical, il ne pourra pas être question de « barrières » contre la maladie tandis que le thème de « l’intrusion » ou de « l’invasion » pathologique restera nécessairement réduit. La logique du terrain conduira au contraire à privilégier les images de la « pousse » du mal ou celle de la « tendance » ou du « penchant » à le subir (ἔρρεπεν, errepen). Une telle conception explique enfin sans doute plus concrètement et tristement la propension des soignants à s’exposer aux épidémies par ignorance les lois de la contagion, erreur dramatique rapportée par Thucydide au début de son récit, quand il nous rappelle que les médecins furent les premiers à être emportés par la maladie (II, 47, 4).