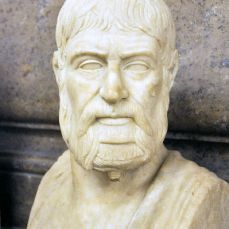Confrontation : littératures et cultures antiques / littératures et cultures française et étrangère.
"L’ouverture vers le monde moderne et contemporain constitue l’un des principes essentiels des programmes de langues et cultures de l’Antiquité, dont l’étude, constitutive d’une solide et indispensable culture générale, n’est pas réservée aux seuls élèves qui se destinent à des études littéraires."
"Travailler de manière méthodique sur les différences et les analogies de civilisation, confronter des œuvres de la littérature grecque ou latine avec des œuvres modernes ou contemporaines, françaises ou étrangères, conduit à développer une conscience humaniste ouverte à la fois aux constantes et aux variables culturelles."
Programmes LCA et LLCA, Préambule.
Présentation générale
C’est un roman que Balzac a commencé à écrire en 1833, qui a paru d’abord dans « La chronique de Paris » en 1836 puis dans « Le Constitutionnel » sous forme de feuilleton jusqu’au 8 octobre 1838, sous le titre « Les Rivalités en province ». Il y eut une première édition en 1839 avec deux chapitres nouveaux, et il fut ensuite publié dans l’édition générale de la Comédie humaine en 1844, sous le titre général « les Rivalités », qui englobe deux histoires, La vieille fille et Le cabinet des Antiques. On peut constater au passage que l’œuvre de Balzac a subi de constantes transformations : au départ, un premier projet opposant deux tableaux de vieilles filles, l’une ridicule et très incarnée, et l’autre (Armande) sublime et angélique, avec pour toile de fond, la vie provinciale ; dans l’édition de 1844, l’éclairage portera plus sur Victurnien, le dernier rejeton de la très ancienne famille d’Esgrignon. L’œuvre, une fois réalisée, n’a plus Armande comme héroïne, mais son neveu Victurnien et prend ainsi sa place juste avant les Illusions perdues, dont le héros est lui aussi un jeune homme de province à qui la vie parisienne ne réussira pas non plus.
Le roman se situe sous la Restauration.
Le cadre
L’histoire se déroule dans une petite ville de province. La ville n’est pas tellement décrite, elle reste abstraite, prise comme le microcosme typique de la province française sous la Restauration.
Nous n’en connaissons, dans le roman, que les maisons : Balzac fait la description de trois ou quatre maisons provinciales. Mais il y a en fait une opposition constante entre Paris et la province. Face à la monotonie de la vie provinciale Balzac veut montrer l’attirance que Paris suscite chez ceux qui ne veulent pas s’y enterrer toute leur vie. La liberté de l’action est toujours sous-tendue par la « nécessité » de monter à Paris (cf. Les Illusions perdues). Balzac (cf. sa préface générale) veut illustrer ce vice français venant de l’hypertrophie malsaine de la capitale, au détriment du pays profond, et veut dénoncer ce danger de la centralisation. Victurnien n’est pas un cas isolé, le roman a une portée didactique, et ce qui est intéressant, c’est que Paris représente la ligne de fuite commune à tous les protagonistes (cf. le juge Camusot). Victurnien veut, en allant à Paris, se faire présenter au roi et redonner à sa famille son ancien lustre.
Les forces en présence
1. Les forces du passé
Le point de départ idéologique de Balzac (qu’on retrouve dans la majorité de ses romans) c’est le déclin de la noblesse : c’est le cas de la maison d’Esgrignon, épuisée de ses treize siècles d’existence. Le vieux marquis pousse jusqu’à l’absurde la fierté de ne pas mêler les sangs, et veut préserver une pureté qui mène à l’épuisement (pauvreté, extinction de la descendance…). Il y a chez lui un refus du temps (cf. quand il brise sa montre à la mort de sa femme). Il nie la Révolution, il emploie même un lexique désuet. Son aveuglement l’empêche de comprendre que le temps est toujours en marche. Et la fin du livre avec le mariage de Victurnien presque contraint d’épouser une jeune fille bien dotée de la bourgeoisie d’affaire, signe l’échec de cette noblesse coupée de toutes les irrigations vitales.
Telle qu’elle apparaît dans le roman, cette noblesse constitue un vestige de la société médiévale habitée par la passion noble par excellence, l’honneur, « un îlot non touché par le modernisme », rétif à tout changement (cf. le vieux Chesnel, le serviteur si dévoué, mais qui tombe en disgrâce pour avoir voulu faire épouser Armande, la sœur du marquis, par Du Croisier).
Balzac fait de cette noblesse un portrait véridique, et, bien que ses convictions aillent de ce côté, sans pitié : cette classe, pour lui, est vouée à la disparition, et c’est toute la tragédie de l’histoire, que les seuls partisans honnêtes et convaincus de l’ancien régime soient représentés par ces Don Quichotte de province bornés et très en retard sur l’époque, car cette noblesse n’a rien à voir avec les aristocrates au pouvoir, dont d’ailleurs fait partie Diane de Maufrigneuse : Balzac signale avec la Restauration, « cette séparation entre la haute et la petite bourgeoisie, entre les éléments bourgeois et les éléments nobles réunis un moment sous la pression de la grande autorité napoléonienne ; division subite qui fit tant de mal à la France ».
2. La noblesse parisienne
On l’entrevoit dans le livre (et nous y voyons le retour de nombreux personnages qui figurent dans la Comédie humaine) ; justement c’est cette noblesse qui pactise avec l’Ennemi bourgeois. Elle sourit des idées arriérées de l’antique noblesse qui appartient au siècle précédent et finalement elle s’efforce d’utiliser ses privilèges nobiliaires pour profiter individuellement au maximum du développement capitaliste. Et c’est un des paradoxes que le monarchiste Balzac représente toute une partie de sa chère noblesse comme une bande d’arrivistes plus ou moins doués, (cf. le mot de Diane de Maufrigneuse) : « Nous ne sommes plus au XVè siècle, c’est l’argent qui noblifie » - voir aussi les premières observations de Victurnien à Paris : un duc, premier gentilhomme de la Chambre, va à pied sur le boulevard, un parapluie à la main. Chateaubriand lui aussi fit la même remarque quand il vit, au cours de son voyage à Prague en 1833, passer sur le pont Charles l’ex-roi Charles X en exil, un parapluie à la main, seul sceptre dérisoire qu’il puisse désormais tenir. Peut-être d’ailleurs cette vision qu’on lit dans les Mémoires d’Outre-Tombe (publiés en 1849) s’est-elle inspirée de Balzac ?
À cette noblesse, aucune autre issue n’est offerte que celle des plaisirs. Balzac fait un constat très lucide sur le régime de la Restauration, qui est une fausse Restauration, devant d’ailleurs mener au triomphe de la bourgeoisie avec la Monarchie de Juillet, comme sur le caractère irrémédiable du déclin de la vraie noblesse. Sa critique, depuis la droite, de l’argent, est tout à fait pertinente. Il rejoint par là toute la critique romantique, très pessimiste sur les acquis de la Révolution.
3. La bourgeoisie
Elle est représentée par Du Croisier, qui est le prototype de cette société nouvelle des « libéraux » qui s’oppose aux Royalistes ; et ce que nous allons lire, ce n’est pas seulement l’histoire d’une haine personnelle entre Du Croisier et les d’Esgrignon, mais l’histoire exemplaire de la lutte et des divisions entre royalistes et libéraux. Dans la petite ville de province, se font face deux salons, le salon libéral et le salon royaliste, avec une haine croissante de la part de Du Croisier, qui, à chaque élection, est repoussé par les Royalistes c’est-à-dire les d’Esgrignon. Donc d’un côté la jeunesse, l’activité, l’ambition, et de l’autre, l’immobilité et la vieillesse.
Parmi la bourgeoisie, une classe un peu à part, celle des hommes de la loi : toute une galerie de portraits dont les détails cependant ont une portée générale : en province la magistrature est « humaine » ; elle compte aussi bien des libéraux que des royalistes et se livre souvent à des compétitions internes (cf. entre les prétendants de la riche Mademoiselle Blandureau).
Quel est l’enjeu du combat entre ces forces qui s’opposent ? Il s’agit de faire triompher le prestige d’un Nom, et ce qu’il y a de beau dans ce livre, c’est que d’un côté Du Croisier échoue : il avait cru que depuis 89 la loi était la même pour tous ; or Chesnel arrive à faire fonctionner la justice en sens inverse : d’Esgrignon est sauvé in extremis, mais d’un autre côté – un homme seul ne peut réussir à sauver toute une classe – les d’Esgrignon sont ruinés, et Victurnien est obligé d’épouser mademoiselle Duval, la nièce de Du Croisier. Diane le leur avait dit : c’est l’argent qui rend noble ; donc avec une noblesse complètement ruinée, le combat est en définitive perdu. Balzac se fait l’avocat des causes perdues, tout en sachant qu’elles sont perdues. Son porte-parole Chesnel est le seul à avoir gardé les anciens rapports de l’ancien régime entre les maîtres et leurs serviteurs ; il est tout entier au service de la haute idée féodale, et Balzac nous montre dans le comportement de Chesnel les avantages de cette antique idéologie.
Ainsi le roman n’est-il pas le banal récit d’un fait divers (un jeune homme issu d’une vieille famille, auteur d’un faux etc…), mais une tragédie qui se joue au niveau de l’histoire : la défaite irrémédiable de l’ancienne noblesse avec la mise scène d’un personnage extraordinaire qui sera le sauveteur des d’Esgrignon, mais qui n’empêchera pas le mouvement de l’histoire, le vieux notaire Chesnel.
La composition du roman
1. Les différentes parties du roman
Le roman d’abord paru en feuilleton est divisé dans sa première édition de 1839 en chapitres, dont on peut retrouver la trace ans les différentes parties dont est composé le roman en 1844. Le roman est en neuf parties :
- les deux salons
- une mauvaise éducation
- les débuts de Victurnien
- la belle Maufrigneuse
- Chesnel au secours de D’Esgrignon
- un tribunal de province
- Camusot, le juge d’instruction
- la bataille judiciaire
- une mésalliance
Il est intéressant de noter comment les masses sont réparties : deux chapitres de description pour commencer : Balzac aime décrire le terrain de l’histoire et des personnages. Ensuite tout semble s’enchaîner nécessairement, selon un déterminisme sociologique qui rend les destins complètement dépendants du terreau sur lesquels ils ont pris forme : la mauvaise éducation de Victurnien, comme les forces en présence expliquent la suite de l’histoire.
Puis ce qu’on peut appeler l’aventure de Victurnien à Paris (des « scènes » plutôt qu’un récit).
Enfin, encadrant une vingtaine de pages de description des hommes du Parquet, les manœuvres de Chesnel terminées par quelques pages de conclusion.
Nous voyons ici que ce qui retient l’attention de Balzac, plus que l’équipée de Victurnien (sur laquelle il s’étalera par l’intermédiaire de Lucien de Rubempré, dans les Illusions perdues), ce sont les causes qui entraînent son échec, et la façon dont est mené en Province le combat de la Tradition contre la Modernité. Et ici la réalité décrite prend alors un aspect quasi épique : la méticulosité et la particularité des détails renvoie à des forces supérieures dont l’histoire somme toute banale à laquelle nous assistons n’est qu’un des épiphénomènes.
2. Les différents narrateurs
Balzac est loin dans le roman d’être le narrateur omniscient auquel on l’a souvent assimilé. Le texte de l’édition pré-originale (1836) ne connaissait qu’un « je » auteur-narrateur. Ce « je » se dédouble dans l’édition originale de 1839 : conscient de ses responsabilités d’historien, Balzac fait de ce « je » d’une part un « il » auteur, annaliste sérieux et savant généalogiste de la maison d’Esgrignon, mais il garde le « je » qui évoquait des souvenirs d’enfance pour faire parler sous cette première personne l’informateur « à qui la littérature contemporaine (ou l’auteur dans une autre édition) est redevable de cette histoire » : Emile Blondet.
Il y a toujours, chez Balzac, cette volonté de fixer son récit dans une tradition orale : écouter des gens qui savent raconter, et le journaliste Blondet en fait partie. C’est une façon de figurer le destinataire du récit, de représenter le lecteur dans l’auditeur qui écoute celui qui raconte, de se décharger en même temps du poids trop lourd de la narration.
D’autre part, à partir de 1840 (date où il conçoit « La comédie humaine » dans son ensemble) Balzac tend à se projeter dans son œuvre sous la figure de l’homme de lettres amoureux d’une grande dame (cf. Lousteau, Blondet, d’Arthez) ; il fait ici le choix de l’écrivain journaliste Blondet, bien vu des femmes du monde, aimable, paresseux, et doué. Blondet qui représente Balzac tel qu’il aurait voulu être : un bâtard heureux, un mariage réussi avec sa première passion (cf. La Vieille fille), bref, à l’opposé des difficultés dans lesquelles se débattaient souvent ses confrères parisiens comme Balzac lui-même.
Et dans l’ouverture du roman, la répartition des rôles est très réussie : d’une part le tableau idyllique brossé par les souvenirs de Blondet, et d’autre part la description géographique, topographique, et historique, c’est-à-dire les deux thèmes du roman : un monde qui s’enchante dans un non-temps, et un monde en devenir. Or c’est Blondet qui évoque ce monde disparu, dont le charme se confond avec ses souvenirs d’enfance, et avec cet émerveillement devant ces choses passées qui furent grandes. La nostalgie de Balzac pour cet ancien monde s’individualise donc dans celle d’un homme, Blondet, pour son enfance, disparue elle aussi. Au contraire c’est le romancier historien qui se charge du présent et de ses désenchantements - cf. les deux tableaux d’Armande, noble jeune femme dans le récit de Blondet et vieille fille un peu sotte quand c’est le narrateur qui la met en scène. Ces deux narrateurs qui reflètent le spectacle du monde avec des yeux différents permettent à l’auteur de considérer toute chose sous sa double face.
3. Le choix des noms
Pour Balzac le nom des êtres correspond à leur apparence et même à leur psychologie. Pas de hasard là non plus, mais une nécessité supérieure qui justifie les appellations : ainsi pour Chesnel, le notaire « chenu » attaché à la famille d’Esgrignon comme un « chien » à ses maîtres, qui se bat donc avec un dévouement toujours modeste pour les sauver ou plutôt pour sauver ce qui fait leur essence même : leur honneur, et qui n’attend pour récompense que le privilège de pouvoir revenir au « chenil », reposer dans la chapelle du château (en ruine !).
De même pour Diane de Maufrigneuse : un nom qui devait comme « accrocher le nom de d’Esgrignon » dit madame de Sérisy (« fr-gr-gn »)… Un broiement d’os dans la gueule d’un ogre », ou encore Camusot « qui a le nez de son nom » , ou encore le maigre et grand « Sauvager » au « nez d’oiseau de proie.
La technique de la description
Nous parlerons des lieux précisément décrits, à savoir le cabinet des antiques lui-même, la maison de Chesnel, la maison de Camusot et celle de Ronceret, enfin la maison et la serre de Blondet.
Nous avons déjà évoqué le partage dans la narration entre Blondet et le narrateur : à Blondet d’évoquer sur un ton mi nostalgique mi-mythique les lieux du passé, au narrateur de décrire ce qui représente le présent des mœurs provinciales.
On se demandera si, malgré ces deux visées différentes, la technique descriptive reste identique.
Une description fantastique
Le « cabinet des antiques », comme l’a malicieusement surnommé Blondet, est donc le salon d’Esgrignon. Notons que dans son sens exact cette expression désigne - cf. un cabinet des médailles un lieu où sont données à voir des œuvres provenant de l’Antiquité. Ce salon abrite des hommes venus tout droit eux aussi d’une époque disparue. La description est donc une description des lieux (d’abord) et une description des personnes (ensuite), et elle s’accompagne de la transcription constante des impressions de Blondet. Dès le départ, nous savons déjà que « c’est un lieu à la limite du réel et du fantastique », et à la fin nous aurons compris pourquoi ce lieu est « un cimetière réveillé avant le temps ».
1. Caractère subjectif de la description
Il vient de la présence des nombreux « je » du texte qui expliquent à chaque fois l’étonnement ou la terreur de celui qui parle.
Il vient aussi du nombre de comparaisons qui transforment cet obscur salon provincial en lieu « superlatif » qui allie à la grandeur démesurée du Louvre l’épouvante des contes d’Hoffmann. (cf. toutes les formules comme « je n’ai jamais retrouvé, rien ne m’a plus étonné… etc.)
2. Le lien entre les lieux et les hommes
Ces lieux sont inadaptés : ce n’est pas un salon, mais une salle d’audience, qui se trouve au-dessus d’une prison « où gisaient jadis les criminels » transformée en cuisine (un caractère donc déjà infernal). Quelque chose de trop grand (« immense cheminée, plafond magnifique…), mais de désuet, de passé (« la dorure se voyait à peine, les vieux lambris, les oripeaux d’un temps qui n’était plus »), bref ce « grandissime salon » est « en disproportion avec toute la maison ».
Mais, paradoxalement, l’inadaptation de ces lieux convient exactement (et même la reflète) à l’inadaptation de ces nobles égarés dans ce nouveau siècle : il y a toujours chez notre romancier cette correspondance entre une maison et ses habitants ; la disproportion des lieux rejoint les prétentions disproportionnées de ces nobles d’un autre âge, comme le caractère désuet de la maison convient à ces gens d’un autre âge (cf. le gris de la tapisserie en harmonie avec « ces yeux gris si pâles qu’on dirait ceux des mourants ») .
Voilà qui explique la naissance d’un spectacle irréel, qui touche au fantastique, car ce que voit Blondet dans cette « cage de verre », ce n’est pas un spectacle contemporain, mais une « scène » (comme au théâtre) venue d’un autre âge, jouée par des comédiens dont on ne sait s’ils sont des fantômes d’êtres disparus, ou s’ils sont toujours en vie. Des Revenants, qui font naître comme une terreur.
3. Le fantastique des personnes
L’impression de démesure, de démodé, va effectivement, avec la description des personnages, se transformer en impression de terreur, car ces personnages n’ont plus rien de vivant, ou plutôt ils ne semblent qu’imiter la vie, c’est-à-dire, mal, et de façon outrée : ce sont des momies, des squelettes, qui se tiennent trop droit, dont les gestes ont la régularité des automates, ils abusent du fard (trop de rouge), ils n’ont rien d’humain, et ils ne sont que des parties du corps assemblées (des membres, des mâchoires, des figures aplaties… autant de métonymies qui offusquent l’unité du corps vivant). L’ensemble constitue donc un cimetière réveillé avant le Temps.
Ainsi décrire le salon d’Esgrignon, c’est décrire un spectacle de l’au-delà, d’après la mort. Mais il faut remarquer que ce fantastique (en tant que voyage au pays des morts) représente très exactement la réalité même de cette noblesse qui ne vit que dans le passé.
Cette description très attentive de ce salon s’attache donc à saisir l’unité d’ensemble d’un lieu et de ses occupants, et cette unité d’ensemble vient de « l’impression d’indécision, d’irréalité » qui s’en dégage : a-t-on affaire à des morts, ou à des êtres vivants… ? Le marquis lui-même s’est arrêté de vivre dans le temps à la mort de sa femme.
Ce à quoi est donc sensible la subjectivité enfantine de Blondet, c’est à la réalité de la condition de la noblesse qui continue à subsister, en dépit de sa mort réelle.
La description réaliste
Le narrateur lui aussi ne peut s’empêcher d’intervenir, soit que la description se fasse au présent, soit qu’il prononce lui-même un jugement, soit qu’il fasse lui-même des comparaisons : la description ne vient jamais d’un personnage qui voit les lieux (focalisation interne, comme c’est le cas chez Stendhal), mais du regard du narrateur lui-même (focalisation externe).
Dans la description des maisons, il y a donc toujours un lien entre l’habitation et ses occupants : ce qui ressort ici c’est que toutes ces maisons sont des maisons de provinciaux , exception faite de madame Camusot qui est une parisienne et qui est justement étrangère à cette coquille faite pour une provinciale. Balzac décrira quatre maisons, avec un ton chaque fois un peu différent, parce que, bien que ce soit lui qui parle et qui regarde, ce qu’il dit dépend en fait de l’occupant des lieux, et le lieu déteint sur l’homme (et vice-versa).
Si la petitesse et l’aspect quelque peu encaissé est le caractère général de ces maisons (« petite cour, jardinet, petite cour proprette…. »), ce qui est le propre de la province, la plus triste est celle de madame Camusot (« murailles sombres, fer ouvragé mais rongé par la rouille ») tout là-dedans exprime le vide (cf. les adjectifs « nu, froid, désert »). Une maison typiquement provinciale mais attristée par la nostalgie de son occupante qui pense au Paris d’où elle vient et qui regarde constamment vers la capitale vers où elle fera tout pour retourner. Une maison « remarquablement laide, une porte bâtarde, un mobilier hétéroclite, une chambre mesquine »). Donc dans ce cas la petitesse (objective) se fait mesquinerie, puis vide, puis néant.
De la même façon, la maison des Ronceret est triste elle aussi parce que « les fleurs avaient l’air de s’y déplaire », à l’image de Ronceret qui « s’y déplaisait sans savoir pourquoi ». Ici tout est signe d’économie et d’avarice, les peintures sont vieilles, le tapis vert est râpé, le lustre est vieux, tout est gris, et si la vieille grille est dévorée par la rouille, ce n’est pas comme chez Madame Camusot par désintérêt, mais par avarice. Une maison qui comme « une coquille » est refermée sur elle-même, sombre, sans air, une sorte de prison.
Au contraire le vieux Blondet et Chesnel, provinciaux plus sympathiques, habitent des maisons plus gaies ; elles sont d’abord plus propres, mais pour le notaire, plus sérieux, les murs restent humides et sombres, la porte est grise, il ne prend pas beaucoup d’intérêt à son logement, qui se trouve rue du Bercail (c’est effectivement le symbole de la fidélité de Chesnel, qui n’a jamais quitté « le bercail » pendant la Révolution et a essayé de préserver les biens des d’Esgrignon). Au contraire Blondet habite « une des plus jolies maisons » de la ville. À l’extérieur, des fleurs mais dont les feuilles sont « monstrueuses, hérissées de piquantes défenses » (signe de la passion bizarre qui anime le personnage). La façade en est égayée, et la teinte de rouille, qui réapparaît ici a une connotation heureuse (elle est en harmonie avec la mousse). Si la maison, comme toutes les autres, est encaissée, elle est « encaissée gracieusement ». Balzac décrit dans le juge Blondet l’homme d’une passion, la botanique : « Il ne connaissait que le droit et la botanique » et Balzac, lui aussi décrit à la fois le jardin et son jardinier, les pots, les outils, avec un plaisir des mots qui révèle ce goût de Balzac pour l’horticulture, la description culminant avec cet amphithéâtre «magnifique et célèbre assemblée » de toutes les espèces de pélargonium, qui regardent comme des spectateurs le déroulement de l’intrigue.
La transfiguration des lieux
Nous voyons donc très bien comment malgré la différence des deux voix (subjective / objective), la description est identique dans les deux cas : il s’agit pour le regard de se faire le plus observateur possible pour trouver au-delà même du spectacle le lien des choses : c’est-à-dire que le caractère fantastique de la vision ne vient pas d’une différence de technique de description, mais d’une différence de sujet : un monde d’après la mort / un monde réel . Mais dans les deux cas, le réalisme de Balzac consiste d’abord dans une observation particulièrement rigoureuse, qui lui permet ensuite de justifier tous les détails par le déterminisme qui unit ici un lieu à ses occupants. Ainsi tout est ici signifiant.
Ce qui est fantastique n’est donc pas tant tel ou tel sujet mais la conformité que Balzac fait toujours surgir entre un lieu et une personne ; et l’imagination créatrice coïncide avec la nécessité des déterminismes sociaux.
Ainsi dans la description, le regard n’est jamais neutre, mais c’est celui du créateur qui voit fonctionner ses personnages, et qui voit dans tout ce qu’ils font, dans tout ce qu’ils touchent, le reflet de ce qu’ils sont. Les descriptions ne sont jamais le fait d’une subjectivité particulière (cf. Flaubert, où, selon que le regard est chargé de tristesse ou de gaîté, le spectacle aussi change de signe, ou Stendhal, où tout n’est le plus souvent vu que par les yeux du héros) mais es descriptions sont faites par le narrateur omniscient qui nous communique son savoir à propos des créatures qu’il fait vivre : il n’y a pas de liberté chez Balzac.
Les portraits
La description physique des personnages obéit aux mêmes règles que la description des lieux, dans la mesure où le physique renvoie à la fois au social et au moral, si bien que la correspondance de l’extérieur et de l’intérieur fait du personnage un type qui s’inscrit dans la Comédie humaine.
Les personnages secondaires : des personnages très individualisés
On s’aperçoit d’ailleurs que plus le personnage est secondaire, plus il est individualisé, comme si le peu de temps de son apparition était compensé par l’abondance de sa description, cf. madame Camusot, du Ronceret, Blondet, Sauvaget.
Mais il y a un souci, très souvent, d’expliquer le dehors part le dedans (cf. la correspondance entre la maison et son propriétaire) ; on peut ainsi opposer le portrait de Sauvaget (un « oiseau de proie », maigre et grand, « les joues laminées par l’étude et creusées par l’ambition », et qui est donc à l’affût des circonstances susceptibles de l’y faire parvenir) à celui de du Ronceret, dont les yeux vairons, le front fuyant révèlent une fausseté de caractère qui concorde avec la fausseté de sa position. Il y a aussi le vieux marquis dont les traits révèlent d’eux-mêmes le caractère : la description chez Balzac n’est pas faite pour elle-même mais dans le souci d’expliquer un comportement.
Il faut noter l’importance des notations vestimentaires (l’habit est aussi le signe d’appartenance à une classe et aide à une définition du personnage) - cf. la description du marquis d’Esgrignon, de la présidente du Ronceret, ou de Diane de Maufrigneuse.
Mais le portrait qui est fait avec le plus de soin, et d’amour est celui du vieux juge Blondet : Balzac nous donne non seulement son portrait mais fait un bref raccourci de sa vie en soulignant l’importance de sa passion pour les fleurs : l’observation chez Balzac débouche souvent sur une interprétation. Cette manie de Blondet a tous les caractères d’une passion, (on songe au « fleuriste » de La Bruyère), mais elle n’est possible qu’en province, où la vie publique est de moindre importance que la vie privée : « Sa vie réelle n’était rien auprès de la vie fantastique et pleine d’émotions que menait le vieillard, de plus en plus épris de ses innocentes sultanes. Sans cette passion, il eût été député…etc. » (remarquez le terme « épris » et la fleur choisie dont le nom évoque une femme). En trois lignes, Balzac dit tout : la présence d’une passion qui donne accès à une vraie vie, et le caractère négatif de cette passion, socialement parlant (au lieu de la députation, il mène une vie obscure). Ainsi ce portrait très individualisé porte à la fois la marque de l’observation perspicace comme des options de son créateur (la passion est toujours socialement dévastatrice chez Balzac). Et comme les raisons de cette vie obscure nous sont données en même temps que son portrait, le comportement du personnage devient exemplaire d’un certain type d’homme, et donc le résultat d’une loi.
Les protagonistes
Balzac part encore une fois d’un fait divers (un noble qui s’endette, qui fait un faux…). Mais toute cette matière est transformée et il en ressort des personnages originaux qui décrivent la conception que s’est forgée le romancier : de même que chacun des personnages secondaires est décrit en fonction de ce postulat que l’intérieur correspond à l’extérieur, de même les personnages principaux vont répondre (outre à ce même principe) à une même vision unificatrice de Balzac : il n’y a pas des personnages simplement unis par une intrigue, comme dans les romans antérieurs, mais un drame général, où chacun a sa place, et c’est en fonction de cette vision unificatrice et globalisante que seront faits les portraits.
Cette vision est celle du combat de l’Esprit contre la Matière. Le champion-héros en est Victurnien, l’ange-gardien protecteur, Chesnel, la bonne fée Armande, la mauvaise fée Diane, et le démon-matière en est du Croisier.
Ainsi, en raison de ce combat général, chacun des protagonistes sera dans l’un ou l’autre camp, et sera pourvu des caractéristiques qui les rattacheront soit à l’esprit, soit à la matière, et leur individualité devient pour cela exemplaire. Mais Balzac souligne ce caractère exemplaire par un certain nombre de procédés : il y a dans ces portraits, par le biais des comparaisons, une référence constante à une autre dimension : soit référence à l’animalité (voir à ce sujet l’avant-propos de la Comédie humaine), à la sauvagerie. Du Croisier (dont le portrait nous est donné à travers le personnage de Du Bousquet dans La vieille fille) est à mi-chemin entre l’homme et l’animal (« nez aplati mais à naseaux garnis de poils », quand il est convoqué par Chesnel, il a « l’allure d’un chat qui sent du lait dans un office »). Il est à plusieurs reprises qualifié de « sauvage » ; mademoiselle Blandureau, elle, « s’ennuie comme une carpe » Sauvager a « une tête d’aigle », soit référence à une réalité supérieure, qu’elle soit celle de l’Histoire, ou celle du Ciel. L’Histoire est présente dans le portrait du vieux d’Esgrignon qui cumule presque tous les signes de la Royauté (le nez de Condé, le front de Louis XV…). Il respire la noblesse, la fierté, il est un héros de l’Histoire antique, comme on en lit dans les Vies de Plutarque. Mais cette réalité supérieure peut être aussi celle de l’ordre céleste, et c’est un des côtés les plus intéressants du livre, car Balzac nous propose les deux portraits antithétiques d’Armande et de Diane.
1. Armande
On en a plusieurs portraits ; le premier est fait par le regard enfantin de Blondet (c’est un passage célèbre dont Proust probablement a dû s’inspirer en nous donnant une vision quasi identique de la Duchesse de Guermantes à Combray) ; Armande est une créature céleste, une apparition magique (cheveux blonds, yeux d’émeraude, une taille élégante… Reine ou fée des Mille et une nuits…) ; une magie qui restera longtemps agissante : Blondet ne pourra oublier ce visage, qu’il rapprochera ensuite des « têtes d’après l’antique » que lui faisait dessiner son maître de dessin. Et nous avons comme l’histoire du passage du temps après cette vision d’enfant : d’abord une vision, presque fantastique, puis l’interprétation de cette impression par l’étude du caractère d’Armande : le regard de Blondet est déjà celui de Balzac, il pénètre à l’intérieur, et voit la correspondance entre les traits physiques et l’Esprit : c’est une « déesse », « une de mes religions », puis on arrive au temps présent « aujourd’hui », dit Blondet, « jamais ma folle imagination ne grimpe l’escalier… d’un antique manoir sans s’y peindre mademoiselle Armande comme le génie de la Féodalité…Cette céleste figure, entrevue à travers les nuageuses illusions de l’enfance, vient maintenant au milieu des nuées de mes rêves » Armande prend ainsi le caractère immatériel des créatures célestes. Plus loin Balzac en parlera comme d’une « sublime fille, belle comme ces statuettes minces et élancées… que les merveilleux artistes des cathédrales ont mises dans quelques angles… une sainte… ». Armande a tous les attributs de la sainteté et elle vit dans un monde éthéré. Pourtant le regard de Balzac se distingue malgré tout du regard émerveillé de Blondet : le regard de l’enfant transfigure le réel et ne voit pas que sur terre le pur esprit est voué à l’échec : et c’est ce qu’est, de fait, l’éducation qu’elle a donnée à Victurnien.
2. Diane de Maufrigneuse
C’est celle qui réalise sur un mode perverti la fusion qui serait idéale pour Balzac entre l’Esprit et la Matière, sur un mode perverti, car son apparence seulement (et non son être même) appartient au monde éthéré, alors que son être est très terre à terre. Son trait fondamental est l’artifice, et Balzac insiste lourdement sur ce point. Tout part, comme toujours chez lui, d’une constatation tirée de l’expérience parisienne qui lui laissa un profond sentiment d’amertume. (« Il n’y a que les parisiennes pour toujours rouler dans le même sac à charbon, et en sortir toujours plus blanches ») Chez cette parisienne, tout, idées, regards, pauses, toilettes, repose sur un système mûrement délibéré. À travers elle, il fait le portrait généralisant de toutes les parisiennes qui l’ont trompé. Or précisément, il n’y a pas de portrait en pied de Diane. Balzac se contente de rassembler tous les éléments qui la font paraître ce qu’elle a décidé d’être, (vu son âge, qui ne lui permettait plus les grands décolletés de sa jeunesse !) : « une créature angélique » « Elle avait inventé de se faire immaculée » ; donc « de grands manches comme si c’eût été des ailes » (d’ange !), « une séraphique beauté voilée », « une ceinture de petite fille » bref « un fatras de virginités en mousseline ».
Il faut noter la vérité sociologique de ce portrait : nous sommes en plein Romantisme, une époque où se confondent la poésie nébuleuse du romantisme anglais et la poésie mystique et chrétienne du Génie du Christianisme, et où la mode pour une femme est de correspondre à cet idéal mystico-chrétien. Ainsi Diane de Maufrigneuse pratique-t-elle un angélisme de convention, dont « la suave expression » est aussi délibérée qu’une « loi dans les deux Chambres ». Elle représente donc la mauvaise dualité (comme Armande représentait la mauvaise unicité, volant dans le réel incarner l’Esprit) : au lieu d’une union mystique des deux principes opposés de l’esprit et de la matière, il y a juxtaposition délibérée (et en réalité elle n’obéit elle aussi qu’à un seul principe, à l’opposé d’Armande, celui de la matière) de l’apparence immatérielle avec la sensualité sous-jacente : le narrateur se demande comment elle pouvait rester si immatérielle en coulant son regard de façon si assassine…, comme il y a d’autre part juxtaposition de la masculinité et de la féminité : son apparente faiblesse et sa fragilité toute féminine sont contredites par une force cachée faite d’insensibilité (« une vigueur d’âme… dont s’effraierait un homme », « la duchesse ne croyait à rien qu’à elle-même ». Et Balzac n’hésite pas à la rendre supérieure à Richelieu, ou à Napoléon ! « Point de ces hésitations que Richelieu ne confiait qu’au père Joseph, que Napoléon cacha d’abord à tout le monde… ». D’ailleurs c’est en travesti que Diane finira par aller trouver le vieux notaire, et Balzac souligne dans cet accoutrement l’opposition entre « cette voix de femme » et « la délicieuse figure de jeune homme » qu’elle montre. Cela correspond bien à l’intention de l’auteur qui est de souligner ce caractère hybride de Diane. Et cet épisode, loin d’être le fruit du hasard, s’inscrit dans les nécessités de la vision balzacienne.
Notons enfin la place symbolique et centrale de ces deux portraits : Diane travestie incarne le travestissement de la Noblesse au cours des années 1820-30 : elle n’est plus capable d’assumer une unité heureuse : elle se partage entre Armande : le seul Esprit, condamné à disparaître, et Diane, la matière revêtue hypocritement des vêtements de l’Esprit, mais faisant en réalité le jeu de la bourgeoisie, qui triomphera avec l’avènement de Louis-Philippe
Ce portrait est donc intéressant en ce qu’il nous montre comment le romancier procède : il y a un cheminement entre sa vie intérieure et son observation : les choses observées ne sont utilisées que si elles concordent avec la subjectivité de l’auteur et avec la vision antérieure et préalable qui structure son univers intérieur. Ainsi ce portrait réunit un modèle vivant (les parisiennes réellement rencontrées), une subjectivité tout aussi réelle (les déconvenues en face de coquettes insensibles) et une vision antérieure (l’idéalisation rêvée, dont on a un exemple dans « Seraphita » écrit quelques années auparavant). Le Réel sera nourri de cette vision antérieure : il sera vu comme une perversion de ce modèle idéal : c’est le regard visionnaire intérieur qui informe la vision que l’artiste se fait du monde qui l’entoure. Diane sera comme une parodie de cet idéal, et en fin de compte sera moins un portrait objectif qu’une déformation de la réalité.
Donc ce portrait permet de voir que la description est moins reproduction du réel que fruit des visions du créateur : il montre à la fois une technique du type individualisé (le type de la coquette) et l’emploi artistique de la parodie comme référence implicite à l’idéal balzacien (et romantique !) : Balzac scrute son univers intérieur tout autant qu’il s’inspire des choses extérieures.
Son réalisme est donc toujours nourri par une vision qui non seulement transforme le personnage en type, mais assigne à ce personnage un rôle défini dans la structure de son univers intérieur, par rapport auquel tous les éléments différents de la réalité vont s’ordonner : il y a toujours chez Balzac un rêve d’unité, et son « erreur » (si l’on peut appeler erreur ce qui a produit la Comédie humaine !) ce fut de croire que ce rêve correspondait au Réel. Mais le Réel, diront Stendhal et Flaubert n’est pas unifiable, chaque point de vue sur le monde est relatif et fragmentaire. Balzac lui se confond avec le Créateur suprême !
Aussi cette « Comédie » atteint par cela l’Epique : chaque personnage a un rôle dans un drame cosmique : au lieu de s’en tenir à la particularité de chaque homme en tant qu’individu, Balzac la dépasse et la rattache à une réalité supérieure (à l’inverse de ce qu’on appelle le « réalisme »). Partant du réalisme le plus pointilleux, il aboutit à une vision généralisante où chaque personnage n’est plus que l’incarnation d’un principe, d’une idée (de même que dans l’Epopée, Ulysse est la Ruse, et Achille le Courage). La lutte des intérêts d’une époque précise rejoint sur le plan de l’Histoire celle de la Noblesse congre la Bourgeoisie, et sur le plan métaphysique, celle de l’Esprit contre la matière.
Nous pouvons remarquer pour finir que le créateur nous impose sa création : le personnage n’est vu que par lui, à travers sa vision, selon le rôle qu’il lui assigne dans son monde intérieur. Le lecteur n’a aucune liberté d’interprétation (ce qui ne facilite pas la tâche du critique !), mais c’est le romancier qui nous donne constamment la clé de ses personnages.
Chesnel ou la possibilité de la grandeur
Si ce livre a été au départ conçu comme « l’histoire de ces jeunes-gens pauvres qui viennent à Paris pour s’y perdre » (Préface), Balzac, peut-être parce qu’il écrivait en même temps les Illusions perdues, où le problème était traité à fond, a, en réalité, au cours de la rédaction du roman, fait porter l’intérêt sur le personnage de Chesnel, qui est présent d’un bout à l’autre de l’histoire, et qui semble incarner ce combat désespéré de l’ancienne féodalité – qui se sait perdue- contre les forces vives de la Bourgeoisie.
C’est en tout cas à son sujet que Balzac est le plus lyrique, c’est ce personnage qui incarne ses idées, et dans ce combat que mène Chesnel, il y a quelque chose de Balzac lui-même qui lui aussi connaît l’irréversibilité de l’Histoire et fait comme lui un constat lucide de la transformation de la société, et, comme lui n’a pas pu pour autant s’empêcher de célébrer un ordre disparu, celui de la Féodalité.
Ce que Balzac veut montrer, c’est donc non la grandeur, mais la possibilité de la grandeur, parce que la grandeur est liée à un ordre disparu. Et celui qui est grand dans l’histoire, ce n’est pas d’Esgrignon, mais Chesnel, l’ancien domestique. Pourquoi ?
La grandeur de Chesnel
Jeune intendant de la famille d’Esgrignon, (son père était le domestique – majordome- de la famille) Chesnel est devenu notaire et a fait fortune « Il avait la confiance de toute la ville, il y était considéré. Sa haute probité, sa grande fortune contribuaient à lui donner de l’importance ».
L’histoire commence quand il a 69 ans : « une tête chenue, un visage carré », il porte un habit « démodé et vieux ».
Que fait-il de « grand » ? Il donne toute sa fortune à Victurnien, sans la moindre fierté, laissant le père de Victurnien tout ignorer de son geste si généreux, puis il sauve Victurnien de la prison, et la véritable intrigue du roman est constituée par toutes les manœuvres qu’il entreprend pour sauver son maître du déshonneur. L’œil de Balzac va grossir cette action « provinciale » au point d’y faire entrer à la fois l’épique et le tragique, et d’en faire une action exemplaire.
1. L’épique
Chesnel est comparé à des héros antiques ou modernes. A deux reprises, Balzac le rapproche d’un personnage de Plutarque (« un homme de Plutarque » dit Victurnien), ou de sa traduction par Amyot « il se dressa en pied, comme eût dit Amyot, il sembla grandir », et un peu plus haut : « Ne faut-il pas remonter à la mythologie pour trouver des comparaisons dignes de cet homme antique ? ». Il ressemble aussi à « un des prophètes peints par Raphaël, et surtout Balzac le rapproche de Bonaparte, il se bat comme lui, « semblable au premier consul qui, vaincu dans les champs de Marengo jusqu’à cinq heures du soir, à six, obtint la victoire », et de Bonaparte devenu empereur « Il fallait être Chesnel, il fallait les illuminations soudaines du désespoir pour être aussi grand que Napoléon, plus grand, même ».
Ainsi Balzac discerne ce qu’il y a d’épique (un épique qui depuis la fin de l’empire a disparu de la modernité) dans la proposition de mensonge désespérée que Chesnel fait à madame du Croisier : Le monde étant devenu désormais si prosaïque, l’épique est peut-être à aller chercher au fond des provinces, là où l’Histoire n’a pas encore pénétré. Et la grandeur de l’écrivain est d’avoir compris en définitive, quoi qu’il en ait dit, l’enseignement de la Révolution : le ressort de la grandeur n’appartient pas seulement aux grands personnages de l’Histoire, ou à une classe supérieure, mais il peut se trouver, avec les mêmes motivations, chez un obscur petit notaire de province : le plus obscur individu peut, d’une façon peu visible aux autres (mais que perçoit le romancier), sur le plan individuel (l’individu est une conquête de la Révolution), et non plus national, historique, ou mythologique, devenir un véritable héros.
C’est là une des caractéristiques du Réalisme balzacien, un réalisme, notons-le, contraire en fait à ses opinions. Balzac est plus révolutionnaire dans sa création que dans ses idées ; le héros de l’histoire, c’est Chesnel, et non d’Esgrignon. Avec Balzac on découvre l’héroïsme du quotidien.
2. Le tragique
Chesnel est non seulement un héros épique dont on vient de montrer la grandeur du combat, mais il apparaît aussi comme un héros tragique en ce sens que son combat, il le sait, est voué à l’échec. Certes Victurnien sera sauvé in extremis. Mais Chesnel ne se fait pas d’illusion sur l’avenir de la noblesse, et son combat apparaît encore plus grand parce qu’il se fait le champion d’une cause perdue : « il voyait clair. Son fanatisme était entier sans être aveugle et le rendait ainsi bien plus beau ». La beauté de Chesnel, l’émotion qu’il fait naître, c’est donc cette ardeur dans un combat perdu. Il reconnaît « le grand changement produit par l’Industrie et les mœurs modernes », mais il veut lutter pour une cause perdue, ce qui fait que sa victoire est peut-être encore plus grande que celle de Bonaparte à Marengo : « Être plus grand même que Napoléon : cette bataille n’était pas Marengo, mais Waterloo, et Chesnel voulait vaincre les Prussiens en les voyant arrivés » : Chesnel triomphe donc momentanément d’une façon aussi extraordinaire que si Napoléon avait triomphé à Waterloo !
Dans ce personnage épique et tragique à la fois, Balzac nous donne à voir en définitive non seulement la force qui peut animer tel ou tel individu, indépendamment de sa naissance, ou de son rôle dans l’Histoire, mais aussi cet attachement à un système complètement périmé. Comment expliquer qu’une telle force soit si attachée à un ordre disparu ?
Pourquoi Chesnel est-il le héros du livre ?
Si l’on veut savoir ce qui fait le ressort de cette force, il faut le chercher dans la qualité des liens qui unissent Chesnel au marquis, et Balzac insiste là-dessus : Chesnel est « l’homme-lige, le serf attaché par tous les liens du cœur à son suzerain ». C’est un homme « dont les sentiments se résumaient par un attachement unique » qui définissait le sens qu’il avait donné à sa vie.
Rappelons le lien de sens ou de son entre Chesnel, le chien, le vieillard chenu, qui veut se faire enterrer au « bercail », le « fidèle des fidèles » qui « mourut comme un vieux chien fidèle ».
Or ce dévouement, qui fait faire de si grandes choses, qui permet de surpasser Napoléon, dans le domaine microscopique où Balzac le place, n’est possible que dans un certain type de société , la société féodale, dans laquelle le Seigneur est le dieu tutélaire en qui croit le serf : « Aux yeux de Chesnel le marquis était un être qui appartenait toujours à une race divine ». N’oublions pas que le plus cuisant chagrin de Chesnel n’est pas d’avoir perdu toute sa fortune, mais d’avoir perdu l’amitié du marquis quand il voulut proposer à la fille de son maître un mariage qui semblait au marquis faire injure à sa haute noblesse : « Depuis ce jour, il ne retrouva plus dans les manières et les paroles du marquis cette caressante bienveillance qui pouvait passer pour de l’amitié », et toute l’histoire de Chesnel est cette reconquête de l’amitié : « il est des cœurs sublimes auxquels la gratitude semble un payement énorme et qui préfèrent la douce égalité du sentiment que donnent l’harmonie des pensées et la fusion des âmes ». Et comme « le marquis l’avait élevé jusqu’à lui », c’est à nouveau pour retrouver cette place qu’il agit. Il meurt « aussi heureux qu’il pouvait l’être » car « le vieux marquis lui rendit son amitié » Et « ce grand personnage vint dans la petite maison de la rue du Bercail, il s’assit au chevet de son vieux serviteur, dont tous les sacrifices lui étaient inconnus ». Heureux que le marquis « lui permit de se faire enterrer dans la chapelle du château, le corps en travers et au bas de de la fosse où ce quasi-dernier d’Esgrignon devait reposer oui-même ».
Mais il faut remarquer que l’attachement du marquis est tout aussi grand pour son vieux serviteur : « pour le vieux noble, ce bonhomme était moins qu’un enfant et plus qu’un serviteur, il était l’homme lige volontaire ». Et Balzac poursuit en décrivant cette « affection magnifique, une passion semblable à celle que le maître a pour son chien et qui le porterait à se battre avec qui donnerait un coup de pied à sa bête. Il la regarde comme une partie intégrante de son existence ». Voilà ce qui explique le comportement de Chesnel : il appartient à cette classe moyenne qui pour exister pleinement a besoin d’un principe supérieur, d’une foi : « La vertu de Chesnel appartient essentiellement aux classes placées entre les misères du peuple et les grandeurs de l’aristocratie, et qui peuvent unir les modestes vertus du Bourgeois aux sublimes pensées du Noble, en les éclairant aux flambeaux d’une solide instruction ». Balzac fait alors l’éloge de la « domesticité », qui ne relève pas du rapport maître/esclave, mais qui est « grande et belle » quand elle est l’attachement féodal du serviteur à son maître, sentiment qui n’existe, pour Balzac qu’au fond de la province, toujours en retard sur Paris, et qui « honore également la Noblesse qui inspirait de semblables affections, et la Bourgeoisie qui les concevait » : dans ce rapport, le Noble doit se conformer à l’image quasi-divine qu’il doit incarner pour obtenir le dévouement total du serviteur, et chacun y trouve son compte, le Noble mettant sa gloire à être grand, et le serviteur trouvant un sens à son existence, petite et obscure, dans son dévouement. Dans les deux cas une vie animée par des valeurs transcendantes : noblesse, royauté, religion. Car finalement, ce qu’a voulu montrer Balzac, c’est que l’égalité réelle, à supposer qu’elle existe, n’apporte pas ce sentiment de bonheur que procure le dépassement de soi, ou plus simplement la foi en une valeur transcendante. Il n’est que de constater combien la disparition de toute valeur transcendante n’a pas tant, comme on le souhaitait, contribué à la libération de l’individu, qu’à son asservissement à ses instincts individuels.
Nous nous demandions pourquoi Chesnel était un héros : d’une façon particulière, par rapport à l’intrigue du livre, il est le seul qui ne soit ni entièrement « sublime » comme les personnages nobles condamnés à disparaître (le vieux marquis, Armande) ni entièrement trivial (comme du Croisier rêvant de prendre leur place, ou comme les personnages contaminés par cette trivialité, Victurnien, Diane). Chesnel est le seul qui fasse le lien entre ces deux ordres du trivial et du sublime, de l’Esprit et de la matière : en regardant le sublime depuis le trivial, sans chercher, comme du Croisier à en prendre la place. Ce faisant, il est le seul à représenter l’unité perdue de la société.
De manière plus générale, s’il est le héros, c’est parce que le véritable personnage de la Comédie humaine, c’est justement cet individu moyen (la Noblesse appartient au passé). C’est lui dont la Révolution a marqué l’avènement, et c’est lui, désormais, qui est le sujet de l’histoire (ce n’est ni Victurnien, ni son père) et c’est lui dont le narrateur célèbre les vertus (dévouement, fidélité, courage, intelligence). Mais pourquoi cet individu « moyen » se dépasse-t-il ? parce qu’il croit dans la Noblesse. Nous lisons donc clairement la leçon du livre : la grandeur de ce Bourgeois n’est possible que dans le cadre de la féodalité, cadre certes périmé, mais qui donne à Chesnel tout le sens de sa vie.
Nous pouvons conclure en soulignant le paradoxe balzacien : d’un côté un héros bourgeois qu’on célèbre comme s’il était un héros antique, ou comme Napoléon : c’est le caractère réaliste et révolutionnaire de la création balzacienne, dont les héros sont des gens « communs », mais cette grandeur ne peut se déployer que dans un ordre irrémédiablement disparu, voilà pour le côté réaliste et réactionnaire de Balzac qui ne pouvait s’empêcher d’émettre des jugements de valeur sur une société dont il pensait que les perpétuelles mutations conduisaient plus à un déclin qu’à un progrès.