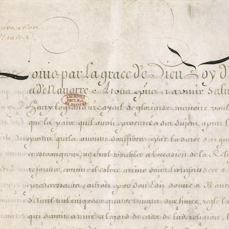Épuisée, Leïla s’arrête. Elle sort un peigne et veut se peigner.
SAÏD, en colère,
N’y touche pas ! (Il arrache le peigne des mains de Leïla et le casse.) Je veux que le soleil, que l’alfa, que les pierres, que le sable, que le vent, que la trace de nos pieds se retournent pour voir passer la femme la plus laide du monde, et la moins chère : ma femme. Et je ne veux plus que tu torches tes yeux, ni ta bave, ni que tu te mouches, ni que tu te laves.
LEÏLA
Je t’obéirai. (Soudain sévère.) Mais moi, je veux – c’est ma laideur gagnée heure par heure qui parle, ou qui parle ? – que tu cesses de regarder en arrière. Je veux que tu me conduises sans broncher au pays de l’ombre et du monstre. Je veux que tu t’enfonces dans le chagrin sans retour. Je veux – c’est ma laideur gagnée minute par minute qui parle – que tu sois sans espoir. Je veux que tu choisisses le mal et toujours le mal. Je veux que tu ne connaisses que la haine et jamais l’amour. Je veux – c’est ma laideur gagnée seconde par seconde qui parle – que tu refuses l’éclat de la nuit, la douceur du silex, et le miel des chardons. Je sais où nous allons, Saïd, et pourquoi nous y allons. Ce n’est pas pour aller quelque part, mais afin que ceux qui nous y envoient restent tranquilles sur un rivage tranquille. (Un long silence. Saïd défait son soulier et vide une pierre qui le gênait. Puis il le remet. D’une voix douce.) C’est pas toi qui as mis le feu aux orangers ?
SAÏD
Non. Mais toi, en partant, tu as mis le feu à la paille ?
LEÏLA
Oui.
SAÏD
Pourquoi ?
LEÏLA, éclatant de rire,
Non, non, ce n’est pas parce que je t’aime. J’aime le feu. (Silence.) Saïd ?…Tu as vraiment pris la décision d’aller jusqu’au bout ?
SAÏD
Si je réussis, plus tard, on pourra dire – et de n’importe qui, je le déclare sans me vanter – : « À côté de Saïd, c’est du nougat ! ». Je te le dis, je suis en train de devenir quelqu’un. Tu viens ?
Ils se remettent en marche…
Edition Folio théâtre, Gallimard, 1997.
Notions utiles
- Connaître les théories d’Artaud sur « le théâtre de la cruauté »
- L’écriture théâtrale (et notamment les rapports texte-didascalie)
Ici encore, la difficulté du sens doit faire l’objet d‘un examen attentif, susceptible de déterminer exactement l’enjeu du dialogue. Mais il faut aborder le commentaire par ce qui, indépendamment du sens exact, nous frappe d’emblée, cette exaltation lyrique et violente qui s’exprime à travers un langue particulièrement riche et imagée.
N.B. La scène se passe en Algérie ; il est probable que les personnages, en révolte contre le colon oppresseur, soient les auteurs des incendies dont il est question dans la scène.
Les propos étranges qu’échangent dans un lieu désertique un couple d’Algériens qui semble au ban de la société ne peuvent manquer de susciter nos interrogations. Si dans un sens, en effet, Genet se révèle ici disciple d’Artaud par la cruauté de cette scène, où les personnages paraissent surenchérir dans leur choix de la laideur et du mal, dans un autre sens cependant les ruptures de ton, le mélange de grossièreté et de lyrisme laissent planer un doute sur cette liturgie du mal ici célébrée. Nous essaierons de montrer en quoi cette difficulté d’interprétation peut nous conduire à définir la marginalité revendiquée comme une marginalité représentée, c’est-à-dire, nécessairement théâtralisée.
I. Le Théâtre de la cruauté
Que cette scène soit le lieu de la cruauté, tous les éléments qui la composent le montrent : l’action, les rapports entre les personnages, comme le langage qu’ils utilisent. La scène est bien cet espace où se libèrent ces forces de mort qui permettent aux personnages d’exprimer sans entraves des désirs que la société réprime.
1. L’action
a) Située dans un lieu précisément asocial – le sable, le vent, les pierres, évoquent le désert algérien – la scène peut se lire comme une réflexion sur le trajet que sont en train d’accomplir les personnages : leur marche silencieuse est en effet interrompue par Leïla (« épuisée, Leïla s’arrête » nous dit la didascalie), les personnages se mettent alors à parler pour préciser le sens de leur quête, puis, à la fin du passage, une autre didascalie : « Ils se remettent en marche ». Cette marche semble donc un véritable calvaire, dans un lieu aride et désolé dont tous les éléments sont hostiles à l’homme : le sable, le vent, le silex, cette pierre encore plus dure que les autres, les chardons, enfin, cette plante du désert dont les épines dures peuvent blesser.
b) C’est pourtant là que les personnages vont montrer la force de leur détermination dans les choix qu’ils ont faits (la double allusion au feu « mis aux orangers » et « à la paille » laisse sous-entendre qu’ils se sont probablement révoltés contre le colon oppresseur) : tout le texte est un commentaire exalté sur le chemin qu’ils sont en train d’accomplir, commentaire ponctué par une marche symbolique – le texte, loin d’être statique, est animé d’une série de verbes de mouvement – comme si, à chacune de leurs paroles, les protagonistes s’enfonçaient un peu plus dans l’abjection : Saïd veut que « les pierres se retournent pour voir passer » sa femme ; Leïla veut qu’il la « conduise au pays de l’ombre et du monstre », et à la fin de sa longue tirade, elle multiplie les allusions à ce chemin cruel : le verbe « aller » revient à trois reprises ; enfin, à son ultime question, (« Saïd, tu as vraiment pris la décision d’aller jusqu’au bout ? »), Saïd répond en associant la marche symbolique et la marche réelle en l’invitant à le suivre : « Tu viens ? », dernière parole mise en scène par la didascalie « Ils se remettent en marche ».
2. Les rapports entre les personnages
Pourtant, cette entente finale n’est pas le fruit d’une entraide mutuelle. Bien au contraire, les didascalies comme les manières de parler montrent la violence des relations entre Saïd et Leïla.
a) Les didascalies montrent en effet tantôt la colère de Saïd, qui ne réprime pas des gestes violents (« en colère…, il arrache le peigne…, le casse ») tantôt les moqueries de Leïla (cf . « éclatant de rire »). Aucune pitié dans cet univers de pierre où les personnages semblent s’appliquer à montrer qu’ils n’ont pas de cœur ;
b) Du reste, les rapports qu’ils entretiennent sont des rapports fondés sur l’asservissement et l’obéissance : Saïd donne des ordres à sa femme (cf. « Je ne veux plus que tu te torches….etc), qui révèlent sa cruauté, puisqu’il veut la rendre encore plus laide qu’elle n’est (proclamant par là peut-être l’étendue d’une misère qui a dû le contraindre à prendre la femme la moins chère, c’est-à-dire, la plus laide du village) ; Leïla, elle, lui est soumise : « Je t’obéirai », ce qui est naturel dans le cadre de la civilisation algérienne, mais de son côté, elle semble être pour lui un guide « sévère » qui lui dicte sa conduite : ainsi aux « Je veux, je ne veux plus… » de Saïd répond la série des mêmes tournures volitives dans la bouche, cette fois, de Leïla ; le verbe revient à sept reprises pour imposer à Saïd le choix du mal sans retour.
c) Ainsi les protagonistes semblent-ils pris dans un double rapport de domination et d’obéissance, où chacun se nourrit de la volonté cruelle de l’autre, dans une recherche commune de l’abjection. Leïla semble moins en ce sens une protagoniste qui s’oppose à son mari, que l’extériorisation de la laideur qu’il recherche (parce que c’est la moins chère à acheter), et dont elle va préciser les enjeux dans sa longue tirade.
3. Le langage
La violence de l’expression de la volonté s’associe ainsi dans ce passage au caractère systématiquement négatif de son objet, que ce soit dans sa nature même, comme dans celle de l’expression choisie pour le dire.
a) Double thématique de la laideur physique d’abord, dans la bouche de Saïd, qui parle de sa femme comme de « la plus laide du monde », laideur provocatrice puisqu’il souhaite que même les éléments inanimés se retournent sur son passage, et qu’il lui impose d’être sale et crasseuse, laideur morale ensuite, réclamée pour Saïd par Leïla forte de sa laideur physique acceptée et même revendiquée (sa parole du reste n’est rien d’autre que l’expression de cette laideur à laquelle elle identifie avec courage toute sa personne, c’est ce que montre le retour de l’expression refrain de sa tirade « c’est ma laideur…qui parle »), et qui souhaite en contrepartie pour Saïd le choix du mal, de la haine et du chagrin.
b) Cette double volonté se manifeste comme une rupture et comme la recherche d’un paroxysme dans la laideur et le mal : des expressions comme « Je ne veux plus que » (Saïd), ou comme « je veux que tu cesses » (Leïla) impliquent le souhait d’une rupture définitive avec l’univers habituel, où précisément, on « se mouche », on « se lave », où l’on peut « regarder en arrière » et faire preuve d’hésitation. Au contraire Saïd comme Leïla prônent un radicalisme du refus : les tournures superlatives utilisées (le femme « la plus laide et la moins chère »), les adverbes hyperboliques* (le mal et toujours le mal, la haine et jamais l’amour), les circonstanciels négatifs (« sans espoir, sans retour, sans broncher »), les formules restrictives (que tu ne connaisses que la haine), le temps de plus en plus rapide (les heures, puis les minutes, puis les secondes), tout cela figure une détermination de plus en plus farouche à suivre sans faillir (c’est du moins le vœu de Leïla) la voie du mal et de l’abjection, et apparaît, somme toute, comme un chemin de croix inversé où la montée au ciel est remplacée par une descente « dans le pays de l’ombre et du monstre » complètement assumée.
c) Ainsi ce que nous retenons de cette lecture, c’est cette utilisation concertée de la cruauté visant à faire disparaître toute trace de la respectabilité et même de l’humanité dont la société semble avoir partiellement privé nos deux protagonistes (n’oublions pas que la scène se passe dans une Algérie colonisée où les colons ne considèrent pas les Arabes comme des égaux).
Pourtant certains éléments du texte semblent s’inscrire en faux contre cette interprétation et nous faire douter de l’authenticité de ce refus.
II. Ruptures et contradictions
Les ruptures de ton, en effet, comme les deux mouvements très différents, voire contradictoires de la scène, nous conduisent à approfondir la signification de cette marginalité définie par l’inversion des valeurs et à nous interroger sur le sens réel de ce refus que clament les personnages
1. Les ruptures de ton
Elles apparaissent dans les indications données par les didascalies comme dans le niveau de langue utilisé.
a) Leïla surtout semble comme imprévisible dans ses réactions : « soudain sévère », elle prononce une longue tirade poétique et solennelle, puis « d’une voix douce » passe à une question qui semble n’avoir aucun rapport avec ce qui précède, puis « elle éclate de rire » : tous ces changements déstabilisent le spectateur, comme du reste la variété des niveaux de langue employés : la première tirade de Saïd relève du style poétique, tantôt ample et grandiloquent (cf. l’anaphore* de la conjonction « que » introduisant une succession de sujets qui reproduisent un même rythme de trois syllabes, qui s’élargit dans le dernier terme de l’énumération : « Je veux que le soleil, que l’alfa, que les pierres, que le sable, que le vent, que la trace de nos pas… »), tantôt violent et grossier dans la dernière phrase de cette tirade : « Je ne veux plus que tu torches tes yeux, ni ta bave, ni que tu te mouches, ni que tu te laves » : la double entorse grammaticale (le possessif « tes » au lieu d’un pronom personnel « te » complément d’attribution) et l’économie de la reprise du verbe régime devant « ni ta bave » qui porte indûment la négation, donnent à voir cette violence redoublée par des parallélismes sonores : « ni ta bave, ni que tu te laves », ou rythmiques : « ni que tu te mouches, ni que tu te laves ».
b) Quant au langage de Leïla, il est franchement incantatoire et lyrique* : les mots qu’elle utilise appartiennent au registre* élevé (le chagrin, l’ombre, le monstre, la haine, le rivage…etc) ; un rythme binaire, rendu quelquefois plus sensible par les assonances*, assure l’équilibre de l’énonciation cf. « le pays de l’ombre et du monstre » ou « le mal est toujours le mal » ou encore « je sais où nous allons et pourquoi nous y allons » ; les reprises de mots ou de tournures (cf. la préposition « sans » qui revient à trois reprises, le retour du même refrain « c’est ma laideur gagnée…, etc… » qui ponctue le texte en y introduisant à chaque fois une petite variation destinée à créer une impression d’urgence, enfin les périphrases (le pays de l’ombre et du monstre), et les images oxymoriques* (« l’éclat de la nuit, la douceur du silex, le miel des chardons »), tout cela transforme la scène en une liturgie solennelle.
c) Or, le geste qui clôt cette tirade et qui est indiqué par la didascalie (Un long silence. Saïd défait son soulier et vide une pierre qui le gênait. Puis il le remet.) contribue à mettre à plat cet effet incantatoire, comme si Saïd n’avait pas écouté, d’autant qu’ensuite la conversation prend un tour tout autre : on rentre dans le prosaïsme, les tournures appartiennent au langage parlé (ainsi de l’élision de la négation, comme l’absence d’inversion de l’interrogation dans « c’est pas toi qui as mis… », et le choc de ce projet quasi-métaphysique « d’aller jusqu’au bout » avec la confirmation vulgaire qu’en donne Saïd : « Si je réussis… on pourra dire – et de n’importe qui, je le déclare sans me vanter – à côté de Saïd, c’est du nougat ! » : le ton solennel du début de la phrase contraste avec la familiarité de l’expression triviale et populaire : « c’est du nougat ».
Ainsi, cette disparate de tonalité, ou de langage, égare le spectateur et rend moins évident le sens de cette recherche du mal pour le mal, comme elle efface le caractère tragique de cet enfoncement dans le pays de l’ombre et du monstre.
2. Les contradictions
Mais plus encore que cette diversité, les contradictions qui affleurent dans la scène ne peuvent manquer de susciter des interrogations.
a) En effet, la scène est composée de deux mouvements très différents (le volume même des répliques l’indique clairement), où s’opposent les voix incantatoires et un dialogue qui semble à la fois confirmer mais aussi mettre en doute la volonté affichée des deux personnages. Si brusquement Leïla demande à Saïd s’il est responsable de l’incendie commis dans l’orangeraie, c’est qu’elle pense probablement à ce choix du mal et de la révolte dont elle croit qu’il est commun à tous les deux (cf. l’utilisation de la première personne du pluriel « je sais où nous allons… etc… ») ; mais le geste trivial et banal de Saïd, qui, à ce moment là, se déchausse pour vider une pierre de sa chaussure, brise cet espoir d’union, fût-elle dans le mal, et la fait douter de la détermination de Saïd. C’est peut-être ce qui explique le changement de registre (« d’une voix douce ») et sa question. Or Saïd « après une courte hésitation » lui répond par la négative : est-ce à dire qu’il ment en disant non, ou alors qu’il dit la vérité et qu’il n’est pas l’incendiaire ? Dans le premier cas, il a peut-être peur, ou bien il se méfie de Leïla, mais de toute manière, il est loin de ces sentiments entiers qu’elle attendait de lui, et dans le deuxième cas, il n’est pas non plus ce révolté qu’elle souhaite qu’il soit, et du même coup, la longue tirade de Leïla serait une manière de le convaincre d’être celui qu’il n’a pas la force d’être, comme on pouvait d’ailleurs le comprendre quand elle dit « je veux que tu cesses de regarder en arrière ». Quelle est donc la nature de ce personnage ? une âme exceptionnelle ou une baudruche qui se paie de mots, et qui arbore la laideur de sa femme pour se dispenser d’assumer par lui-même le choix qu’il prétend faire ?
b) De même, ce qui a motivé le geste de Leïla, quand elle a « mis le feu à la paille » reste tout aussi confus : elle n’a pu commettre cet acte répréhensible, dit-elle, par amour pour Saïd, et pour rejoindre en quelque sorte sa marginalité, car l’amour n’a pas de place dans cet univers inversé où ils choisissent de vivre. Mais dit-elle la vérité, et est-ce pour autant le goût du mal ou l’impulsion de la haine qui l’ont guidée ? Sa réponse (« ce n’est pas parce que je t’aime. J’aime le feu ») peut ressembler à une dénégation (en réalité, c’est peut-être pour suivre Saïd qu’elle a pu agir de cette façon), ou bien, si elle dit vrai, son comportement peut apparaître comme une liberté d’action fondée sur le seul plaisir, ce qui ne correspond pas vraiment avec cette recherche systématique de la marginalité qu’elle prétend avoir choisie presque par sainteté inversée, puisque cette déchéance qu’elle s’inflige (et le contraire d’un plaisir) est la condition de la « tranquillité » même de tous les autres : « Je sais où nous allons, Saïd, et pourquoi nous y allons. Ce n’est pas pour aller quelque part, mais afin que ceux qui nous y envoient restent tranquilles sur un rivage tranquille. ».
On voit donc que les motivations des deux personnages sont confuses, plus claires, peut-être pour Leïla, mais en tout cas, différentes l’une de l’autre, à tel point que Leïla, plus sûre d’elle au début qu’à la fin, demande une confirmation à Saïd : « Tu as vraiment pris la décision d’aller jusqu’au bout ? »
3. Une marginalité problématique
a) Plus généralement, ce qui est problématique ici, dans cette recherche de la marginalité, c’est le rapport à la société qui affleure à plusieurs reprises. La société est-elle ce repoussoir que les personnages fuient pour assumer l’abjection totale à laquelle elle les a contraints, ou bien est-elle ce « théâtre » où, pour exister, s’exhibe une marginalité encore mal assumée (comme invite à le penser la dernière réplique de Saïd) ? En tout cas, on ne sait pas si l’abjection est une révolte métaphysique, ou bien un consentement au sacrifice pour la tranquillité des autres, à moins qu’elle ne soit peut-être imposée par une société qui y trouve son compte et voit dans l’exclusion des révoltés le moyen d’assurer sa tranquillité ; et dans ce dernier cas, les personnages, transformant en un choix orgueilleux cette exclusion de fait, ne feraient que se prêter à une comédie contrainte.
b) De même, le souhait d’« aller jusqu’au bout » qu’on avait compris comme l’enfoncement jusqu’à la mort dans la haine et le chagrin, semble devoir fournir à Saïd l’occasion d’être admiré : la phrase, pleine de détours, faits pour aboutir à l’exclamation où il prononce son propre éloge (à côté de Saïd, c’est du nougat ! ») se donne comme une comparaison, non de Saïd avec autrui, mais de tous les autres avec Saïd, qui devient comme l’étalon inégalé de la valeur (inversée) des individus (« on pourra dire de n’importe qui »), ou encore le parangon de la dureté et de la méchanceté ; cette phrase apporte bien la preuve que le signe de la réussite est ici le regard d’autrui et la sanction que le monde apporte à l’abjection du personnage, et il n’y a rien de plus pathétique dans cette scène que cette incompréhension implicite entre cette femme qui, pour l’amour de son mari peut-être, est décidée à se couper définitivement de la société et à aller avec lui affronter la mort, et cet homme, partagé entre cette volonté révoltée, et son désir de jouer un rôle, « d’être quelqu’un » dans la société.
Quel est donc le sens de cette scène qui finit sur ces mots vaniteux ? Le pronom « quelqu’un » à lui tout seul implique à lui seul la présence d’une société où l’on n’est plus anonyme : est-ce là encore bien compatible avec les choix affichés comme avec la situation extra-textuelle (ils marchent dans un désert).
III. La représentation de la marginalité
Toutes ces questions nous conduisent à conclure que peut-être les personnages ne parlent que pour parler, parce qu’ils souhaitent l’impossible, (du reste, on doit remarquer qu’ils ne parlent que sur le mode volitif) ; aussi voudront-ils donner une importance particulière à cette seule possibilité qui leur reste : parler devant un public. Car c’est probablement parce qu’ils ont une volonté contradictoire que la seule façon de la réaliser passe par la fiction d’une représentation.
1. L’impossible choix
En réalité ce que souhaitent les deux personnages n’est ni réalisable ni cohérent :
a) Ce n’est pas réalisable, parce que la volonté qui s’affirme n’est pas simplement de faire l’envers du bien, ni de choisir positivement le mal. Car même le mal, s’il est le fruit d’un choix positif, est le signe d’une énergie, d’une force vitale, que Leïla refuse : tel est le sens de la phrase mystérieuse qu’elle prononce au milieu de sa tirade : « Je veux que tu refuses l’éclat de la nuit, la douceur du silex, et le miel des chardons » : Les éléments négatifs (la nuit, le silex, les chardons) dans la mesure où ils auraient été acquis dans ce désir inversé du malheur pourraient signifier la réussite de la quête et devenir en quelque sorte un gain glorieux : c’est ce qu’expriment les substantifs euphoriques* « éclat, douceur, et miel ». C’est ce caractère positif de la quête qui est à son tour logiquement refusé (« Je veux que tu refuses… ») ; les personnages ne sont pas à la recherche d’une victoire, fût-elle l’inverse de ce qu’on entend par là, mais d’une défaite, ou plus précisément, d’une victoire constamment différée, puisque tout gain, même celui du mal, est dénoncé.
b) Cette volonté n’est pas cohérente non plus, parce qu’elle repose, pour Saïd du moins explicitement, nous l’avons compris, sur une marginalité qui a besoin du regard de la société pour se justifier et pour faire exister ceux qui l’ont choisie : de même que la laideur de Leïla est provocatrice, de même que les pierres doivent se retourner sur son passage, de même, la haine de Saïd doit le transformer en un être exceptionnel qui fasse précisément l’objet d’un discours admiratif (il parle de lui à la troisième personne dans la dernière réplique), qui précisément l’oppose au reste de l’humanité sans exception (« on pourra dire, et de n’importe qui, je le dis sans me vanter… »).
Comment donc être à la fois « ici », loin de ce rivage tranquille où se trouve le reste de la société, et désirer être l’objet de tous les regards ?
2. Le spectacle d’une volonté
a) Comment faire, si l’on n’est rien d’autre que le regard que les autres jettent sur nous, et si l’aboutissement souhaité n’est jamais atteint, sinon de représenter cette volonté si peu sûre d’elle, pour qu’elle se donne en spectacle afin de mieux s’affirmer ? À la fin du passage, en effet, on ne peut qu’être frappé par le changement des temps utilisés : l’ensemble du dialogue déterminait un temps futur susceptible de réaliser la double volonté des personnages (cf. « Je veux que… » ou bien « si je réussis, on pourra dire… »), mais la dernière parole de Saïd : « Je te le dis, je suis en train de devenir quelqu’un » montre que l’illusion est devenue réalité pour Saïd, et que ce futur s’est réalisé, dans ce lieu désertique où ils marchent sans autre but que la mort.
b) Mais, par un renversement quasi-infernal, cette fatuité fondée sur le mensonge et l’illusion (qui s’oppose au désir de sainteté de Leïla, et qui montre que, contrairement à elle, Saïd ne pense qu’à lui), loin de contredire les propos qu’elle tient, apparaît au contraire comme la seule manière de gagner ce pari (impossible à tenir réellement) de reculer sans cesse la frontière du mal : en effet, n’est-ce pas le comble de l’abjection que de se repaître de mots et de se mentir à soi-même, que de maintenir dans le mépris cette femme qui semble se sacrifier pour lui ? Qui sait même si, pour toucher le fonds même de l’abjection, Saïd n’est pas en train d’inventer un mensonge (devenir quelqu’un) auquel il ne croit pas plus que nous, pour paraître, aux yeux de Leïla, qui prend ici la place de la société, l’être le plus faible et le plus vil possible, et ainsi, appliquer, sans tenir aucun compte du sort de sa femme, le « programme » d’abjection qu’elle a fixé ? On voit que l’interprétation peut se creuser à l’infini, et que la force du dramaturge est d’avoir donné en définitive cette épaisseur et cette complexité inhérentes aux motivations humaines.
3. Les spectateurs
a) La représentation que se donnent les personnages justifie donc la représentation à laquelle nous assistons, mais avec cette différence que nous devenons peut-être pour l’auteur, Jean Genet lui-même, la justification de sa propre marginalité, dont il veut exprimer toutes les faces, à travers ces deux protagonistes : sentiment d’exclusion, conscience d’un sacrifice, volonté de provoquer, et d’exhiber sa différence. Nous sommes alors à la fois ceux qui le condamnons, et ceux qui l’admirons, ceux pour lesquels, comme Leïla, il a le sentiment de se sacrifier : nous devenons alors nous-mêmes acteurs de cette sinistre comédie grâce à laquelle nous pouvons « rester tranquilles sur un rivage tranquille ».
b) Ainsi nous sommes maintenant en mesure de dire que l’expression théâtrale s’avère être la seule façon pour J. Genet de proclamer cette marginalité si contradictoire, puisque le sentiment d’exclusion passe en même temps par la volonté de sa représentation sous les yeux du plus grand nombre.
La force du dramaturge est donc d’avoir donné à ce sentiment d’exclusion qu’il explore dans ce texte une représentation qui apporte la résolution des contradictions qu’il implique. Genet le fait par l’intermédiaire de personnages pour lesquels la mise en place de l’illusion (et donc la représentation théâtrale) constitue la seule façon d’exister, mais il sait laisser en même temps enfouie dans les replis secrets de leur cœur la clé de leur motivation puisqu’en définitive on a de la peine à évaluer jusqu’à quel point ces personnages (et surtout Saïd, dont Leïla, personnage plus simple, n’est que le faire-valoir) jouent à être ce qu’ils disent. Et c’est dans la présence de ce mystère suggéré au cours de ce dialogue étonnant que J. Genet peut recréer sans la détruire la complexité du cœur humain.