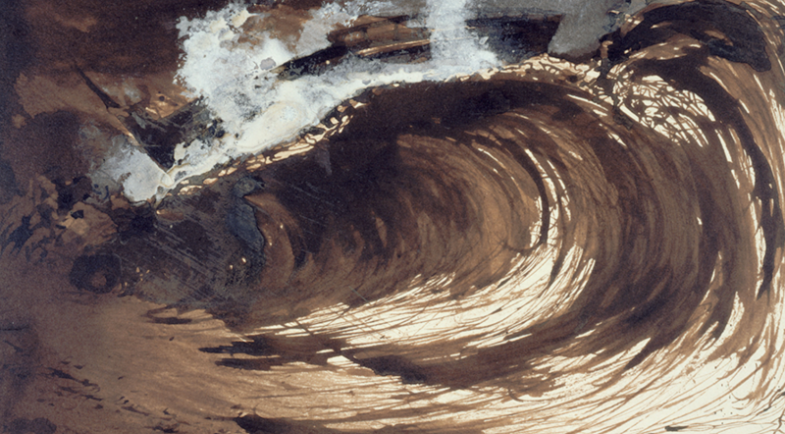Cette section est la grande transition entre l’âme en fleur et Pauca meae. Elle reste d’un côté sur la terre : le poète décrit le mal social, et garde toujours cet amour de la nature déjà présent dans le livre précédent. Mais la Femme a disparu ; et cet amour pour la nature est lié soit à une réflexion métaphysique soit à une réflexion métapoétique. En effet d’un autre côté apparaît l’angoisse de la mort, la sienne propre, comme celle des enfants morts. Et il importe de voir si à ce stade, des solutions sont présentées à ce double problème du mal sur terre, de la société, comme de la mort. Cette percée dans la métaphysique va donner du poète une nouvelle image, dans laquelle la Contemplation prendra un tout autre sens.
1. Le mal sur terre
Ce mal est donc à la fois le mal social et le mal existentiel, la mort.
A. Deux poèmes surtout le mettent en scène : Melancholia et « Choses vues un jour de printemps » montrent de façon poétique le malheur des pauvres gens, la faim, la prostitution, l’injustice qui fait travailler les enfants, et l'on passe là du pathétique à l’invective.
Dans Melancholia, est brossé un tableau noir de la société qui fait triompher les mauvais et condamner les bons (que ce soit les Pauvres, les animaux, le génie, les amants, tous ceux qui manifestent leur humilité ou leur liaison avec la nature). On y voit non seulement la misère humaine, mais aussi son rejet total par les nantis qui rient au sort des malheureux.
Choses vues… raconte un fait divers qui montre comment la faim vient à bout d’une pauvre femme : « C’est l’immense assassin qui sort de nos ténèbres » (NOS ténèbres) D’où la question qui est posée à Dieu : le scandale de la misère, la nature dans sa simplicité se comportant mieux que la société (Pourquoi le nid a-t-il ce qui manque au berceau ? vers 60). De même Melancholia finissait d’ailleurs sur une invocation à la nature.
B. Deux autres poèmes citent des malheurs particuliers : la peine de mort : le poème XXIX oppose tous les usages positifs de l’arbre qui consent volontiers à être abattu pour cela ( avec une vision poétique de toutes les constructions de bois, liées au savoir-faire de l’homme pour son bien-être), à son refus catégorique quand on lui demande « Veux-tu être gibet, » car il ne veut pas souiller la nature et les arbres par de tels crimes. De même dans Melancholia, juste à la fin, l’image sinistre de la guillotine, qui sort d’elle-même de la terre comme si c’était un mal généré par cette société violente contre elle-même avec cette ambiguïté de l’image finale : est-ce le châtiment qui menace les riches, ou la « justice » qui protège les possédants ?
Le poème X intitulé Amour oppose cette loi de la Nature qui veut que tout respire l’amour, à la loi des hommes qui le condamnent. La force du désir pour la Beauté s’inscrit dans un cadre naturel (l’oiseau, le ruisseau, les fleurs). Tout s’unit pour provoquer le désir amoureux. Mais la société le condamne ! et Hugo ridiculise cette condamnation en représentant un procès grotesque où sont accusés ces instigateurs précisément que sont « la vie, la nature, les cieux, le vague enchantement des champs mystérieux » etc.
À cette expérience du malheur et à cette sensibilité à la méchanceté de la société s’ajoute l’angoisse de la mort (cf. Claudel : « le sentiment le plus habituel chez Hugo, c’est l’épouvante ») . Il y a quelques poèmes où le poète pose des questions ici encore sans réponse :
L’interrogation sur ce que voient ceux qui vont mourir : dans Melancholia, la mort pathétique du cheval (vers 175 sq) :
Et dans l’ombre, pendant que son bourreau redouble
Il regarde Quelqu’un de sa prunelle trouble ;
Et l’on voit lentement s’éteindre humble et terni
Son œil plein des stupeurs sombres de l’infini
Où luit vaguement l’âme effrayante des choses…
C’est que désormais le poète « songe souvent à ce que font les morts » et surtout il s’interroge et s’angoisse. Ainsi dans « Joies du soir » (nommé presque par antithèse) poème XXVI, le poète, au milieu de la gaîté d’une soirée, au lieu de voir les buveurs attablés, voit soudain des morts :
Tandis que gais et joyeux, heurtant les escabeaux
Ils mêlent aux refrains leurs amours peu farouches,
Les lettres des chansons qui sortent de leurs bouches
Vont écrire autour d’eux leurs noms sur leurs tombeaux.
S'ensuit une série de questions sur le passage de la vie à la mort, avec ce même regard angoissé sur l’œil du mourant : « souvent je me suis dit : qu’est-ce donc qu’il regarde, cet œil effaré du mourant ? »
L’interrogation est encore plus angoissante quand il s’agit de la mort des enfants : trois poèmes annonciateurs de Pauca meae, et tous datés de 1843 : dans le poème XIV, À la Mère de l’enfant mort, c’est un discours que n’aurait pas dû faire la mère à son enfant (qui veut rejoindre le Paradis qu’elle lui décrit et qui fait que « l’oiseau s’est envolé » : serait-ce un reproche voilé à la croyance du bonheur après la mort ? et qu’il faut être sensible d’abord à la beauté de la terre, avant de songer que :
Le ciel est un dôme aux merveilleux pilastres…
Un jardin bleu rempli de lys qui sont des astres…
Le poème XV est un reproche à la Nature à qui il ne sert à rien d’avoir tué un enfant, alors que le cœur de la mère est un abîme de désolation. Le poème XXIII raconte la mort d’un enfant et la naissance d’un autre. Or cet autre, « le Revenant » justement, celui dont la mère pense qu’il ne remplacera jamais le mort, (La mère restait morne…) se met à lui dire tout bas « C’est moi, ne le dis pas ! ». Ce Revenant n’est pas un fantôme. Il naît une seconde fois. Peut-être est-ce un récit métaphorique pour dire justement que ce sont en réalité les morts qui reviennent pour consoler les vivants, ce qui nous amène à examiner les solutions proposées, qui sont de l’ordre de la métaphysique, que ce soit pour le malheur social comme pour la mort.
2. Les solutions ?
Elles sont de deux sortes, mais l’une est plus une supposition, alors que l’autre poursuit son rôle de grande consolatrice : la première, c’est l’idée d’un renversement où la mort serait la vraie vie, la deuxième, c’est la solution de la nature.
L’antithèse est généralisée : elle se manifeste de plusieurs façons :
Les morts sont les vivants ; cf. Saturne section II : « J’en suis venu à croire »…que « faits vivants par le sépulcre même/ nous irions tous une jour…/ Lire l’œuvre infinie et l’éternel poème » (une supposition seulement cf. les conditionnels, le verbe « croire ») avec la conviction que la vie éternelle est réservée à ceux qui ont souffert ; cf. les Malheureux (V).
Le malheur social trouve sa solution au Ciel. Mais c’est une supposition où la mort serait finalement la transformation de tous en poètes puisque sur terre le poète est celui qui lit le livre de Dieu, c’est-à-dire de la nature. De même dans le poème V, bâti sur de constantes antithèses, ceux qui passent sont ceux qui vivent, ceux qui restent sont en réalité les morts, et aux faux biens (gloire, bonheur…) s’opposent les vrais royaumes : « Vivants, vous êtes des fantômes ! / C’est nous qui sommes les vivants ! ».
Toutefois cette croyance en est ici au stade du désir plus qu’à celui de la conviction (ce sera différent dans les derniers livres ; cf. les vers 28 sq de A Villequier)
La nécessité de l’union malheur/bonheur comme l’ombre est l’envers de la lumière : le projet divin est incompréhensible, qui voudrait que le malheur soit justifié par une sorte d’harmonie à un niveau supérieur. On peut comparer les poèmes XI et XVIII : le premier oppose les 21 premiers vers au dernier : un malheur général, au dernier vers « Et que tout cela fasse un astre dans les cieux ! »
De la même façon dans le poème XVIII, lors d'une dispute entre des gueux, avec des insultes (silence, assassin/ tais-toi, prostituée ! »), le poète entend ces cris par la fenêtre ouverte et tandis que « ce couple hideux… sans honte et sans pudeur étalait ses nudités » leur vitre était « grâce au soleil une « éclatante étoile :
Qui dans ce même instant vive et pure lueur
Eblouissait au loin quelque passant rêveur.
Reversement des choses : fleur du mal, la vitre du sordide renvoie un éclair de pureté !
La nature apparaît toujours comme le havre de pureté et de paix face au malheur de la société. C’est elle aussi qui permet d’accepter l’idée de la mort. Il y a ainsi une célébration de la nature mais sur un ton beaucoup plus grave que dans le livre précédent. On a vu l’asile qu’elle représentait face à la méchanceté des hommes dans Melancholia. Et le seul poème adressé à une jeune-fille (IX) n’est pas un hymne à l’amour mais à une beauté qui reflète celle de la nature :
Et les marins d’Hydra s’ils te voyaient sans voile
Te prendraient pour l’amour aux cheveux pleins d’étoile
Et c’est la beauté comme l’amour répandus dans la nature qui font accepter l’idée de la mort, qui sont un réconfort aux questions angoissantes ; cf. poème I « Pourvu qu’on ait à sa fenêtre/une montagne, un bois, l’océan… » on peut voir en soi-même « éclore des clartés effrayantes ». Et dans le poème XXII, où encore une fois exactement comme dans le poème précédent, le regard sur la nature va permettre de penser en soi-même (à l’inverse de « L’âme en fleurs »). La vision du dehors suscite la vision intérieure : d’abord une attention à l’extérieur (« le blé vert sort des sillons bruns etc » mais le poète « l’œil plein de visions de l’ombre intérieure » songe aux « morts, ces délivrés ». Et dans ce cadre, il peut penser à sa propre disparition.
….. J’aurai ma tombe aussi dans l’herbe
Blanche au milieu du frais gazon
On y lira – Passant, cette pierre te cache
Les ruines d’une prison »
Cette pointe finale, en guise d’épitaphe nous montre que le tombeau abrite un corps en ruine qui n’était que la prison de l’âme. Et qu’est-ce que cette âme ? Celle de cette vie universelle répandue dans toute la nature, et dont seuls les morts peut-être peuvent prendre la mesure, surtout si leur tombe (ce n’est pas le Panthéon, justement ! pauvre Hugo !) se trouve dans « l’herbe BLANCHE ». Le même vœu est exprimé dans le poème XXIV « Aux arbres » : la solitude de la forêt permet au poète de rentrer en lui-même (et non plus de penser à l’amour) et il éprouve le désir de rester à jamais à l’ombre de ces arbres :
C’est sous votre branchage auguste et solitaire
Que je veux abriter mon sépulcre ignoré…
Le même désir de se fondre dans cette nature joue dans cette partie le rôle de réconfort contre la société, mais un réconfort non pour y vivre (cf. les autres romantiques) mais pour y mourir.
3. Le poète
Mais ces solutions ne sont pas générales. Elles semblent soit faire appel à une croyance qu’on peut ou non partager, soit être vécues par quelqu’un qui est lui-même poète. Ce qui caractérise cette section, c’est la confiance dans les pouvoirs de la poésie saisie d’abord comme une intimité avec les choses de la nature. Cette intimité fondée sur l’amour du poète pour les choses, ce sentiment qu’il appartient au même règne que tout ce qui est dans la nature lui permet de nommer le monde, de comprendre ses mystères cachés (à l’inverse du livre précédent). Mais s'opère ici un double mouvement annonciateur de la suite car en même temps que cette confiance, une appréhension se fait jour.
A. La confiance : dans le poème VIII (« Je lisais ») le poète pensif est courbé pour déchiffrer « la corolle et la branche » (pas encore pour parler aux tombeaux). Tout le poème est une vaste métaphore de la nature-livre et le poète est celui qui déchiffre le livre et nomme les choses :
…. Il n’est rien dans tout ce que peut sonder l’homme
Qui bien questionné par l’âme ne se nomme.
Il y a donc comme « une lumière répandue sur toute chose : « tout est plein de jour, même la nuit » Et c’est parce que le poète aime la nature qu’il veut la nommer et la comprendre « Comprendre ? c’est aimer » Ainsi seuls les hommes qui savent lire comprennent Dieu, le Vrai, le réel ; c’est l’homme injuste qui fait des contre-sens, en ne voyant pas que tout dans la création est un signe, un chiffre qui renvoie à Dieu ; Et Hugo montre ici comment la vision extérieure peut communiquer avec la vision intérieure :
Toute l’immensité sombre, bleue, étoilée
Traverse l’humble fleur du penseur contemplée
On voit les champs, mais c’est de Dieu qu’on s’éblouit.
Il s’agit de plonger si fort dans la fleur qu’on y lise le destin de l’étoile : liaison du plus petit au plus grand (cf. XXIV l’atome est le monde)
Dans le poème XXIV le poète se représente dans la même position « pensif, le front baissé, l’œil dans l’herbe profonde ». Et la contemplation de cette nature lui fait concevoir l’idée de Dieu :
Dans votre solitude où je rentre en moi-même
Je sens quelqu’un de grand qui m’écoute et qui m’aime.
Donc contempler c'est :
- aimer
- Nommer
- Sentir la présence de Dieu
Cet amour est dit aussi en XXVII où à la première personne il exprime son amour pour tout ce qui est méprisé, haï, laid (l’araignée et l’ortie) car « tout est plein de jour, même la nuit », « tout veut un baiser ». Donc un poète plein d’amour pour les choses humbles surtout pour celles qui justement manquent d’amour : l’araignée et l’ortie rejoignent les pauvres hères de Melancholia.
C'es cette force de ce pouvoir de nomination qui lui donne le nom de Poète ; cf. le I qui place le livre sous l’inspiration de Dante (les luttes plus le ciel) qui montre que celui qui est le plus haut dans l’échelle des êtres c’est le poète « Maintenant je suis homme et je m’appelle Dante » car avoir un nom, c’est vraiment être homme, c’est perdre l’anonymat de l’exil, ou de la pauvreté (« Le mendiant »)
B. Pourtant il y a des moments de doute, de retrait, d’appréhension même dans cette quête de la nomination qui est une quête du mystère : le génie hué de Melancholia ; dans Saturne, si le monde s’ouvre, ce n’est pas le fait de l’amour mais par « une fêlure aux réalités faite » : la fêlure implique que quelque chose s’est brisé, qu’il y a comme le sentiment d’un manque devant une réalité qui n’est plus intacte, qui entraîne la contemplation ; et l’angoisse naît de la contemplation de cette fêlure. De même en VIII qui pourtant rapporte les paroles du doux martinet approuvant le poète en train de lire la page pleine qu’est le champ, le poète finit par « hélas tu te trompes… » ; le poète est un homme comme les autres « car l’homme quoi qu’il fasse est aveugle ou méchant » (autrement dit il est faux de dire que la Poésie permet d’atteindre le bonheur). Le poème XX montre le calvaire du poète toujours poursuivi par sa Muse qui le réveille même quand « il ronfle comme un bœuf » ! Le Penseur est un « forçat » au service de « l’idée implacable ». Son corps peut souffrir, mais il doit travailler : « Et l’ange étreint Jacob, et l’âme tient le corps » pas de résistance possible à une tâche qui lui est imposée ; et la fin est une belle image tâchant de faire comprendre qu’il est mené il ne sait où, il « va, » comme Hermann et son double, il lui faut :
Traverser effaré les clairières désertes
Le champ plein de tombeaux, les eaux, les herbes vertes
Et franchir la forêt, le torrent, le hallier,
Noir cheval galopant sous le noir cavalier.
Enfin le poète du poème XXVIII nous montre une tout autre image que celle d’un poète dans la nature : regard fixe, pâle, il va « farouche fauve… son crâne transparent est plein d’âmes, de corps / de rêves dont on voit la lueur du dehors… » C’est « un génie étrange où l’on perd son chemin », donc comme une créature monstrueuse pour qui l’intérieur se confond avec l’extérieur (il est tout entier dans les choses qu’il voit) il va jusqu’aux entrailles des choses comme des hommes pour « ouvrir et fouiller leurs flancs »et pour finir Hugo le compare au noir lion des jungles qui s’endort dans l’antre immense « avec du sang aux ongles ».
On voit comment se surimposent deux images bien différentes : le poète dramatique ici, le poète de l’idylle ailleurs. Ce sera dans la suite que Hugo fera la synthèse de ces deux définitions, à commencer par le poème Magnitudo Parvi.
4. La Contemplation
On pourrait parler des contemplations, car il y en a plusieurs, et de sortes différentes dans le livre :
- On ne mentionnera que comme rappel celle qu’entraîne un sentiment d’intimité avec la nature, quand l’amour de la femme permet de comprendre les choses.
- Apparaît cette deuxième contemplation où la nature est un cadre qui permet au poète de rentrer en lui-même pour y trouver de célestes visions. « Saturne » est très clair à ce sujet.
- L’intimité avec la nature c’est donc aussi cette attention contemplative (VIII et XXIV) qui, de la même façon, fait passer de la compréhension de la chose à l’univers tout entier : « la contemplation me remplit le cœur d’amour », depuis l’amour de la fleur, de l’objet le plus humble, jusqu’à Dieu (Magnitudo Parvi). Cette contemplation suppose une identification à l’objet, mais surtout un abandon de tout ce qui peut séparer l’homme du cycle naturel. Il doit en quelque sorte retrouver l’instinct de la Bête : c’est ce qui explique l’attention aux bêtes dans ce livre, cf. Le poème XIX : dans la longue réflexion sur le regard du lion qui regarde le poète qui le regarde à son tour, il voit dans ses yeux à la fois ce qu’il est, lui, l’homme, : « notre petitesse ivre de sa puissance, notre moi misérable » et dans le regard de la bête qui est celui de qui n’est pas un « individu », il voit le moi de la nature :
L’être sauvage obscur et tranquille qui cause
Avec la roche énorme et les petites fleurs... ;
La Brute qui rugit sous les nuits constellées
Qui rêve…
Et porte en son œil calme où l’infini commence
Le regard éternel de la nature immense.
- Enfin la dernière étape est la prise de conscience que la contemplation abolit l’objet, dissout la frontière entre moi et le monde, c’est ce qu’explique le grand poème de Magnitudo Parvi.
5. Magnitudo parvi
Le poème nous donne deux définitions de la Contemplation :
D’une part il nous montre l’identité entre la vision de l’univers et la vision à l’intérieur d’un crâne, créant la correspondance entre macrocosme et microcosme. Le feu du pâtre, c’est aussi l’étoile, et il revient au même de contempler le monde ou le cœur de l’homme, car dans la contemplation intérieure l’homme fait passer le monde tout entier, il s’élève autant « que sont hauts les astres du ciel » et cela pourquoi ?
Et dépassant la créature
Montant toujours, toujours accru
IL regarde tant la nature
Que la nature a disparu !
Et encore « contempler les choses, c’est finir par ne plus les voir :
La matière tombe, détruite
Devant l’esprit aux yeux de lynx
Voir, c’est rejeter..
Donc « voir » n’est plus « aimer » mais finir par ne plus voir, par rejeter ce qui est visible, la matière, pour aller vers l’invisible : le pâtre ne voit plus la vigne mûre, ni l’aube dorant les prairies etc. mais « il voit l’astre unique ; il voit Dieu ! »
Ainsi en dernier ressort la contemplation est la contemplation de Dieu, une conquête donc (cf les vers 609 sq ) ; et peut-être avec l’idée d’avoir presque commis un blasphème plutôt que de l’avoir révélé. Et dans Pauca meae, Hugo dira qu’il a été puni de cette volonté sacrilège de percer, depuis la vie, le grand mystère du monde : comprendre, dira-t-il dans « Trois ans après » c’est risquer de finir par ne plus aimer. (le contraire de « comprendre c’est aimer !)
Le poème Magnitudo Parvi assure donc très nettement le passage d’un volume à l’autre, et le lecteur, comme le poète peuvent aborder « Aujourd’hui » où bien loin pour le poète et sa fille d'être tous deux vivants, on entendra un mort parlant à une morte.