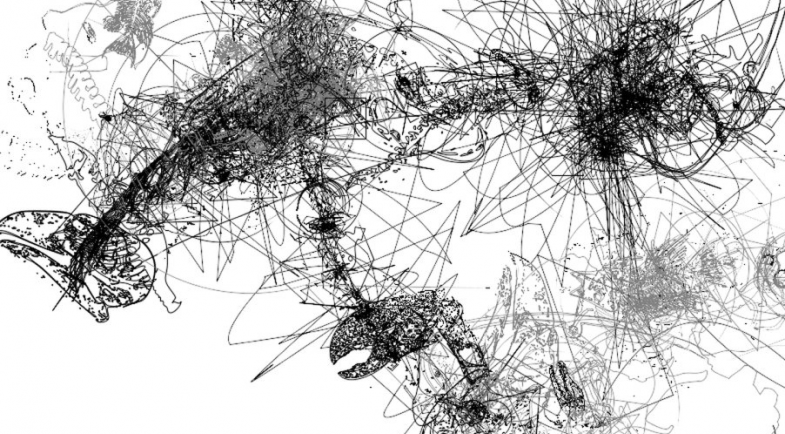« Les bourreaux en héritage : réflexions sur le témoin et l’héritier à propos des Bienveillantes de Jonathan Littel », in Luba Jurgenson et Alexandre Prstojevic (éd.), Des témoins aux héritiers : l’écriture de la Shoah et la culture européenne, éd. Pétra, 2012, IIIè partie, p 337-368.
Comme leurs lointains ancêtres, les Juifs modernes savent qu’il est dangereux de donner un visage aux exécuteurs, de les doter d’identité et de réflexion, de leur autoriser le moindre doute ou regret, de les rendre humains. Seul le souvenir de leurs actes doit être conservé. Et moi, qu’ai-je fait ? Je m’obstine à fouiller des territoires inexplorés et à présenter Amaleq avec tous ses traits comme un agrégat de fonctionnaires allemands.
Raul Hilberg, Politique de la mémoire.
Un effort d’historicisation des « littératures de la Shoah » s’exprime depuis une vingtaine d’années en France, suivant un mouvement de sécularisation critique qui s’est déclenché d’abord aux États-Unis et en Allemagne au début des années 90. Pour des raisons historiques et culturelles à la fois, ce processus a été extrêmement tardif par rapport à celui de production des œuvres. Avoir rendu coupable la « littérature après Auschwitz » a longtemps empêché de lire les témoignages aussi comme des textes, et de lire comme d’éventuels témoignages les fictions écrites par les rescapés, même si leur appartenance au « genre testimonial » reste discutée, comme ce «genre» lui-même1. La littérarisation avait pourtant commencé avec l’acte de témoigner, comme le montre l’abondante littérature2 issue des ghettos de l’Est.
L’attention portée à ce processus continue de faire réémerger la réalité d’une multiplicité de poétiques en évolution selon les contextes et horizons d’attente, variables dans l’espace et le temps. Malgré la multiplication des lectures morales et des « philosophies du témoignage », on interroge à présent en tant que tel cet énorme continent littéraire, qui continue de croître, avec les instruments hérités de la poétique et de la philologie, de l’histoire littéraire et de l’histoire culturelle. Cette réappropriation critique d’un matériau philologique revient à construire un objet littéraire spécifique, dont l’histoire, fortement arrimée à un événement historique, n’en est pas moins appelée à s’inscrire dans une histoire culturelle plus large. Le témoignage qui fait œuvre s’inscrit dans une histoire des œuvres appelée à s’inscrire dans « l’histoire littéraire », à charge pour celle-ci de rappeler quel événement a donné naissance à ces œuvres.
Le passage « des témoins aux héritiers » est un tournant important dans ce processus culturel inhérent à la transmission. Mais cette formule ne va pas de soi, car la notion d’héritage, équivoque et chargée, peut ici désigner plusieurs choses différentes : à la fois un legs généalogique, un moment historique, une situation culturelle, une opération éthique.
« Hériter »
Ce passage des témoins aux héritiers, qu’on est tenté d’assimiler à une « passation » et une « succession » à la fois, sans pouvoir a priori cerner qui en est le sujet ni le destinataire, tous deux collectifs, ne peut pas être pensé en termes judiciaires et « héréditaires »3. Hériter, ici, ce n’est pas recevoir d’un parent ou d’un proche des « biens » ou un « droit » dont on détiendrait le « titre », « l’usage » ou la « jouissance » en vertu d’un acte volontaire ou d’une loi : la « voie de succession » emprunte d’autres chemins, et pour commencer celui de la perte.
Cet héritage négatif ne s’arrête pourtant pas à un legs familial douloureux, ni aux effets trans-générationnels des traumatismes. Il n’est pas seulement ce que laissent les défunts aux vivants – du témoignage écrit à la simple injonction de vivre faite aux enfants. Ce dont il faut hériter est aussi le fait historique de la disparition massive des « défunts » comme effet d’une volonté politique. S’il y a « héritage », il désigne autant le souvenir et les traces laissés par les disparus aux plus proches, que cette tentative d’effacement d’un peuple sous les yeux du monde.
Ce passage n’est pas non plus seulement le moment présent du relais que rend nécessaire la prochaine disparition des derniers témoins, comme des derniers acteurs, qui achèvera de faire de cette expérience historique un événement passé et un héritage livresque, objet d’histoire et de littérature. C’est aussi un passage symbolique qui implique, sinon un acte moral, une possibilité éthique : il suppose que ceux qui n’ont pas vécu cette histoire en reçoivent un sens et en fassent usage, voire en transmettent quelque chose. L’héritage, c’est la « page d’histoire » qui devait n’être pas écrite, comme l’avait dit Himmler, et qu’il faut écrire pour empêcher l’effacement. Il n’est pas un don, mais une tâche, qui vaut pour les témoins, les survivants, les descendants, mais aussi pour ce monde qui a vu sans voir, ou qui sait sans savoir. Pesant sur tous, il vaut pour les générations d’après, dont dépend la continuité donc l’existence d’un « monde ».
On présente souvent ce passage comme celui du particulier à l’universel, mais cette abstraction ne signifie en réalité qu’elle-même. Le legs ici, c’est plutôt l’événement en tant que vécu par l’autre, c’est cette solitude historique de l’autre à comprendre comme le résultat d’une histoire commune et comme le problème de chacun.
Cette passation-là s’inscrit dans un présent ininterrompu. Ce présent existait déjà pour les contemporains de l’événement, dont certains, travaillant à devenir témoins, se sont fait héritiers du présent, dépositaires du sens qu’il prenait pour eux. L’héritier alors c’est le témoin à la fois du crime et de la victime, son proche, son voisin, celui qui a vu ou qui a su, qui n’oubliera pas et en reparlera : c’est Milosz et son « pauvre Polonais » qui « regarde le ghetto ». Celui qui par un poème demande que ce regard devienne celui de témoin au sens fort – processus qu’on peut dire aujourd’hui accompli en Pologne, à la faveur d’un changement de génération.
Cet héritier du présent diffère profondément de celui qui, venu plus tard ou né après, n’a pas vu, mais a lu, et qui fait sien ce legs à travers les livres qu’il a à sa disposition : livres de témoignages, d’histoire, de littérature. Dans cette bibliothèque de la Catastrophe « in progress », le corpus rassemblé ne se définit que par son objet – la Catastrophe, son histoire, sa mémoire, mais aussi son imaginaire, ses représentations. Les poèmes de Milosz en font partie à côté de Si c’est un homme de Primo Levi, le Chant du peuple juif assassiné de Katzenelson, Baby Yar de Kousnetsov, W de Perec, Shoah de Lanzmann, La Destruction des Juifs d’Europe de Hilberg, ou Les Bienveillantes de Littell, Les Disparus de Mendelsohn...
Le « témoignage » est la première « voie de succession ». Sa transmission passe par un jeu de relais culturel, ce qui suppose, pour les survivants, une solution de compromis et une forme d’abandon concerté à d’autres exigences que la fidélité à l’expérience : c’est la part consentie à l’art, à l’œuvre et à son public. Le legs passe par un acte de lecture plus ou moins libre, livré à tous les aléatoires que suppose un processus de réception, surtout lorsqu’il se réalise à l’échelle mondiale. Il ne devrait pas faire parler de « passage de témoins », sauf à survolter cette notion de témoin et à en exténuer le sens : c’est bien d’héritier qu’il s’agit au contraire. Il peut arriver que l’héritier refuse son héritage – ce qui arrive chaque jour en chaque point du globe. Mais il ne suffit pas qu’il accepte cet héritage pour devenir témoin. Ce dont il hérite est une mémoire qui, au-delà de l’acte de recueillement, prend la forme d’un récit collectif, d’une culture.
L’héritage passe par une transmission culturelle, voire une politique culturelle : le fameux « travail de mémoire », fait lui aussi de plusieurs choses. Derrière l’organisation politique de la lutte contre l’oubli, aujourd’hui gérée par les instances internationales, un partage de mémoire se soumet à certains cadres culturels et sociaux, qui règlent les modalités de l’héritage en fonction de facteurs fonctionnels ou de contingences qui ne relèvent d’aucune tâche éthique. Une société n’est pas un sujet moral. Une culture non plus. Reste à penser ce que peut être un héritage culturel lorsque la «culture» est celle de «l’holocauste».
L’ironie culturelle
Malgré la légitimité de l’historicisation, il y a une certaine ironie à étudier l’histoire culturelle d’un génocide : à considérer qu’il s’agit là d’un objet culturel parmi d’autres, à voir cette mémoire, grevée par l’événement dont elle a la charge, prendre place dans le tout-venant de systèmes symboliques qui ont précédé la destruction, puis lui ont survécu – pour partie au moins. Et il y a un vrai problème à se poster, au moment de lire cette littérature, dans cette survivance culturelle sans en prendre conscience. Chaque « document de culture » peut devenir un « document de barbarie », disait Walter Benjamin en 1940 dans ses Thèses sur le concept d’histoire. Il voulait y penser l’histoire sous le signe de la Catastrophe, mais aussi rendre suspecte la notion d’héritage ou de patrimoine, entendue comme l’ensemble des « biens culturels » amassés au cours d’une histoire racontée par les vainqueurs.
La dialectique historique de Benjamin n’avait pas prévu qu’il existerait un puissant patrimoine culturel issu de l’histoire des vaincus, si l’on peut parler ainsi des disparus et des survivants d’un génocide. L’élaboration d’une histoire culturelle de la Shoah n’en rend que plus actuelle cette suspicion à l’égard de l’héritage, conçu comme transmission de «biens culturels» sourde à la construction idéologique qui la rend possible. Si la culture de la mémoire ne se soumet pas, elle et ses mythes, à une critique de la culture, elle produira des documents de barbarie. Cette critique, on la voit d’ailleurs s’accomplir dans la littérature de témoignage la plus réflexive. Mais cela ne supprime pas l’ironie en question : cela lui permet de s’exprimer, par la voie de l’ironie aussi, chez certains rescapés : Kertész présente le survivant comme l’otage de la culture mémorielle dans L’Holocauste comme culture. L’héritage comme tâche éthique peut à tout moment se renverser en force d’inertie culturelle, et la culture du témoignage devenir un enfer pavé de bonnes intentions mémorielles.
Cette ironie n’est pas la même que celle de l’histoire, qui faisait avancer l’Ange de Benjamin à reculons, et qui oblige à réduire un crime contre l’humanité à un événement historique. Elle jette une lumière crue sur cet étrange objet qu’est la « culture » : cet objet que nous croyons toujours nôtre alors qu’il nous a depuis longtemps échappé, pour notre bonheur et notre malheur, car son rôle s’est confirmé dans les épisodes les plus noirs de la civilisation. Cette ironie-là fait résonner en creux l’idée de culture, qui, tandis que nous diversifions nos objets, nous observe du haut de sa puissance de nivellement.
La bibliothèque in progress dont je parlais plus haut, quelle que soit l’émotion esthétique que peut susciter telle ou telle œuvre, n’engendre pas le mélange d’euphorie et de mélancolie douce propre à l’amateur d’art et de livres, mais une inquiétude spécifique : un conflit intérieur de basse intensité, qui peut vite devenir un dégoût violent ; une nausée, je dirais, culturelle, au sens où la culture est ce domaine qui se sépare irrésistiblement de la vie en pesant son propre poids, suivant ses propres forces, étrangères à celles qui nourrissent la pensée créatrice et la mémoire vive. Cette séparation, lointainement issue du schisme intime que suppose le geste créateur, est liée aux mécanismes collectifs de réception et de digestion des œuvres. Or tout cela se trouve réuni dans le vaste contenant nommé mémoire4. La littérature de la Shoah est vouée à cette promiscuité, à cette ironie : elle s’en défend, mais elle en vit aussi. Ce paradoxe inquiétant, par moments dégoûtant, c’est ce qu’Imre Kertész appelle « l’holocauste comme culture »5.
Le roman du « bourreau » comme miroir culturel
Or cette ironie se met à grincer très fort à l’endroit où prend place, dans cette culture, la figure du « bourreau ». Cette figure joue aujourd’hui un rôle majeur dans ce fameux « héritage culturel », au point d’éclipser la « victime »6, elle aussi devenue une « figure » dans ce jeu de rôles où la mémoire est piégée. Ces mots, pour lesquels Piotr Rawicz disait son dégoût moqueur dans les années 1960, signent déjà une culture d’héritiers. Mais en quel sens ici faut-il comprendre l’héritage? Qu’en est-il de la tâche éthique et de l’inertie culturelle ? Que peut signifier le bourreau nazi en tant qu’héritage ? Que se passe-t-il lorsqu’une telle réalité historique devient une figure, et même un mythe culturel? Le mot «bourreau» est déjà un vêtement mythique, et l’adjonction de certains adjectifs forge des paradoxes qui sont à eux seuls des récits mythiques : aux deux pôles extrêmes on a le « bourreau ordinaire » et le « bourreau cultivé ».
Ordinaire ou cultivé, le «bourreau» semble être devenu le chiffre de l’événement, voire sa clé : on cherche l’explication du crime dans ceux qui l’ont conçu, relayé, exécuté. Comme si son sens s’était déposé dans leur personne, leur visage, leurs paroles, leurs gestes, leur culture. On étudie leur langage, on explore leur pensée, comme autant de voies pour arriver à l’acte muet qui fait d’un bourreau ce qu’il est, ou plutôt ce qu’il est devenu – c’est là l’énigme. Si ce devenir-bourreau requiert comme jamais l’attention des chercheurs, c’est à titre d’énigme à élucider, par déduction ou par empathie. Rien d’étonnant à ce qu’il intéresse aussi les écrivains, au prix de disputes dont la violence dérisoire fait partie de l’ironie en question.
Tout va très bien mais rien ne va plus lorsqu’un écrivain – je parle bien sûr de Jonathan Littell et des Bienveillantes (Gallimard, 2006) – fait sortir le bourreau de son mutisme, et campe un ancien nazi ricanant, pleurant, baisant, mais surtout parlant, à la cantonade et en confidence, de politique bien sûr, mais aussi d’art, de science et de littérature ; bref, un héros malade et pérorant, affilié aux grands bavards modernes et postmodernes, mais qui se toque de raconter, lui, la totalité de l’extermination des Juifs telle qu’il l’a vue et vécue. Ce « nazi cultivé », qui n’est pas « ordinaire » pour deux sous, nous raconte non seulement l’holocauste, mais l’holocauste comme œuvre de culture : le nazisme en tant qu’univers mental, monde foisonnant de signes, de livres, d’idées – bref de culture, toute (auto)destructrice qu’elle soit.
Son récit est lui-même rempli de culture. C’est un récit sacrificiel et orphique, gorgé de références littéraires et savantes. À travers son narrateur nous parvient le visage grimaçant de la culture, instrument de destruction et fonction digestive – même si cette digestion se fait mal pour Aue – et aussi pour Littell. Ce roman fait apparaître l’héritage de l’holocauste sous un jour inquiétant : cette histoire inassumable à jamais s’y montre vouée à toutes les moulinettes de la fiction littéraire, y compris celle de bourreaux de bazar, qui lisent tout ce qui sort sur la Shoah pour mieux raconter leur histoire, mais se passent des récits des victimes.
Chez Littell, l’imagination de l’héritier se présente comme telle : forte d’une liberté claironnante, déprimante, qui lui fait prêter sa voix au seul « bourreau » et imaginer les victimes à travers son seul regard et sa seule conscience. Un regard toujours dégradant, qu’il soit froid, libidineux ou apitoyé; une conscience dénuée de toute piété, quoique encombrée de mémoire jusqu’à l’asphyxie. Armé d’un certain esprit de sérieux et de méthode, l’héritier explore les infamies et arguties qui ont rendu naturel le crime. Désespérément narcissique, son récit est truffé de fiches de lecture, car l’ex-SS s’intéresse de près, en revanche, aux travaux des chercheurs. Plongé dans un bain de culture nazie violemment exotique, tout en pataugeant dans un bouillon de culture mémorielle, le lecteur doit s’y perdre et s’y reconnaître à la fois. L’auteur a fait ce qu’il faut pour cela, multipliant les idiomes nazis et effets d’opacité, mais aussi les passerelles et échos entre cette culture et la sienne. La mémoire imaginaire de l’héritier, c’est cette promiscuité « fraternelle », culturelle, entre le nazi qui raconte et le lecteur qui l’écoute. Cette mémoire se sait et se veut odieuse : si Litell dédie son roman aux morts, c’est qu’il refuse de consoler les vivants.
L’ironie, ici, c’est que l’héritage devienne un si vaste contenant qu’il puisse rassembler la « culture nazie » et la « culture de l’holocauste », la culture du crime et celle du travail de mémoire. Le roman reflète cette ironie sans que l’auteur l’ait voulu tout à fait, car il a la foi du charbonnier en matière d’ « espace littéraire » : il est tombé dans la marmite de Blanchot quand il était petit. Lorsqu’un nazi, au cœur de cet espace mythique, ou au-devant de la scène littéraire, chuchote de trop près son message trop humain à nos consciences de démocrates cultivés, la mémoire de l’holocauste, que nous avions tendance à confondre avec le témoignage des victimes, se rappelle à nous en tant que culture, et se transforme même en petit scandale culturel.
L’« écriture du mal » et la « phalange des témoins »
Ceux qui protestent, eux, parlent d’un scandale moral : celui qui consiste à montrer avec complaisance la destruction des victimes du point de vue du destructeur, à camper un personnage de « bourreau » pour lui confier la chronique des faits, à lui faire « usurper » le rôle du témoin, et occuper la place de la victime. Le romancier responsable de cette usurpation devient alors vite lui-même un « imposteur », un traître : il trahit à la fois l’histoire, le témoignage, la littérature. On lui déclare la guerre, on publie des pamphlets.
Dans cette littérature polémique, on se réclame du « témoignage des victimes » comme d’une arme. Pour dénoncer les abus de la fiction, on reprend la protestation de Jean Cayrol devant la littérature de « krema » – en oubliant son propre « romanesque concentrationnaire », et ce que doit l’étrange « merveilleux » de son « Camp lustral » à son propre refus de témoigner. On rappelle, comme un fondement critique, la « guerre acharnée » de Norton Cru contre les faux témoins et la « fausse littérature » de guerre7, on relance le combat de la «phalange de témoins honnêtes »8 contre la « phalange redoutable des imposteurs »9, et l’histoire du témoignage devient celle d’une reprise de « flambeau »10.
Ou bien, pour en découdre avec « l’écriture du mal »11, on se réclame de la haute exigence éthique du témoin du Goulag que fut Varlam Chalamov, mais en nettoyant sa poétique du « document » des tensions et contradictions qui nourrissent son œuvre et lui donnent sa violence, en oubliant le droit d’auteur que lui fit formuler son « Cherry Brandy » dans Les Récits de la Kolyma12. On cite le réquisitoire d’Elizabeth Costello, dans le roman de J.M. Coetzee, contre la représentation littéraire d’un supplice nazi, en oubliant que ce personnage lui- même fictionnel s’apprête à mourir, et que l’auteur, qui n’a cessé d’interroger l’héritage des bourreaux à partir de l’histoire de l’Afrique du sud, se reconnaîtrait mal dans une telle catéchèse humaniste. Ou même, on en revient à l’avertissement prophétique de Platon contre la fascination pour le spectacle des corps mutilés, rejouant sans sourciller la partition du Beau, du Vrai et du Bien.
L’énergie déployée à tout cela semble à chaque fois faire oublier certains faits tout simples. En premier lieu, les victimes ont vu de près les horreurs qu’il ne faut pas voir. Dans leur immense majorité, les témoignages nous les font voir, parfois même avec insistance, on pourrait presque dire avec complaisance et mauvais goût, si leur lecture n’obligeait à renoncer à certaines modalités du jugement13. Mais prendre acte de cette violence supposerait de lire cette littérature-là jusqu’au bout, et non quelques textes canonisés, retenus précisément parce qu’ils mettent l’atrocité à distance, et entrent plus aisément dans un patrimoine littéraire commun – donc aussi scolaire, propice au projet d’instruire, former et édifier.
Brandir comme un argument le témoignage dépouillé d’Antelme et Levi, c’est oublier le continent des récits de massacres et chroniques de ghetto, remplis de détails atroces, relatés sur un ton souvent traversé d’imprécations et d’appels à la vengeance d’une véhémence désespérée. Se réclamer de la pureté éthique de Chalamov contre « l’écriture du mal », c’est oublier son immersion presque hypnotique dans l’univers des « truands », expérience que seul le « talent » poétique pouvait selon lui reconduire dans la sphère du « bien », sans que la « connaissance strictement négative » du témoin devienne pour autant « positive ». En appeler à l’injonction d’une beauté morale subordonnée à la « vérité », c’est oublier les romans de Piotr Rawicz, Louis Begley, Jerzy Kosinsky, et bien d’autres, qui jugèrent bon de fictionnaliser leur expérience, dont faisaient partie le mensonge vital et la fable nécessaire.
Mobiliser «le témoignage» dans un combat contre « le mal », c’est renoncer à lire les textes en tant que formes-sens dans ce qu’elles ont de singulier, de violent, d’incertain. C’est oublier que la littérature la plus
moralement exigeante ne peut créer sans mimer, et que s’approprier les forces destructrices suppose de travailler au plus près. C’est oublier Dante prenant à bras-le-corps Lucifer. C’est peut-être ignorer tout bonnement ce qu’est la littérature elle-même, ou ce qu’elle a été très tôt en Occident : une technique pour approcher, capter et détourner la violence des actes humains dans celle du verbe, jouer d’un logos et d’un mythos intimement mêlés, que la Raison a artificiellement séparés, et que l’activité de la poïesis n’a cessé de vouloir réunir. La littérature de témoignage poursuit cet effort d’expressivité, devenu défi radical. Au moment de faire œuvre, les rescapés passent certains contrats avec la puissance de destruction qui les a traversés, mais qui leur reste, à eux aussi, étrangère et indéchiffrable : il leur faut penser leur expérience à partir de cette méconnaissance. Sans ces contrats la littérature n’existerait pas, et celle de témoignage se réduirait à une masse de récits illisibles.
Faire de Primo Lévi le modèle du « témoignage des victimes », supposé contraire à toute exploration de la mentalité nazie, c’est oublier celui qui, inquiet, se remémorant le regard qu’avait posé sur lui à Auschwitz un certain docteur, aurait voulu expliquer à partir de là « l’essence de la folie du IIIe Reich » (Si c’est un homme) ; celui qui, dans les Naufragés et les rescapés, recommandait la lecture des mémoires de Rudolf Höss, qu’il avait préfacées, comme il l’avait fait de l’étrange roman de Jacques Presser, La Nuit des Girondins : dans ce récit sulfureux, l’auteur, rescapé et historien, imaginait un Kapo collaborant, fasciné, avec les SS du camp de transit de Westerbork, et narrer ses ignominies, pour finir par rejoindre un convoi en partance pour Auschwitz.
À tort ou à raison, les victimes n’ont cessé de vouloir comprendre leurs bourreaux et leur volonté exterminatrice. Les premiers écrivains à tenter d’imaginer le point de vue du nazi furent des survivants ; et certains d’entre eux, exaspérés par l’idéalisation des victimes, poussèrent l’iconoclasme jusqu’à brouiller les frontières ou renverser les rôles : qu’on pense au roman picaresque d’Edgar Hilsenrath, Le Nazi et le friseur, ou à la pièce de René Kalisky, Jim le téméraire. Imre Kertész, on le voit dans son Journal de galère, lisait attentivement le Journal de Nuremberg de Gustave Gilbert14, le psychologue américain qui encadrait les accusés du procès, à l’époque où il écrivait Être sans destin. Il avait d’ailleurs débuté en littérature en faisant écrire un « bourreau » esthète à la première personne : sa tentative avait échoué, mais il en reste un fragment significatif dans Le Refus (1988) sous le titre « Moi, le bourreau ». Dans Roman policier, court récit paru peu après Être sans destin, le narrateur campe un petit tueur des services de sécurité sévissant en Argentine, histoire d’éviter la censure hongroise.
L’existence de cette « zone grise » littéraire, considérable dans les textes de fiction, mériterait une étude en soi, qui chercherait à comprendre ce que visait chaque auteur en jouant ainsi à changer de point de vue, et en quoi ce jeu relève encore ou pas d’une forme de témoignage dans l’esprit de l’auteur. Car l’héritage des bourreaux concerne le rescapé aussi, et peut-être d’abord, plus intimement et violemment que personne, au point qu’il lui faut écarter ce fardeau pour pouvoir vivre et penser. Mais le polémiste ne veut rien voir ni savoir de ces jeux troubles ni de cette intimité forcée, livré qu’il est, lui, à la violence d’un dégoût qui lui fait se boucher les oreilles et les yeux lorsque parle le témoin, mais qui s’abat pleinement sur la fiction de l’héritier.
Le nazi cultivé et le témoin SS : réalité, imposture, fiction ?
Ce qui suscite ce noli me tangere, dans le cas exemplaire des Bienveillantes, c’est la manière dont la violence nazie entre en collusion avec la culture en tant qu’héritage, et dont le romancier qui représente cette collusion avec complaisance prétend néanmoins au titre d’héritier – et en ceci la judéité de l’auteur n’a sans doute joué qu’un rôle d’autorisation à la trangression. Littell, on s’en souvient, a dédié « aux morts » ses Bienveillantes : c’était son droit le plus strict, mais ainsi il écartait d’un geste la parole vivante des victimes, pour ne plus faire parler que le SS. Le litige, me semble-t-il, est triple : il concerne le nazi candidat à l’héritage culturel, le narrateur ex-SS candidat au témoignage, et le romancier candidat à l’héritage mémoriel. Le scandale, c’est à la fois le nazi cultivé, le nazi témoin, et le romancier-imposteur héritier.
Concernant le premier, on s’étonne qu’il puisse même exister, car il suppose d’ignorer une réalité largement étudiée et documentée – y compris à travers les témoignages. Non, dit ce discours, les SS n’étaient pas des hommes « cultivés », les exécuteurs d’un génocide sont toujours des brutes. Ce qui signifie : oui, notre culture est intacte, et doit le rester. Une telle position, qui jamais n’éclaircit ce qu’il en est de la « culture », tient pour rien l’importante production historique, sociologique et anthropologique, relative à la culture nazie – de George Mosse à Saul Friedländer en passant par Jean-Pierre Faye et Christian Ingrao – qui vient de consacrer une étude significative aux intellectuels SS15. Et elle jette aux oubliettes l’un des héritages judéo-allemands les plus précieux de la modernité : celui de la « critique de la culture » telle qu’elle s’est exprimée de Walter Benjamin à Paul Celan en passant par l’École de Francfort.
La question du nazi devenu « témoin », elle, est une vraie question – ou plutôt elle pourrait le devenir, si là encore on tentait de rendre compte de ce qui existe. Il faudrait interroger sous l’angle du témoignage les nombreuses dépositions des accusés qui, lors des procès de Nuremberg, Francfort et Jérusalem, ont également joué le rôle de témoins, et pas seulement d’accusés.
Les criminels n’ont pas seulement laissé des traces de leurs crimes, malgré leurs efforts : ils l’ont raconté, le plus souvent parce qu’ils y voyaient une chance de sauver leur vie ou de diminuer leur peine. Comment faut-il appeler leurs récits ?
Si l’on retire à ces « aveux » le titre de témoignage, c’est au nom d’une acception restrictive de la notion de témoin, réduite à celle de rescapé en vertu de l’antique analogie avec le mot martyr. Un tel choix fait renoncer à penser le régime testimonial de l’aveu, et élimine la figure du témoin oculaire, elle, de provenance juridique. Or l’usage de la notion de témoin devrait tenir compte de toutes ces significations, en les distinguant sans en effacer aucune. L’actuel recouvrement du « testis » (le tiers garant) par le « superstes » (le rescapé), lié aux origines religieuses de la figure du « témoin », actuellement recyclée en philosophie du sublime ou herméneutique chrétienne16 – relègue au second plan une littérature testimoniale en un autre sens, décisive au plan éthique et majeure au plan littéraire : celle des témoins non-juifs de l’extermination.
La question n’est pas de savoir si un nazi peut être un « témoin fiable », ni évidemment une victime, mais si un acteur du génocide peut être considéré comme un « témoin oculaire ». Or quelle que soit la restriction de son champ de vision, l’exécuteur a vu ce qu’il a fait, ce que faisaient ces pairs, il a agi, parlé et pensé comme eux. Il détient sur ce collectif des « Täter »(« criminels ») un savoir évidemment essentiel pour l’historien et le juge, mais nécessaire aussi à qui veut penser ce qu’il en est de l’homme transformé en Täter – et cette réflexion fait pleinement partie de l’héritage en tant que tâche éthique et politique : ce qu’a de discutable la vogue culturelle du bourreau n’annule en rien ce point, pas plus que la veine martyrologique, tout aussi discutable, n’annule l’appel éthique que constitue le témoignage des victimes.
En ceci la version des faits que produit le tueur est bien un témoignage livré aux héritiers : celui du crime, certes accompagné de son déni, qui lui fait présenter son activité passée comme un « travail » éprouvant lié à une « fonction ». Ce qu’il livre est moins une part de vérité qu’une espèce de vérité, qui, toute partielle qu’elle soit, livre au jour une part de la réalité, sans en faire un acte éthique pour autant. Car contrairement à une idée en vogue elle aussi, le témoignage n’est pas une activité éthique en soi : elle peut le devenir, ce qui chez les hauts responsables nazis n’est arrivé que de manière incertaine et limitée, ce dont témoigne le livre de Gitta Sereny sur Stangl.
Enfin lorsqu’un pseudo-nazi d’apparat semble devenir un témoin conscient de son crime, dans une fiction qui suscite des effets d’empathie chez le lecteur, la question devient autre, et elle se complique en effet. Mais on s’égare si on la dissocie du jeu d’empathie fictionnelle propre à l’œuvre : sa signification morale ou amorale ne peut être saisie qu’à partir du projet littéraire et de ses apories ou contradictions17. Imaginer un ex-SS témoigner de l’extermination ne signifie pas qu’un SS ait jamais témoigné ainsi, ni qu’aucun puisse jamais le faire, ni enfin que le romancier prétende qu’une telle chose est possible. La pathologie qui affecte Aue et sa narration fantasmagorique dit plutôt le contraire.
Fiction d’héritier
La troisième question, celle du romancier comme héritier, suppose de prendre acte des intentions de l’auteur, et d’évaluer ce qu’il fait, ou ce qu’il renonce à faire, à l’aune de ce qu’il voulait ou disait vouloir faire18. Or les intentions explicites de Littell, comme son considérable travail de documentation et de réflexion, montrent que son intention majeure, au moins au départ, était d’élucider l’énigme du Täterkollektiv nazi. Le sérieux presque scolaire de l’étude sur la prose fasciste parue peu après, Le Sec et l’humide, montre que ce souci de compréhension perdure et survit au succès littéraire. Si cette visée a été interpolée, et même contredite, par la veine orphique de cette écriture, qui a cédé au grand jeu de l’« expérience-limite », elle n’a pas disparu pour autant. Hériter, pour Littell, c’est accepter de se voir, en tant que « frère humain », au miroir d’une fiction de parole nazie. Ce miroir est pervers, mais de cette perversion on peut avoir un usage éthique, même si le roman n’en offre aucune garantie : hériter, pour le lecteur de Littell qui prend acte de l’état du monde présent, c’est affronter la destructivité de ce monde, armé d’une autre culture, qui ne protège toujours rien.
Mais le polémiste ne s’intéresse pas à de telles contradictions ; il ne peut se permettre de perdre ce temps philologique et critique sur l’objet qu’il déteste, ni prendre en compte ce temps long du travail fourni par l’auteur, pas plus que ses intentions réelles. Il ne veut d’ailleurs pas voir là de la vraie littérature, mais une « imposture fictionnelle » et un « coup » médiatique, un « roman à succès » ou « roman de gare ». On a même pu dire que ce roman n’était « pas de la littérature »19. Mais que peut-il bien être alors ? De quel idéal se réclame-t-on pour en refuser l’entrée ? Quant à l’argument selon lequel il s’agit de mauvaise littérature, plus tenable, il est toujours contaminé par celui de l’opportunisme ou de la perversité de l’auteur, comme s’il fallait fourbir toutes les armes à la fois contre la bête immonde.
Par cet évident déni de littérature, une certaine idée de l’art et de la culture tente de se protéger d’une menace jugée mortelle. Ce réflexe irrationnel, qui fait se cramponner à un puissant idéal de culture tout en refusant son accès à une œuvre qui la met en péril, montre à quel point ce royaume de la Culture est fissuré de part en part. Or cette fissure, le survivant la connaît bien lui-même, et il est rare que son témoignage n’en fasse pas état. Plus d’un texte y puise son ressort réflexif, voire son principe d’écriture et de composition. C’est précisément de cette fissure, peut-être, que parlent à la fois la littérature de témoignage et le roman du bourreau. Il faudrait donc plutôt chercher ce qui se voit, se dit et s’écrit de commun et de différent en ce point crucial où elles se rejoignent, de part et d’autre de leurs places et régimes d’énonciation.
À travers le dégoût du bourreau littéraire, c’est en fait la culture de l’héritier qui fait scandale : celui d’une permissivité qui rend tout possible, y compris la mise au silence des victimes et de leur expérience, via une fiction donnant tout pouvoir au pseudo-SS. Tout se passe alors comme si c’en était trop. On proteste à la fois contre l’inspiration nihiliste du livre, contre l’empathie qui donne lieu à cette représentation de l’histoire, jugée offensante à l’égard des victimes – ce qu’elle est en effet –, contre son lancement médiatique et son succès. Et cet amalgame, c’est le nazi cultivé devenu héritage culturel, offert, lui et ses assassinés, au spectacle et à la consommation. Ce faisant, on proteste contre une certaine manière d’hériter, et on refuse l’imprévisibilité de l’héritage. L’histoire propose (sa réalité atroce), l’héritier dispose (ses fables à loisir). Quoi de plus révoltant en effet ? Ce n’est pourtant là que l’usage de la liberté artistique et la fonction d’adaptation sociale de la culture. Cette extensibilité protoplasmique, euphorisante et abrutissante, c’est le « théorème de l’amorphisme humain » (R. Musil) transposé dans le domaine des œuvres et des discours. Ce théorème s’était illustré dans l’existence effective d’une culture nazie, et dans sa puissance de destruction. Il s’illustre aujourd’hui dans le libre jeu des héritiers, leurs fantaisies et leurs équivoques effrayantes.
La liberté de Littell est d’avoir donné la parole à un homme cultivé capable de contribuer à l’extermination, puis de la raconter par-dessus le marché – le marché culturel, bien sûr, où l’ex-SS brigue sa place à la rubrique « mémoire de la Shoah ». Car le froid désespoir de Aue ne l’a pas privé de son petit bagage de lectures, qui le rend si bavard. Son bavardage, par sa voix de fausset, nous fait revenir au « document de culture » via Drieu et Brasillach, mais aussi Bataille et Blanchot, Villon et Céline. C’est à cela, à ce trouble jeté sur l’appartenance commune à la culture européenne, que sert la fiction du SS francophile et esthète. Incestueux, il parvient par éclats à saisir l’absurdité du massacre à travers l’amour qu’il porte à sa sœur, mais n’en éprouve aucun remords, puisque le destin fait justice à la place des hommes. Si, derrière ce déguisement tragique, le propos nihiliste de Littell n’a rien d’original, le roman, lui, plonge son lecteur comme aucun ne l’avait fait dans l’univers nazi comme milieu ambiant et vision du monde. En ceci le roman de Littell n’est pas seulement une œuvre littéraire : au-delà du trouble moral qu’il suscite, sa fiction réalise une performance saisissante, éprouvante, mais réelle. Ce que donne à voir ce livre avec un indéniable succès, malgré ses naïvetés littéraires, c’est le nazisme comme culture : la possibilité d’intérioriser, sans haine viscérale, un monde capable de faire de l’extermination un programme, un acte, un spectacle – et pour Aue un récit.
Pour cela il fallait un artifice littéraire : Max Aue, SS atypique, esthète, en retrait de son acte, a permis à Littell d’inventer un regard de dedans et dehors sur l’univers nazi : c’est un « rayon laser »20. Le problème éthique n’est pas d’avoir fabriqué un héros invraisemblable, mais de faire des victimes un spectacle pour le lecteur – et d’ajouter au récit de l’extermination une simili-tragédie familiale en forme d’Orestie et de bacchanale. Il faut voir là le sacrifice de Littell à la « littérature » et à ses idoles, Blanchot et Bataille ; un rituel à contretemps, par quoi le roman devait assurer son entrée dans « l’espace littéraire », et trouver un public.
Littérature et histoire : l’héritage dans l’époque
Le parti-pris d’épouser le point de vue du bourreau sur la catastrophe, Littell ne l’a pas inventé. Ce geste avait été accompli déjà par l’historiographie du nazisme : qu’avait fait Raul Hilberg, dans La Destruction des Juifs d’Europe, sinon écarter les témoignages des victimes pour se concentrer sur les archives nazies ? Sa démarche était certes transgressive, au point qu’il l’a décrite plus tard, racontant sa carrière malheureuse dans Politique de la mémoire, comme une rupture avec une tradition judaïque : celle de l’effacement du nom et du visage d’« Amaleq »21. Ce schisme mémoriel a suscité des critiques parmi les historiens, après qu’il a montré son efficacité et ses limites ; mais lorsqu’une œuvre littéraire l’accomplit à son tour, il ne suscite plus des « critiques » : il déclenche une guerre entre enthousiastes délirants et ennemis jurés.
Ce schisme avait déjà eu lieu dans la littérature, avant même que Hilberg n’en fasse une méthode. Les réactions contrastées aux Bienveillantes répètent en partie, en 2006, celles qu’avait suscitées le roman de Robert Merle, La Mort est mon métier, paru en 1952, et réédité vingt ans après22 : l’auteur racontait la mise en place de la machine exterminatrice à travers le récit de « Rudolf Lang », c’est-à-dire Rudolf Höss, le commandant d’Auschwitz. Mais là où Merle ouvrait une brèche pour expérimenter quelque chose, Littell lance un pavé dans la mare. Son ambition est plus radicale : il choisit, lui, de raconter l’histoire totale de la Shoah, et de le faire à travers un SS intégralement fictif. Tous deux ont fait œuvre d’héritier au sein d’un même schisme, chacun selon son époque. Tous deux ont donné la parole à un « bourreau » et dédié leur roman aux morts. Littell, en 2006, voulait rompre avec une culture mémorielle dominée par le témoignage des victimes ; Merle, en 1952, disait avoir écrit cette fiction contre l’oubli trop rapide de leurs témoignages. Vingt ans après sa parution, il écrivait : « Quand je rédigeai La Mort est mon Métier, de 50 à 52, j’étais parfaitement conscient de ce que je faisais : j’écrivais un livre à contre-courant. Mieux même : mon livre n’était pas encore écrit qu’il était déjà démodé »23. Ce livre pourtant n’a pas manqué de lecteurs, ajoute-t-il, mais pour ceux qui le lisent aujourd’hui – on est en 1972 – « “c’est un livre d’histoire”, et dans une certaine mesure je leur donne raison »24.
On est tenté de dire le contraire des Bienveillantes : ce livre-là n’était pas encore écrit qu’il était déjà à la mode, et son auteur n’a cessé de dire qu’il fallait le prendre pour ce qu’il était : de la littérature, et non de l’histoire. Mais son « livre de littérature » vient clairement après un travail historiographique qui, concernant la Shoah, est son principal héritage. Merle dit faire en littérature un travail d’historien. Littell, lui, choisit d’hériter en littérature du travail accompli par les historiens : nourri de cette somme gigantesque, auquel il doit le format de son livre, il invente une mémoire nazie de l’extermination, et fait parler un SS du fond de cette part maudite. Refaire l’histoire de l’œil à partir du matériau livré par Hilberg, Arendt et Browning, telle est la forme que prend chez lui le syndrome postmoderne.
Le projet de Merle et celui de Littell, à un demi-siècle de distance, montrent que ce schisme mémoriel a produit sa propre histoire culturelle, où les avancées de l’historiographie jouent un rôle décisif : entre l’un et l’autre roman un énorme édifice de savoir s’est construit, auquel s’adosse le roman de Littell, alors que celui de Merle veut s’y substituer par défaut. Dans sa deuxième partie, qui raconte la construction de Birkenau, Merle dit avoir « fait véritablement œuvre d’historien », en retraçant « d’après les documents du procès de Nuremberg, la lente et tâtonnante mise au point de l’Usine de Mort d’Auschwitz ». Le propos de Littell ne pouvait pas être, en 2006, de « faire œuvre d’historien ». Mais tous deux partagent l’hérésie qui consiste à faire des acteurs du crime également ses témoins, et à leur prêter une « pensée ».
Cette hérésie, Hilberg la professait en historien, et il l’avait explorée dans son livre consacré aux « gens », après avoir étudié la « structure » : Exécuteurs, témoins, victimes. Or, au chapitre des « exécuteurs », son écriture devenait fortement « littéraire » : pour dire ce qu’était « penser » parmi le personnel nazi, du haut en bas de l’échelle, l’historien narrait des anecdotes et dressait des portraits ironiques par scénettes successives, enjouées et sinistres. Le lecteur, édifié sur l’usage mortel des gestes et mots « ordinaires » en situation « extraordinaire » – c’était l’objectif visé par Hilberg – cherche où est passée la «pensée» de ces «gens», qui semble se dissoudre naturellement dans le paradoxe de l’atrocité tranquille.
La puissance équivoque du mythe, confirmée ici par l’approche de l’historien, repose peut-être sur cette idée de « pensée », qui pourrait bien être un malentendu de plus à résoudre25. Le travail accompli par les historiens est de nature, pourtant, à prendre des distances avec le «bourreau» en faisant apparaître son substrat réel. Ce mot recouvre une multitude de réalités, qui vont du chef d’Etat au petit exécuteur en passant par le criminel de bureau. Et ces catégories elles-même sont trop grossières par rapport aux comportements, fonctions et situations que détaille aujourd’hui la « Täterforschung »(recherche sur les criminels).
Depuis le départ, au gré des découvertes ou explorations d’archives, chaque historien de la Shoah, héritant d’un prédécesseur, complète un premier ouvrage, reprend le sujet à partir d’une nouvelle perspective26. Mais cette recherche déborde largement à présent le cercle des historiens de la Shoah, pour concerner l’ensemble des sciences humaines et couvrir le phénomène de la violence extrême à travers l’histoire. En janvier 2009 s’est tenu à Berlin un Congrès organisé par le Centre de recherche sur l’Holocauste, « Perpetrator Research in a Global Context »27. Rassemblant des spécialistes de différents événements, ce colloque était placé sous le signe d’une phrase de Germaine Tillon, sur « la tragique facilité » avec laquelle des hommes ordinaires peuvent devenir des assassins en série. L’argument, inspiré des travaux du sociologue Harald Welzer28, évoquait un tournant dans la recherche sur les exécuteurs : il faut désormais renoncer à modéliser des types homogènes, tant les exécuteurs se différencient selon leurs milieux sociaux, leurs horizons intellectuels, leurs trajets de carrière, leurs motivations. Après la distinction entre concepteurs, organisateurs et exécuteurs, ce dernier groupe se fractionne et se différencie à l’extrême.
Mais tout ce travail de précision, s’il élargit la connaissance, aboutit à des généralités ou des apories. Si la mise en évidence d’un système culturel productif (et pas seulement destructif) diminue bien le caractère « exotique » de la violence extrême – tel est l’objectif critique de Welzer – le passage à l’acte reste une énigme. Par son caractère déceptif, le travail des chercheurs contribue à l’élaboration du mythe dont je parlais plus haut. C’est sur ce fond devenu mythique que le roman de Littell prend son sens. En adoptant le point du vue du SS et en faisant de lui un esthète bavard, l’écrivain parachève ce travail du mythe. Mais en faisant de la « transparence intérieure » un jeu de reflets angoissant, il construit son propre monde mythique.
« L’horizon de notre vie quotidienne, disait Kertész en 1990 dans un texte sur “La pérennité des camps”, est déterminé par ces histoires qui sont, en définitive, des histoires sur le bien et le mal, et notre monde défini par cet horizon est rempli de murmures incessants concernant le bien et le mal »29. Cet horizon s’est constitué ailleurs que dans les fictions littéraires et écrits d’historiens : il s’est formé au tribunal de Nuremberg. Les chroniques du procès sont déjà des récits mythiques, fascinés par le théâtre des criminels, leurs paroles – l’interminable harangue de Göring en particulier – leurs silences, leurs gestes30. C’est un récit parmi d’autres qu’a raconté Hannah Arendt avec sa « banalité du mal ». C’est à ce théâtre qu’était adossé le roman de Merle. Celui-ci s’était inspiré surtout des entretiens que Gilbert avait menés avec Höss et qu’il avait publiés dans son Journal de Nuremberg31, bien davantage que des Mémoires de celui-ci, qu’il jugeait surfaites. Pourtant, le propos de Merle frappe par son extrême parenté avec celui des experts en psychologie sociale de la Täterforschung.
Le livre de Merle ne se lit pas aujourd’hui comme en 1952 – dans la mesure où on le lit : le plus souvent on le balaie d’un geste en citant Jean Cayrol. Là encore, ce que fait l’auteur devrait être rapporté à son objectif, en prenant acte du travail réellement accompli, et en recueillant le sens de l’échec, si échec il y a. La deuxième partie du roman, où Merle dit avoir fait œuvre d’historien, perd son lecteur dans les calculs relatifs à l’architecture du camp et l’arithmétique du crime : à la fin, le Commandant d’Auschwitz ne fait plus que compter le nombre de Juifs qu’il faut tuer quotidiennement pour pouvoir réaliser la « Solution finale ». Le roman, intéressant tant qu’il nous racontait la « formation » de Lang/Höss, devient alors suffoquant, illisible. Mais est-ce le travail de l’historien qui rend le roman illisible, ou le maintien de l’empathie fictionnelle, intenable et absurde dès lors que le héros, devenu impropre à l’empathie, a cessé d’être un homme ? Les statistiques du crime ont-elles jamais été « lisibles » ?
L’illisibilité est un problème familier aux historiens de la Shoah, même s’il n’a été formulé comme tel que tard, au cours d’une « querelle » bien connue, qui a stimulé non seulement la recherche, mais la réflexion sur les modes d’écriture de l’histoire32. Les historiens, cherchant à transmettre leur propre héritage, c’est-à-dire leur effort de compréhension, ont dû aussi apprendre non seulement à lire toutes sortes d’archives, mais à écrire. Cet apprentissage se fait sentir tout au long des avancées de la connaissance historique. L’effort d’intelligibilité a conduit à plusieurs opérations successives, au cours desquelles la question de la forme du récit historique s’est modulée et précisée.
Une fois pénétrée la structure de l’édifice et déchiffré le « processus de destruction» – par une composition architecturale que Hilberg disait « musicale » –, il fallait situer le processus de décision de la « solution finale »,
déchiffrer les modalités de son exécution, comprendre ce qui l’avait rendu possible, et donc se concentrer sur les acteurs du crime et sur une population consentante ou complice. Il fallait donc revenir, en, amont, sur les « racines intellectuelles du IIIe Reich », pour reprendre la formule de George Mosse – à qui Christopher Browning a dédié son deuxième livre sur les « bourreaux allemands ». Écrire l’histoire de la Shoah supposait de déplier la genèse du projet, et de décrypter une histoire culturelle au long cours : étudier les discours de Himmler et les journaux de Goebbels, mais aussi les traités et divagations de Rosenberg, Chamberlain, Wagner, afin de comprendre comment une certaine culture de la violence, devenue agent de destruction, avait d’abord été un milieu nutritif : une « vision du monde » si bien intériorisée qu’elle avait rendu possible et même exigé un crime d’envergure métaphysique, à l’image de son idée- force : ce que Saul Friedländer, dans L’Allemagne et les Juifs, appelle « l’antisémitisme rédempteur ».
Mais Friedländer a fait encore autre chose que cela. Après cette remontée en amont, il a réécrit l’histoire du génocide en y intégrant celle de la Catastrophe juive, et utilisé méthodiquement, à côté des archives nazies, les écrits des acteurs, des victimes et des tiers, créant pour cette histoire « intégrée » un principe de composition nouveau, polyphonique et discontinu, un art d’articuler le détail et le tout extraordinairement efficace, destiné à tenir ensemble le travail d’élucidation de l’intelligence et sa sidération. Telle est l’opération de totalisation et de compréhension accomplie par Saul Friedländer dans le troisième volume de L’Allemagne et les Juifs : Les Années d’extermination33. Friedländer a fait œuvre d’héritier critique à l’égard de Hilberg : il lui reprochait d’avoir éliminé comme non « fiables » les témoignages des victimes dans La Destruction des Juifs d’Europe, mais il a poussé jusqu’au bout l’intuition qui avait inspiré à Hilberg son étude tripartite des « gens » impliqués dans la Catastrophe : Exécuteurs, témoins, victimes34.
Si Littell a hérité de quelqu’un, c’est avant tout de Raul Hilberg – comme l’a montré l’hommage qu’il a rendu à l’historien lors de sa disparition35. S’il a choisi d’éliminer la voix des victimes, c’était bien sûr pour des raisons littéraires : il jugeait inconcevable le surplomb du narrateur omniscient – sur le modèle de Vie et destin de Grossman. Mais c’est avant tout parce que l’énigme était pour lui la « pensée » du criminel et la culture du meurtre. Ce choix lui a fait « totaliser l’événement » à travers une seule voix, en travaillant un « ton »36. Les victimes ne parlent pas dans les Bienveillantes : elles sont vues, et parfois regardées, avant ou après leur mise à mort. Pour une fois, la totalisation polyphonique aura été le fait de l’historien, non du romancier.
La chaîne des héritiers, on le sait bien, est aussi celle des relations qui se nouent entre la littérature et l’histoire, au prix de disputes qui remplissent les chroniques. Ces disputes, grandes et petites – entre Saul Friedländer et Raul Hilberg, entre Claude Lanzmann et Yannick Haenel - font intégralement partie de l’héritage. Y a-t-il jamais eu un héritage sans dispute ? L’héritage, n’est-ce pas ce qu’on se dispute une fois que les gens sont morts ? Tout héritier est un imposteur et un traître : en se battant avec ses frères, il trahit toujours le défunt.
Primo Levi savait bien qu’il ne pourrait saisir « l’essence du IIIe Reich » à travers le regard du Docteur Pannwitz. C’était une idée, dont il n’a pas fait un roman. Écrivant le sien, Littell a compris qu’il n’éluciderait pas l’énigme SS à travers le regard de Aue. Parti à la recherche de la « banalité du mal », en homme de sa génération, il s’est mis à écrire l’histoire d’un sacrifice monstrueux commis par un parricide incestueux, châtié par les dieux sous la forme d’une vie sans désir, ni recours, ni amour. On peut lui reprocher cette bifurcation, ou cette erreur d’aiguillage finalement calculée, ce désir de raconter coûte que coûte une « histoire ». Il est possible que la littérature ne puisse rien comprendre, elle non plus, à la vraie histoire, et que le créateur, là où la vie culturelle engendre la mort de masse, ne puisse plus que dérailler, inventer. L’héritage, n’est-ce pas ce que les morts, en disparaissant, nous obligent à inventer ?