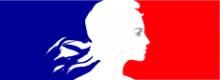Cette étude est tirée de la conférence donnée à Madrid dans le cadre du colloque Myth and Audiovisual Creation (Section Classical Myths), dir. Jose Maria Zamora, tenu les 17-19 octobre 2018 à l'Universidad Autónoma.
Les oiseaux mythiques sont assez rares : ceux du lac Stymphale dans les travaux herculéens sont bien connus ; moins connus sont l'orion et le catreus de la geste d'Alexandre le Grand chez Clitarque, le rhyntacès perse mentionné par Plutarque, l'héliodrome coursier du soleil dans le traité magique des Cyranides, le nycticorax et le caladrius (ou charadrius) du bestiaire chrétien dit Physiologus2. Le plus célèbre et paradoxalement le moins rare d'entre eux est le phénix : unique de son espèce, il meurt et renaît périodiquement, volant vers le temple d'Héliopolis, la « ville du soleil ». Il est l'avatar du bénou égyptien, héron sacré coiffé du disque solaire ou d'une couronne divine, hypostase du démiurge Atoum-Ra, puis d'Osiris, le dieu mort et ressuscité, qu'il accompagne sur sa barque (figure 1 et figure 2). Figure du soleil comme aussi le faucon Horus, il pouvait être encore une forme de l'étoile du Berger, la dernière à briller le matin et la première à briller le soir. Hérodote en donne la description originelle, qui ne correspond guère au modèle égyptien et qui sera enjolivée par les auteurs postérieurs : il montre un rapace rouge et or ; oiseau rare venu de l'Arabie, il n'apparaît que tous les 500 ans, au plus tôt, visible aux seuls yeux des prêtres du temple du Soleil3. Il ne fait rien d'autre que mourir et renaître, et son retour sera considéré comme de bon augure. De tout temps, les poètes, les romanciers, les historiens, les auteurs religieux et même scientifiques et, depuis le début du vingtième siècle, les cinéastes brodent de nouvelles images, réalistiques ou symboliques, sur cette simple trame, souvent par l'exploitation de jeux de mots et par l'emprunt à d'autres légendes et imageries. Peu fréquent dans la littérature de la Grèce et absent de son art, le phénix s'était multiplié à Rome dans les textes et l'iconographie, adopté et adapté comme emblème officiel impérial et comme icône chrétienne, avec des interprétations différentes, voire antagonistes, mais toujours signe positif, soit du renouvellement heureux des temps, soit de la résurrection des corps4 (figures 3 et 4). Son succès populaire ne se démentira jamais et, passant de siècle en siècle, son mythe se renouvellera et s'enrichira sans cesse5.
À notre époque contemporaine, l'oiseau qui renaît de ses cendres est devenu familier à tous, jeunes et plus âgés, en particulier grâce à Fumeseck dans la saga Harry Potter de J. K. Rowling, adaptée en films (figure 5). Il se voit partout dans la vie quotidienne, comme nom de marque (les assurances Phoenix ou les maisons Phénix par exemple, figures 6 et 7), autant que dans les domaines artistiques, de l'opéra de Venise La Fenice6 (figure 8) au manga-fleuve d'Osamu Tezuka Phoenix7 (figure 9). Il est donc devenu aussi un personnage du septième art dès ses débuts. Il y revêt diverses formes, animale ou mécanique, humaine ou symbolique. La plupart des films qui en traitent sont des adaptations de livres ou de bandes dessinées, nombreuses sur ce thème, mais plusieurs sont des oeuvres originales. L'image et le mouvement, le son et la couleur de l'écran, petit ou grand, rendent l'oiseau plus spectaculaire encore, avec le recours aux effets spéciaux pour montrer les flammes de sa mort et renaissance, climax de son mythe. Quand il n'est pas un « vrai » oiseau, le phénix donne son nom à un objet par métaphore : il est alors un oiseau mécanique, une machine volante, le plus souvent un avion, échappant à la destruction ou bien la provoquant. Il peut aussi s'incarner dans un personnage humain, en particulier une femme qui brûle d'une façon ou d'une autre, qu'elle appartienne au genre humain ou qu'elle soit dotée de pouvoirs surnaturels, parfois maléfiques8.
L'OISEAU PHÉNIX AU CINÉMA
LE PHÉNIX ET LE TAPIS (MAGIQUE)
Le premier des romans avec un oiseau phénix adapté pour le grand écran est dû à la Britannique Edith Nesbit, auteur de livres pour les enfants, en 19049. Dans The Phoenix and the Carpet, deuxième volet de sa trilogie Psammead, elle mélange avec le mythe du phénix le conte slave de l'oiseau de feu, qui a lui-même emprunté le tapis volant des contes arabes Les mille et une nuits (figure 10). Dans le Londres du début du XXe siècle, quatre enfants trouvent dans un tapis persan un oeuf dont éclôt une créature qui est douée de la parole et a tendance à provoquer des incendies là où elle passe, comme cela se produit dans un théâtre inspiré de l'opéra vénitien. Les jeunes héros accompagnent sur ce tapis magique l'oiseau dans ses aventures à travers le monde. Le livre a donné lieu à trois séries télévisées de la BBC en 1965, 1976 et 199710, et à un long-métrage de Zoran Perisic The Phoenix and the Magic Carpet en 1995, sur le mode réaliste, mais où l'allure du phénix hésite entre la peluche et l'oiseau empaillé11 (figure 11).
PHÉNIX — L'OISEAU DE FEU
Au Japon, Osamu Tezuka a produit pendant trente ans les nombreux épisodes d'un manga de trois mille pages en douze tomes, intitulé Hi no tori, « l'oiseau de feu », traduit dans les versions en langues étrangères par Phoenix12. La créature s'inspire à la fois du phénix occidental et du feng huang de la légende chinoise (hô-ô en japonais), un oiseau multicolore également solaire et impérial, symbole de vertus et d'harmonie, aussi ancien que le bénou égyptien, et traditionnellement associé au dragon13 (figure 12). Le phénix blanc de Tezuka tient du coq pour sa crête rouge et du paon pour sa queue ocellée (figure 13) ; il est le gardien de la force vitale de l'univers. Il vit dans un volcan — une montagne de feu — où le chassent ceux qui veulent boire son sang réputé rendre immortel, comme celui du Christ dans la coupe du Saint Graal. L'oiseau fait le lien entre tous les épisodes qui racontent l'histoire du pays, faisant alterner le passé historique et un futur imaginaire lointain où se réincarnent certains des personnages. Cette oeuvre a donné lieu à des séries de dessins animés de 1978 à 2014 et sera rééditée en français en 202114 (figure 14).
FÉLIX LE PHOENIX
En 2014, le court-métrage des jeunes réalisateurs français Thomas et Clémentine Basty Félix le phoenix est une création originale primée par les jurys. Il confond l'histoire du phénix avec celle du conte d'Andersen Le vilain petit canard, en quatre minutes d'animation sans paroles, au graphisme moderne et enfantin15. Seule la couleur orange distingue le passereau Félix de ses congénères jaunes, ainsi que sa résistance au feu de cheminée où rôtissent les autres (figure 15). Comme chez l'auteur danois, c'est une fable allégorique sur la différence et le harcèlement qu'elle entraîne ; sa morale implicite montre que la différence peut être un avantage, et même une source de supériorité. À la fin, l'oiseau devenu roi a des allures de d'empereur romain, couronné de laurier sur son trône et éventé par des palmes comme un pharaon, avec de plus une utilisation graphique de deux jeux de mots anciens constitutifs de l'invention du mythe. L'un porte sur le double sens du mot phoinix en grec (désignant l'oiseau merveilleux et le palmier-dattier16) qui associe donc l'animal avec l'arbre, et l'autre joue sur l'assonance du nom de l'oiseau porte-bonheur avec l'adjectif latin felix « heureux » ; les deux mots étaient déjà employés ensemble dans une inscription de Pompéi17 (figure 16), et le second devient ici le prénom de la créature18.
THE PHOENIX
Mais l'histoire du phénix ne finit pas toujours bien. Le court-métrage tiré de la nouvelle de l'Américaine Sylvia Townsend Warner The Phoenix (écrite en 1940), réalisé par la Canadienne Gayle Thomas en 1990, montre en onze minutes de coloriage animé le triste destin de l'oiseau19 (figure 17). Ramené du désert arabe par un Lord anglais, il est à la mort de celui-ci exhibé dans un spectacle de cirque et forcé à brûler devant le public par l'appât du gain du propriétaire ; cela provoque non seulement sa propre mort, temporaire, mais aussi celle des spectateurs dans un gigantesque incendie dont ils ne ressusciteront pas. Comme pour l'oeuvre des Basty, une morale est à tirer de cet apologue.
FUMESECK DANS HARRY POTTER
Le plus célèbre des phénix du cinéma est Fumeseck dans la série Harry Potter (1997-2007). Les films (2001-2011) sont fidèles aux romans de la Britannique Joanne K. Rowling, avec la magie supplémentaire de l'image et de la couleur, du mouvement et de la bande-son. Parmi toutes les créatures fantastiques qui peuplent l'oeuvre, inspirées, entre autres sources, de la mythologie grecque (le chien Cerbère, le cheval ailé Pégase, les sirènes, les centaures, etc)20, l'oiseau est l'animal familier du Professeur Dumbledore dans le bureau duquel il vit, meurt et renaît, mais il est aussi le seul être capable de vaincre le terrible basilic. Cette ardeur combative, visible dans La chambre des secrets, le volume deux, est une invention moderne (même si Hérodote en faisait pour son physique un oiseau de proie), tout comme le pouvoir de guérison de ses larmes contre la morsure du basilic (figure 18) : le phénix grécoromain était herbivore et pacifique21. Le chant de l'oiseau entendu dans La coupe de feu, le quatrième tome, est la reprise d'un thème déjà développé par les auteurs anciens, sans appartenir au fonds originel de la légende. Le cinquième volet, L'Ordre du Phénix, où l'oiseau prend en plus un sens symbolique, tire son titre à la fois d'un ordre de chevalerie allemande du XVIIIe siècle et d'un ordre honorifique grec du XXe siècle (figures 19 et 20) ; c'est dans la saga le nom de la confrérie secrète des sorciers luttant contre le Prince des ténèbres, qui est réapparu dans le monde22. Harry et Voldemort possèdent tous deux une baguette magique faite d'une plume de phénix, dont l'ambivalence peut pencher vers le bien ou vers le mal (figure 21). L'oiseau a aussi le rôle de convoyer les messages des membres de l'ordre, comme ferait un pigeon voyageur. Pour ce qui est de la représentation du phénix à l'écran, les films, produits par différents réalisateurs, sont très fidèles aux romans, eux-mêmes assez fidèles à la légende : ainsi l'oiseau est-il un rapace brun-rouge avec une sorte de crête, comme indiqué par la plupart des auteurs anciens23.
LA MACHINE VOLANTE « PHÉNIX »
La deuxième catégorie de phénix cinématographique est celle d'un oiseau mécanique, une machine volante, avion ou engin interplanétaire. Il s'agit d'appareils de transport ou de guerre, à cause de la puissance de feu, si l'on peut dire, de la créature mythique, qui donne aussi son nom à de réels escadrons d'aviation militaire, missiles ballistiques et vaisseaux de l'espace dans divers pays contemporains, par exemple l'Escuadrón Fénix argentin24 (figure 22), le missile air-air américain AIM-5425, une sonde spatiale de la NASA posée sur le sol de la planète Mars en 200826, ou encore le prototype du projet de navette spatiale européenne non habitée27 (figure 23). Le dernier avion Phénix, en date de 2018, est l'A330 MRTT (pour Multi-Rôle Transport Tanker), nouveau ravitailleur de l'armée de l'air française28. Cette catégorie comporte à ce jour un seul film dont ce type de phénix est le héros principal, mais il a récemment suscité un remake. Beaucoup de films de science-fiction montrent aussi un phénix mécanique.
LE VOL DU PHÉNIX
Le roman d'aventures de 1964 Le Vol du Phoenix d'Elleston Trevor en (pseudonyme de Trevor Dudley-Smith) a inspiré un long-métrage à Robert Aldrich dès 1965, puis son remake à John Moore en 2004 ; les deux ont d'ailleurs été des échecs critiques et commerciaux. Un avion s'écrase dans le désert du Sahara et un des passagers se propose de le reconstruire, alors qu'il n'est en réalité que spécialiste de modèles réduits. La nouvelle machine est baptisée « Phénix » car elle renaît littéralement de ses cendres. L'histoire réunit tous les ingrédients d'un film catastrophe spectaculaire, mais elle comporte un happy end29(figures 24 et 25).
VAISSEAUX SPATIAUX PHÉNIX
D'autres oiseaux artificiels sillonnent l'espace intersidéral de la science-fiction au cinéma sans en être les vedettes principales. Des vaisseaux spatiaux s'appellent « Phénix » dans de nombreux films ou séries, comme Star Trek depuis 1979 (fig. 26), Stargate en 1994 (figure 27) et Star War depuis 1977. Dans Star Trek, l'engin voyage plus vite que la lumière ; dans Star War, il est au service de la bonne cause, celle des rebelles à l'empire30 : l'oiseau est leur symbole sous le nom de « Alliance Starbird » et il constitue le logo de leurs uniformes31 (figure 28).
LE PERSONNAGE « PHÉNIX » OU LA FEMME QUI BRÛLE
Mais le plus souvent, l'oiseau mythique s'incarne dans un être humain ; il est généralement féminin32, et cette femme peut être rebelle, victime ou bourreau, phénix ou dragon, puisque les deux créatures légendaires partagent l'attribut des flammes. Du spectacle de divertissement aux tragédies de l'histoire en passant par la fantasy, les personnages « Phénix » passent tous l'épreuve du feu, d'une façon ou d'une autre.
LE PHÉNIX DE MÉLIÈS
Un des premiers courts-métrages de l'inventeur même du cinéma, le Français Georges Méliès, s'appelle Le phénix, ou le coffret de cristal, diffusé en 1905 ; il dure 1 minute 15. Il s'agit d'un tour de magie, puisque Méliès avait d'abord voulu être prestidigitateur. Une femme est enfermée dans une boîte qui s'enflamme, mais dont elle sort vivante33. Un vidéaste d'animation a recréé la scène en ligne, dans le style de l'époque, à l'occasion d'un concours d'amateurs sur le thème du phénix en 201534.
LA SÉRIE TV DARK SHADOWS
Par une rare exception, Laura Murdoch Collins est un sombre phénix, c'est-à-dire une créature maléfique, dans le feuilleton américain gothique des années 1970 Dark Shadows, qui met en scène, en plus de mille épisodes, toutes sortes de personnages fantastiques, sorciers, loups-garous, zombies, etc35. À partir de l'épisode 123, Laura apparaît soixante fois, dans les épisodes 123-191 et 730-760, de 1966 à 1968. Elle se réincarne huit fois, tous les cent ans, grâce au sacrifice dans le feu d'un être humain, dont son propre fils David36, en l'honneur du dieu égyptien Ra dont le phénix est une figure37 – bien que la pratique évoque davantage le culte du Baal punique avec ses sacrifices d'enfants jetés dans les flammes (figure 29). Elle habite évidemment Phoenix, dans l'état d'Arizona aux USA, une ville qui tire historiquement son nom de sa fondation sur les ruines d'une précédente culture38. C'est une cousine du vampire Barnabas Collins, récemment incarné à l'écran par Johnny Depp, en 2012 dans le film Dark Shadows de Tim Burton. Par la suite, la série américaine Charmed, au début des années 2000, montre trois soeurs qui sont de bonnes sorcières, confrontées à un démon nommé Phoenix39.
LA SAGA THE HUNGER GAMES, CATCHING FIRE et MOCKINGJAY
Mais la plus fameuse femme phénix du cinéma appartient à la trilogie Hunger Games, tirée de la série pour jeunes adultes de Suzanne Collins (2012-2015). Les films sont fidèles aux romans. Bien que le nom de l'oiseau ne soit jamais écrit, ni prononcé, sa légende est omniprésente, à plusieurs niveaux de lecture. C'est à la fois un animal, un personnage et un symbole. Comme animal, sous le nom de mockingjay, c'est un hybride mi-naturel mi-artificiel, croisement accidentel d'un robot et d'un oiseau moqueur. Comme personnage, c'est le référent mythique de la flamboyante héroïne Katniss, jouée par Jennifer Lawrence, qui apparaît souvent dans des costumes enflammés (elle est « la fille de feu »), et qui survit aux épreuves les plus terribles (figure 30). Comme symbole, l'oiseau ornant la broche de Katniss devient l'emblème des rebelles (figure 31), et les quatre notes de son chant le signe de leur ralliement ; le mockingjay s'oppose alors à l'aigle, symbole impérial du régime de Panem (aigle et phénix étaient tous deux des emblèmes officiels dans la Rome antique) et de ses cruels jeux de gladiateurs. Tout comme dans le cycle Harry Potter, Katniss et ses camarades forment un « Ordre du Phénix » implicite menant la résistance contre le pouvoir en place. Le mythe apparaît plus explicitement dans le personnage de Finnick Odair, un des rebelles, au nom programmatique : Finnick le phénix40 meurt, mais laisse derrière lui une épouse enceinte, Annie aux cheveux roux couleur de feu, qui mettra au monde son fils, un autre lui-même, comme dans le mythe — à ceci près que le mythe ne connaît qu'un couple père-fils (figure 32). Annie porte d'ailleurs le nom significatif de Cresta, « la crête » en latin, qui l'apparente aussi à l'oiseau légendaire souvent montré tel un coq41.
PHOENIX
La femme « Phénix » peut également être une victime, telle cette survivante du génocide juif dans le film allemand de Christian Petzold paru en 2014, avec Nina Hoss42. C'est la troisième adaptation du roman policier Le Retour des cendres du Français Hubert Monteilhet (publié en 1961), après celles de 1965 et de 1982, sous d'autres titres43. L'héroïne n'a été ni gazée, ni brûlée, mais blessée par balle et dotée par la chirurgie esthétique d'un nouveau visage que ne reconnaît pas son ancien époux — celui qui l'a trahie et livrée aux bourreaux. Une des affiches du film la montre vêtue de rouge dans une épaisse fumée grise (figure 33). Dans une seconde lecture mythologique, c'est aussi une Eurydice revenant des Enfers pour rechercher son Orphée, retrouvé dans un nightclub portant le nom de l'oiseau, ce qui fournit la justification première du titre du film44 (figure 34).
DARK PHOENIX SAGA
Personnage de science-fiction des Marvel Comics dans les années 1950, Jean Grey, au nom évoquant la couleur de la cendre et à la chevelure d'un roux flamboyant, est une mutante des X-Men, qui meurt pour ressusciter possédée par une force cosmique aussi destructrice qu'une bombe atomique45. Elle provoque involontairement un génocide dont le remords la pousse au suicide. Mais elle réapparaîtra plusieurs fois dans les séries suivantes, sous la forme de sa propre fille ou bien d'un clone, une autre elle-même, comme dans le mythe. Elle porte, selon les périodes et les identités de sa vie, un costume vert, rouge ou noir (figures 35, 36 et 37). Le film, réalisé par Simon Kinberg avec Jennifer Lawrence en vedette, est sorti en 201946.
CONCLUSION
Le phénix a continuellement ressuscité aux XXe et XXIe siècles. Devenu une vedette de l'écran, petit ou grand, sous une forme aviaire, mécanique, anthropomorphique et symbolique, il détient une force le plus souvent bénéfique, parfois maléfique. Présent dès les origines du septième art avec Georges Méliès, il se rencontre depuis plus de cent ans dans les différents formats du cinéma : montages vidéo, films d'animation, court-métrages, longs-métrages (qu'il s'agisse d'adaptations de livres ou de créations originales)47, tout comme il traverse depuis l'Antiquité les diverses catégories littéraires, de la poésie au conte, au roman et à l'histoire, et les autres médias artistiques, peinture ou sculpture. De même que le genre cinématographique, il connaît un grand développement à partir du milieu du XXe siècle, avec une fréquence plus importante depuis les années 2000, certainement grâce au changement de millénaire et aux sagas qui ont popularisé encore davantage l'oiseau de feu de l'Orient et l'Occident, depuis le manga de Tezuka jusqu'aux cycles Harry Potter et indirectement Hunger Games. Le mythe venu de l'Égypte et métamorphosé en Grèce et à Rome, parfois croisé avec la légende d'un autre oiseau, slave ou chinois, a ainsi acquis une envergure internationale ; le succès planétaire et populaire des films, touchant également un public qui n'a pas toujours lu les livres les ayant inspirés, ainsi que l'intense merchandising : modèles réduits, jouets et peluches, qui les accompagne ont largement contribué à la régénération du phénix comme nouvelle étoile du cinéma.
Signalons, avant de donner la liste chronologique des films au phénix, trois oeuvres récentes en plus de celles listées ci-dessous, bien que le mot « phénix » n'apparaisse pas dans leurs titres, mais où l'oiseau joue un certain rôle :
- le film d’animation de 2016 Iqbal l'enfant qui n'avait pas peur, dans lequel l'oiseau phénix, en tant que motif brodé sur un tapis (clin d'oeil à l'oeuvre fondatrice d'Edith Nesbit The Phoenix and the Carpet), joue un rôle important comme symbole de la renaissance à la liberté48 (figures 38 et 39),
- le film de Disney Maléfique 2 paru en 2019, inspiré du conte de Perrault La Belle au bois dormant, dont l’héroïne est la méchante (ou pas si méchante) fée-oiseau qui a prétendument lancé un sort à la princesse. La fin lui révèle pour ancêtre un phénix dont le squelette géant rappelle un dinosaure, fossilisé dans un matériau rouge comme l’ambre, et qui ressuscite en Maléfique quand les larmes de la princesse Aurore mouillent ses cendres, pour lui donner la victoire finale dans une gerbe de flammes (figure 40).
- le film Disney - Pixar En avant (Onward) de 2020, où "phénix" est le nom d'une pierre précieuse qui, associée à un bâton et une formule magiques, permet de ressusciter pour un jour le père des héros49.
LISTE, LÉGENDES ET SOURCES DES FIGURES
- Fig. 1. Le bénou dans la barque solaire, tombe thébaine d'Irounéfer (TT290)
- Fig. 2. Le bénou portant une couronne divine, tombe thébaine d'Inerkhaouy (TT359)
- Fig. 3. Monnaie au phénix de l'empereur Hadrien en l'honneur de son défunt père Trajan
- Fig. 4. Le phénix dans les flammes, mosaïque de la basilique d'Aquilée
- Fig. 5. Harry Potter : Fumeseck
- Fig. 6. Les Assurances londoniennes Phoenix
- Fig. 7. Un des logos de la société Maisons Phénix
- Fig. 8. L'opéra vénitien La Fenice
- Fig. 9. Le manga Phoenix d'Osamu Tezuka
- Fig. 10. Edith Nesbit, The Phoenix and the Carpet, le livre
- Fig. 11. Edith Nesbit, The Phoenix and the Carpet, le film
- Fig. 12. Le couple chinois dragon et phénix
- Fig. 13. Le manga Phoenix d'Osamu Tezuka
- Fig. 14. Le manga Phénix d'Osamu Tezuka
- Fig. 15. Félix le phoenix
- Fig. 16. Fresque de Pompéi
- Fig. 16. Film de Gayle Thomas
- Fig. 17. Les larmes de Fumeseck
- Fig. 18. L'ordre du Phénix, Allemagne
- Fig. 19. L'ordre du Phénix, Grèce
- Fig. 20. Harry Potter, L'Ordre du phénix
- Fig. 21. Les animaux fantastiques, dessin d'Olivia Lomenech
- Fig. 22. L'Escuadron Fenix
- Fig. 23. La sonde européenne Phénix
- Fig. 24. Film Le vol du phénix, 1965
- Fig. 25. Film Le vol du phénix, 2004
- Fig. 26. Le vaisseau spatial Phoenix de Star Trek
- OU
- Fig. 27. Le vaisseau spatial Phoenix de Stargate
- Fig. 28. Le vaisseau spatial Phoenix de Star War
- Fig. 29. Dark Shadows : Laura Collins
- Fig. 30. Hunger Games, Katniss et le mockingjay
- Fig. 31. Hunger Games, la broche
- Fig. 32. Hunger Games : Annie Cresta
- Fig. 33. Film Phönix, affiche
- Fig. 34. Film Phönix, le club
- Fig. 35. Jean Grey en vert
- Fig. 36. Jean Grey en rouge
- Fig. 37. Jean Grey en noir
- Fig. 38. Film Iqbal
- Fig. 39. Film Iqbal
- Fig. 40. Film Maléfique 2