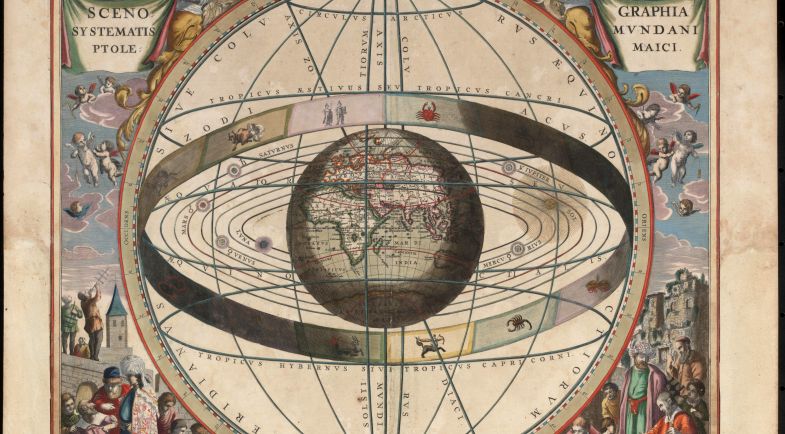- Diogène Laërce, Vie et doctrines des philosophes illustres, VIII, 8 ; voir aussi Jamblique, Vie de Pythagore 58, et Cicéron, Tusculanes V, 3 pour cette anecdote qui remonte à Héraclide du Pont.
- Cité par Télès, Diatribes, 2, 5.
- Diogène Laërce, Vies, VII, 160. Le vil Thersite et le roi des rois Agamemnon emblématisent des conditions et des caractères opposés.
Le theatrum mundi est une des grandes métaphores forgées au cours de l’Antiquité pour penser la vie et le monde humains, et jusqu’au monde dans sa totalité. Cette amplitude analogique dont la métaphore était virtuellement grosse lui a assuré une fortune philosophique et littéraire très durable. Le fait est qu’elle s’appuie sur un analogon aussi riche que complexe : le théâtre est un espace humain qui rassemble, sans qu’ils se mêlent, des acteurs et des spectateurs, mais aussi un chœur ; il est donc un espace clivé, différencié. Une fable, composée par un poète, est jouée au cours d’une représentation. Ces fables relèvent de genres, mime, comédie, tragédie, drame satyrique, aux tonalités très différentes. Des types de personnage, des types de situations et d’intrigues sont représentés, et la pièce fait voir la manière dont le protagoniste en particulier fait face à une situation, singulière et exemplaire à la fois, suscitant un plaisir mimétique, et, selon le genre dramatique, le rire, l’affliction ou l’exaltation du spectateur… Les situations et les personnages peuvent être inspirés par des épisodes et des individus contemporains, comme dans la comédie ancienne, ou sont tirés du fond des récits mythiques, ou encore empruntés à l’histoire récente, comme dans la tragédie. Une même histoire peut être reprise avec d’infimes ou grandes variations, l’acteur joue costumé et masqué, il endosse souvent plusieurs rôles, la qualité de son jeu peut rehausser un rôle ou l’affadir … En comparant le monde à un théâtre, on met donc en œuvre une analogie à forte portée, susceptible de produire par elle-même des effets de sens multiples.
Cela étant, l’élaboration du topos du theatrum mundi, que l’on doit à la tradition proprement philosophique, s’est faite progressivement, et il est à noter que l’image du monde comme théâtre a trouvé ses prémices dans une première comparant le monde à une panégyrie (fête collective où se déroulaient des concours), suivie d’une autre, aussi célèbre que complexe, figurant le monde comme une grotte, espace de défilement d’ombres portées. Une saisissante comparaison, enfin, entre l’homme et la marionnette a également contribué à l’avènement de la métaphore. Dès que, dans la tradition cynico-stoïcienne, le topos comme tel s’est élaboré, toutes les virtualités de sens dont il était porteur se sont alors trouvées progressivement explorées, à la fois par les auteurs relevant de ce courant, et par d’autres qui s’en sont inspirés (sophistes de la seconde sophistique ; le néoplatonicien Plotin). Les Pères de l’Eglise eux-mêmes, en même temps qu’ils condamnent la pratique théâtrale, le reprennent et l’adaptent à leur apologétique, de sorte que la modernité hérite du topos du theatrum mundi à partir de sources païennes mais aussi chrétiennes.
Tous les effets de sens qui ont été tirés du theatrum mundi tout au long de l’Antiquité ont ainsi préparé l’usage paradigmatique qui est fait du topos à l’époque moderne, spécialement dans le moment baroque, à la charnière du XVIème et du XVIIème siècle. A ce moment-là, le théâtre lui-même (ce qui ne se vérifie pas exactement dans l’Antiquité) se saisit du topos en se le réappropriant, pour le réfléchir sur scène, en un miroir source d’infinis vertiges. Si le monde est un théâtre, le théâtre peut se prendre pour le monde : le spectateur est mis au défi de tracer une frontière nette entre illusion et réalité. L’une s’épanche dans l’autre, la vie est peut-être un songe…
Dans ce qui suit, je proposerai un parcours typologique et historique très sélectif des usages de la métaphore et de ses prémices, en m’attachant à faire ressortir les problématiques philosophiques qui les sous-tendent.
La fable pythagoricienne : le monde comme une panégyrie
Plusieurs sources rapportent que Pythagore comparait la vie à une panégyrie :
« Et il disait que la vie ressemble à une panégyrie : de même que certains s’y rendent pour concourir, d’autres pour faire du commerce, alors que les meilleurs sont ceux qui viennent en spectateurs, de même dans la vie, les uns naissent esclaves et chassent gloire et richesses, les autres naissent philosophes et chassent la vérité. »1
Si le mot est authentique (ou a au moins été forgé dans l’école pythagoricienne, au cours du Vème siècle av. J.-C.), nous aurions là la plus ancienne ébauche de l’image du monde sinon comme théâtre, du moins comme lieu de spectacle (la panégyrie était un rassemblement religieux comportant des concours). Opérant une véritable tripartition de la société humaine, Pythagore dévalorise les deux catégories de ceux qui concourent et de ceux qui commercent, et promeut celle des spectateurs. Les premiers poursuivent des biens illusoires (gloire et richesses), tandis que la dernière catégorie seule se met en quête du vrai bien qu’est la vérité. Cette comparaison donne à entendre qu’il convient de s’affranchir de l’agitation du monde, en évitant de paraître sur la scène ou dans le stade, et en privilégiant la position du spectateur. L’image implique ainsi une théorie tripartite des modes de vie, que l’on retrouve chez Platon : « il existe trois genres d’hommes principaux : le philosophe, l’ami de la victoire et l’ami du profit » (République, IX, 580d-581c). L’axiologie sous-jacente permet alors de penser des degrés d’accomplissement de l’homme, à partir d’un espace politique et cultuel, pensé comme lieu de spectacle, où certains concourent, et en un sens large jouent, d’autres commercent, tandis que d’autres regardent seulement, à distance, étrangers aux passions qui animent les autres. Le spectateur, parce qu’il veut connaître, et ne se laisse pas gagner par les désirs de gloire ou de lucre, est valorisé et placé au-dessus des autres.
L’allégorie platonicienne du monde humain comme caverne et théâtre d’ombres
C’est une perspective inverse que porte Platon sur le spectateur avec la très fameuse allégorie imaginée dans la République (VII, 514a-517d), pour représenter la condition humaine ordinaire : la société des hommes est comparée à une société de spectateurs passifs (ce sont des prisonniers assis et enchaînés), placés dans un lieu clos (la grotte sombre qu’éclaire un feu brûlant derrière les prisonniers), qui donne l’illusion d’être le monde entier. Ces hommes inertes, fascinés par des ombres qu’ils voient s’agiter sur les parois de la caverne face à eux, se trompent du tout au tout sur ce qu’elles sont véritablement : ils s’imaginent que ce sont les êtres véritables, quand il s’agit de l’ombre projetée d’objets divers que portent sur leur tête des hommes cheminant derrière les prisonniers, sur un sentier, eux-mêmes dissimulés par un muret « du genre de ces cloisons qu'on trouve chez les montreurs de marionnettes, et qu'ils érigent pour les séparer des gens. Par-dessus ces cloisons, ils montrent leurs merveilles » (514b), comme le précise Platon. Ainsi, pour ces prisonniers, le monde n’est rien d’autre que ce théâtre d’ombres apparemment fortuit, qui les illusionne… Allégorie de la vie des hommes tournés vers le sensible, ce récit vise à faire prendre conscience que la vie sensible est un esclavage, auquel la philosophie peut permettre d’échapper, si l’on sort de la caverne et que l’on se tourne vers les réalités vraies. Mais le monde des hommes ordinaires, que le désir philosophique n’a pas aidé à dissiper ces illusions, est bien assimilé à un théâtre d’ombres : « de tels hommes considéreraient que le vrai n'est absolument rien d'autre que les ombres des objets fabriqués » (515c). Ce jeu d’apparences, nous nous y condamnons, tant que notre raison reste en sommeil ; mais il est, pour les naturels philosophes, un authentique objet de spectacle, constitué par les réalités intelligibles qu’éclaire le Bien...
L’homme-marionnette de Platon
Dans une autre comparaison fameuse, Platon présente les hommes comme des marionnettes forgées par les dieux (Lois, I, 644d-645c, et VII, 803c-804b). L’homme est cette fois appréhendé comme acteur d’un spectacle donné aux dieux. Dans le contexte des Lois, Platon veut donner à comprendre que l’homme est traversé de pulsions irrationnelles qu’il subit, et qui le font agir sans cohérence, mécaniquement : comme une marionnette, il est mû par plusieurs fils d’airain, qui commandent ses mouvements sans qu’il les dirige à proprement parler, mais il dispose d’un fil d’or, celui de l’intelligence, qu’il peut apprendre à mouvoir. L’éducation aboutie doit ainsi viser à coordonner l’ensemble des mouvements de ce corps-marionnette, ce qui ne peut s’obtenir qu’en travaillant à faire de ce fil d’or le fil maître, de sorte que les tractions des autres fils s’harmonisent avec la sienne. La problématique de la passivité et de l’autonomie rationnelle resurgit, centrée cette fois sur le comportement humain : à quelle condition l’homme serait-il un bon acteur, c’est-à-dire un acteur aux mouvements harmonieux et cohérents ? Cette comparaison saisissante connaîtra une fortune durable : la vision de l’homme-pantin (une vie sans cohérence), l’affirmation d’une transcendance divine dont les raisons sont impénétrables (les dieux se jouent de nous), l’espoir placé dans la raison qui doit dominer et coordonner l’irrationnel (la perspective d’une autonomie), le sentiment que l’histoire n’est pas écrite, mais n’a peut-être pas de sens…
Platon fait de l’harmonie du jeu de la marionnette l’idéal d’une vie d’homme accomplie. L’élaboration cynico-stoïcienne de la métaphore du théâtre du monde reprend l’idée de l’homme acteur d’un spectacle, mais il s’agit désormais d’une pièce jouée par des acteurs vivants. Voir l’homme comme un acteur permet de penser les conditions du bon jeu, et appréhender la vie comme un drame, de penser les différences de condition entre les hommes.
Le monde-théâtre, des cyniques aux stoïciens
L’élaboration développée de la métaphore du theatrum mundi a lieu dans l’école stoïcienne, mais elle s’est trouvée largement esquissée par le courant cynique. Ainsi, Bion de Borysthène (325-265), auteur de Diatribes, avait mis en œuvre la comparaison théâtrale pour penser la condition de l’homme et ses devoirs :
« De même que le bon acteur doit bien interpréter tout rôle que lui attribue le poète, de même l’homme de bien avec le rôle que lui attribue la Fortune. En effet, dit Bion, c’est elle qui, comme une poétesse, attribue à chacun tantôt un premier rôle, tantôt un second rôle, tantôt le rôle d’un roi, et tantôt celui d’un vagabond »2.
Le stoïcien cynicisant Ariston de Chios (1ère moitié du IIIème siècle av. J.-C.) avait usé de la même comparaison, insistant sur l’attitude d’indifférence, qui implique une réflexion sur le dédoublement de l’acteur entre son rôle et ce qu’il est véritablement :
« La fin est de vivre dans l’indifférence à l’égard de ce qui est intermédiaire entre la vertu et le vice, sans faire aucune distinction entre ces choses, mais en se comportant de façon égale envers toutes. En effet, le sage est semblable au bon acteur : qu’on lui attribue le rôle de Thersite ou d’Agamemnon, il joue chacun des deux de façon appropriée »3.
Il faut jouer son rôle le mieux possible, en accordant son jeu à son personnage, mais la nature du rôle est sans importance. La raison en est que l’homme se définit strictement par sa raison, laquelle est sa nature. Bien vivre pour un homme signifie vivre en suivant la nature, autrement dit en suivant la raison. C’est ce qui conduit à mettre en œuvre la vertu sous toutes ses formes, à accomplir son devoir ; toute déviation par rapport à cela est faiblesse, et même erreur. Ainsi, s’imaginer qu’il y ait d’autres biens que les vertus est le commencement de la déraison, qui se traduit par le développement en soi des passions. C’est pourquoi il est indifférent d’être Thersite ou Agamemnon, du point de vue du rang social. Mais cela ne signifie pas qu’il faille jouer Thersite ou Agamemnon tels qu’Homère nous les représente, avec leurs défauts et leurs vices. Sur la scène du monde, l’on doit être prêt à endosser n’importe quel rôle, et à le jouer, ou essayer de le jouer, vertueusement. Certes, tous les rôles ne sont pas interchangeables, et nous sommes, par nos caractéristiques, mieux disposés pour certains :
« Tu ne peux jouer à la fois le personnage de Thersite et celui d’Agamemnon. Si tu veux être Thersite, tu dois être bossu et chauve ; mais si c’est Agamemnon, tu dois être grand, beau et aimer tes sujets » (Entretiens d’Épictète, IV, 2, 10).
Nous ne décidons pas du rôle, mais un rôle adapté nous revient, qu’il nous appartiendra de bien jouer. En effet, contrairement à ce que Bion suggérait avec la figure de la Fortune, c’est, pour les stoïciens, un Destin invincible qui nous conduit, et qui fait de nous un puissant ou un misérable, compte tenu de ce que nous sommes. Ce Destin se confond avec la Providence, car ce qui est à l’œuvre en toutes choses, c’est la Raison divine, qui façonne, anime et règle toutes choses. Dès lors, seule la qualité du jeu dépend de nous : nous serons bons ou mauvais acteurs. Notre liberté se réduit à bien jouer, autrement dit à agir vertueusement en toute circonstance.
Dans notre vie, nous jouons donc un rôle, dont nous ne connaissons pas l’étendue exacte :
« Rappelle-toi que tu es l’acteur d’un drame qui est tel que le veut son auteur : ton rôle sera court s’il veut qu’il soit court, long s’il veut qu’il soit long. S’il veut que tu joues un mendiant, c’est afin que tu joues ce rôle avec talent. Et aussi s’il veut que tu joues un boiteux, un haut responsable, un simple particulier. Car ce qui te revient, c’est de bien jouer le personnage qu’il t’a confié. Quant à le choisir, c’est à un autre que cela revient » (Manuel d’Epictète, XVII).
La limite du parallélisme est ici atteinte : dans la pièce réelle qu’interprètent les acteurs, le rôle est fixé, les répliques définies, et l’acteur sait lorsqu’il doit sortir de scène. Dans la pièce qu’est notre vie, en revanche, nous nous employons à bien jouer un rôle dont nous ne connaissons pas la longueur. Mais cette différence entre le vrai théâtre et le théâtre du monde est précieuse d’un point de vue philosophique, car elle aide à comprendre que l’important est que nous jouions à chaque instant notre rôle du mieux que nous le pouvons :
« Il en va de la vie comme d’une pièce de théâtre : ce qui importe ce n’est pas qu’elle soit longue, mais qu’elle soit bien jouée. Où que tu finisses, cela n’a pas d’importance. Finis où tu voudras, seulement prépare un bon dénouement » (Sénèque, L. à Lucilius, 77, 20).
De fait, le jeu du bon acteur est un modèle pour penser la vie de sagesse, parce que tous les gestes de l’acteur sont déterminés par la recherche du meilleur jeu possible : « ce n’est pas à l’art de la navigation ou à celui de la médecine que selon nous la sagesse ressemble : c’est plutôt au jeu de l’acteur » (Cicéron, Des termes extrêmes des biens et des maux, III, 24). Mais la vie de sagesse est encore plus parfaite, car à tout instant, chaque action du sage se montre en tous points parfaite, quand, pour l’acteur, « les actes accomplis correctement ne contiennent pas, si corrects qu’ils soient, toutes les parties dont ils se composent » (Des termes extrêmes, III, 24-25).
Mais parce que notre vie consiste à incarner un personnage que nous mimons sans l’être, nous devons nous souvenir de ce qui se cache derrière le masque et les habits :
« Le temps viendra bientôt où les tragédiens croiront que leurs masques, leurs brodequins et leur robe, ce sont eux-mêmes. Homme, tout cela tu l’as comme matière, comme thème. Ouvre la bouche pour que nous sachions si tu es un tragédien ou un bouffon. Car tout le reste est commun aux deux. C’est pourquoi, si on enlève à l’acteur à la fois ses brodequins et son masque et si on le produit à la manière d’une ombre, l’acteur a-t-il disparu ou subsiste-t-il ? S’il a une voix, il subsiste » (Entretiens d’Épictète, I, 29, 39).
Finalement, nous nous dédoublons, entre notre personnage social et ce que nous sommes appelés à être essentiellement, un être de raison étranger aux passions, mimant le jeu social :
« En paroles, certes, n’hésite pas à compatir avec lui [l’homme en deuil qui pleure], voire, le cas échéant, à gémir avec lui ; prends garde toutefois à ne pas gémir aussi du dedans » (Manuel d’Epictète, XVI).
A partir de l’exploitation stoïcienne de la métaphore, deux voies opposées se présentent : renchérir sur le dédoublement entre l’être social et le moi véritable ; contester le dédoublement, illusoire, et réduire la vie de l’homme à son jeu, l’individu au personnage. La première voie est illustrée par Plotin, la seconde par Lucien de Samosate et la seconde sophistique.
Le monde-théâtre et le paradoxe de l’âme-actrice selon Plotin
Les stoïciens, en travaillant la métaphore, sont amenés à suggérer un dédoublement minimal entre ce que l’on joue et ce que l’on est : l’on ne peut que jouer un rôle, qui toutefois n’est qu’un rôle. L’on joue derrière un masque mais on ne peut s’en séparer ; le dieu a écrit la pièce et n’attend de nous qu’un bon jeu. La reprise par un platonicien tel que Plotin (205-270) de cette métaphore conduit à creuser le dédoublement : l’âme qui entre dans des corps successifs (selon le dogme de la transmigration) est amenée ce faisant à jouer des rôles différents, mais elle est en réalité étrangère à ces personnages. Le monde devient une scène limitée, que l’on resitue par rapport à un hors-scène, vers quoi l’âme philosophe tend : la scène du monde est la scène du monde sensible, que l’âme, réalité intelligible, investit parce qu’il faut que cette scène soit animée, et que des spectacles de toutes sortes s’y déroulent ; mais le vrai lieu de l’âme, sa patrie intelligible, est au dehors, et elle aspire, tout en jouant bien son rôle, à y revenir et s’y installer – dès que le dieu l’en aura jugée digne.
« Comme si cela se passait sur des scènes de théâtre : voilà comment il nous faut considérer le spectacle des meurtres, de toutes ces morts, ces prises de villes, ces pillages – tout cela, ce n’est que changements de scène, changements de costumes, lamentations et gémissements joués. Car ici-bas, dans chaque événement de notre vie, ce n’est pas l’âme intérieure, mais l’ombre extérieure de l’homme qui gémit, qui se plaint, et qui fait tout ce qu’elle fait sur cette scène qu’est la terre entière, où partout les hommes ont dressé des scènes. De telles actions en effet sont le fait d’un homme qui sait vivre seulement d’une vie inférieure et extérieure, et qui ignore que dans ses larmes, même sérieuses, il n’y a que jeu. Il appartient à l’homme sérieux seul de considérer avec sérieux ce qui est à faire sérieusement ; le reste de l’homme est un jouet […] Il faut se persuader de ceci : il ne faut pas supposer que les pleurs et les gémissements sont les indices de l’existence de maux, parce que les enfants aussi pleurent et se lamentent pour des choses qui ne sont pas des maux » (traité 47 (III, 2), 15, 43-62).
Ainsi, seul l’homme de bien a conscience de ne jouer qu’un rôle sur une scène de théâtre ; l’homme sans valeur ne le sait pas, et prend tout ce que ses sens, ses désirs et ses craintes lui font percevoir pour des réalités, de sorte que le poète de l’univers utilise en vérité deux sortes d’acteur : ceux qui savent qu’ils jouent un rôle, et qui le jouent bien mais avec la distanciation convenable – vertueux, ils ne peuvent jouer que des rôles de vertueux ; ceux qui ne savent pas, et qui sont entièrement pris par l’illusion ; ils ne peuvent jouer (correctement) que des rôles de vicieux :
« Si une partie de la Raison revient à l’homme de bien, et une autre partie au méchant (le méchant occupe la plus grande partie), c’est comme dans les drames, où le poète assigne aux acteurs leur rôle, et se sert de ceux qui sont déjà là ; car ce n’est pas lui qui fait de l’un le protagoniste, de l’autre le second rôle, et de l’autre le troisième, mais il donne à chacun les rôles qui leur conviennent, et indique aussi à chacun le lieu où il doit être placé » (traité 47 (III, 2), 17, 16-22).
Le monde, par l’application de la métaphore, se trouve comme déréalisé ; nos vies sensibles se fictionnalisent en quelque sorte. Quant au vertueux, il joue lui-même un rôle de vertueux, mais ce faisant il se détourne des péripéties de la pièce, et regarde ailleurs - car notre vrai moi est ailleurs.
A l’inverse de cette perspective, un Lucien de Samosate ou un Favorinus d’Arles suggèrent pour leur part l’impossibilité de distinguer entre l’acteur et son personnage.
Seconde sophistique : l’homme réduit à un personnage et la vie à une apparence
Règne des masques, vanité des conditions : les représentants de la seconde sophistique soulignent la totale dépendance des hommes à l’égard de la Fortune – la pièce perd de son sens, sans qu’il soit possible de s’en retirer. Le monde est un théâtre, et la vie un rôle - l’homme tant qu’il vit ne cesse de jouer, n’abandonnant son rôle qu’à sa mort. Dans Ménippe ou la Nécyomancie, Lucien de Samosate (115-190) retrouve les accents du cynisme et les radicalise. Le narrateur y évoque sa descente aux Enfers et tous les squelettes semblables qu’il y a vus :
« En voyant ces squelettes, il m’apparaissait que la vie des hommes est pareille à une grande procession, que la Fortune dirige et dont elle ordonne chaque détail (…) Jusqu’à un certain moment, elle nous laisse nous servir de notre costume ; mais une fois que le temps de la procession est passé, chacun rend son habit, se dévêt de son costume ainsi que de son corps, et redevient tel qu’il était avant de naître, sans rien qui le distingue de son voisin (…) Tu as souvent vu sur scène, je suppose, ces acteurs tragiques qui deviennent, en fonction des besoins du drame, à un moment des Créon, et à d’autres des Priam ou des Agamemnon (…) Une fois que le drame est terminé, chacun des acteurs se dévêt de son magnifique costume brodé d’or, dépose son masque et descend de ses cothurnes. Il évolue en homme pauvre et humble, il ne s’appelle plus Agamemnon fils d’Atrée ni Créon fils de Ménécée, mais Polos fils de Chariclès de Sounion, ou Satyros fils de Théogiton de Marathon. Ainsi vont aussi les affaires humaines, pensais-je alors à la vue de ce spectacle » (Ménippe, 16).
Nous ne sommes pas nos rôles, mais nous ne nous distinguons que par eux - sans les masques et les habits tout s’égalise. Lucien nous fait ainsi considérer cette vanité, sans laisser d’autre perspective : la vie des hommes tient toute dans ce jeu.
Favorinus d’Arles (80-150), lui aussi, développe l’idée que le théâtre mime strictement le monde ; de sorte que nous sommes de part en part l’effet de ce jeu de rôles, dont nous ne sortons jamais :
« ils [les acteurs] savent, je pense, que rien de tout cela ne leur appartient en propre : ni la royauté, ni la richesse, ni les palais du très riche Aléos, ni non plus la race de Tantale ou de Labdacos, ni la pauvreté, ni l’exil, mais que cela appartient au mythe et au poète, et eux ils doivent jouer tantôt un destin, tantôt un autre, jusqu’à ce qu’ils soient allés jusqu’au bout du drame. Et nous, dans le drame de la vie, nous serons fâchés d’obéir à dieu, le poète de ce monde-ci, s’il nous ordonne de jouer tantôt les maîtres, tantôt les exilés, tantôt les riches ou à l’inverse les pauvres ? (…) ne s’agit-il pas de changer de vêtement et de masque, alors qu’on reste identique à l’intérieur de soi-même, …en échangeant toutes sortes de costumes selon le rôle à jouer ? (Sur l’exil, 3)
L’homme-acteur, même s’il diffère de son masque ou de ses masques, ne peut être identifié que par lui, ou par eux. Sans les promesses d’un ailleurs intelligible, l’homme existe par ses personnages – le monde n’est qu’apparence, et l’on ne sort pas du théâtre.
Selon la vision chrétienne, en revanche, l’on joue, puis l’on sort de l’espace théâtral, pour retourner à Dieu.
Acculturation chrétienne de la métaphore
Au cours d’une de ses homélies, Saint Jean Chrysostome (344-407) livre comme la quintessence de l’usage chrétien de la métaphore :
« En effet, tout comme, lorsque le soir est tombé, et que les spectateurs se sont éloignés, les acteurs qui auparavant semblaient être des rois et des généraux, une fois sortis du théâtre, et débarrassés du vêtement qu’imposait la pièce, apparaissent désormais tels qu’ils sont : c’est ainsi qu’en vérité, une fois la mort venue, et ce théâtre abandonné, lorsqu’ils auront déposé leurs masques de richesse et de pauvreté, tous, partis dans l’au-delà, et jugés d’après leurs seules œuvres, font clairement voir lesquels sont véritablement riches, lesquels véritablement pauvres, lesquels méritent des honneurs, et lesquels sont dissimulés » (2ème Homélie sur Lazare, II, 3)
Dans la perspective des Pères de l’Eglise, la métaphore permet de marquer la nature et la valeur de notre vie terrestre, et donner à son terme, le moment de la mort et du jugement, tout son poids.
Lorsque les acteurs sont mis à nu, qu’ils ont ôté leurs costumes et leurs masques, leur être réel se dévoile, et le jugement de Dieu sanctionne ce qu’ils sont vraiment. Mais si Jean Chrysostome conserve un certain prix à notre vie d’acteur (la vraie richesse sous l’apparence de pauvreté ou de richesse, qui suppose un « double jeu », entre ce que nous jouons et ce à quoi nous œuvrons réellement), l’usage augustinien de la métaphore conduit à dévaluer le temps entier du jeu, qui ne fait que mimer la scène originelle de la faute :
« Sitôt nés, en effet, les enfants ont l’air de dire à leurs parents : Allons ! Songez à quitter la place – à notre tour de jouer notre mime ! Le fait est que la vie entière du genre humain n’est qu’un mime, le mime de la tentation, et c’est pour cela qu’il est dit : « Pure vanité que toute vie d’homme » » (saint Augustin, Enarratio in Psalmum, 127, 15).
Nous sommes ainsi pris dans une contradiction qui traverse notre existence : nous ne devrions pas jouer, mais y sommes voués, pour notre malheur.
Modernité : Montaigne, Pascal, la vision baroque
A la Renaissance, la reprise de la métaphore antique du theatrum mundi conduit par un effet de miroir à une réflexion généralisée sur l’illusion qui régit nos vies, sur les vanités et les faux semblants du commerce avec nos semblables. La métaphore sous-tend toute une vision du monde : rien n’échappe au doute, hormis la mort qui devient notre vérité, et fait ressortir la facticité de tout le reste.
Le stoïcisme s’attachait à réduire la mort à un événement naturel et usait du topos pour penser notre devoir d’homme et le rapport entre destin et liberté d’agir ; Plotin, lui, étendait la métaphore en faisant de la mort elle-même un simple changement de pièce, de costume et de rôle pour l’âme, jusqu’à ce que l’auteur nous fasse définitivement sortir du jeu. C’est en axant la métaphore autour du moment final de la mort, qui nous voit sortir du jeu et nous met à nu, que les sophistes écrivains du IIème s. d’un côté, les Pères de l’Eglise de l’autre, ont contribué à dramatiser si l’on peut dire la métaphore. Réelle et irréelle à la fois, notre vie se déploie dans un jeu d’apparences dont l’enjeu est pourtant notre moi singulier. Et la mort, le moment ultime de la comédie, devient le révélateur de ce que nous étions, ou de ce que nous aurons été.
Loin de son usage dogmatique initial, la métaphore se charge ainsi au XVIè siècle de traits sceptiques accusés : jeu des apparences, vie sans consistance, abîme du doute ou de la foi face au monde et à son créateur, ce sont ces thèmes que véhicule désormais le theatrum mundi. On ne s’étonnera pas alors de voir surgir sous la plume d’un Montaigne, oscillant entre la recherche d’une construction de soi d’inspiration épicuro-stoïcienne et la méditation sceptique sur les apparences, des résurgences de la métaphore centrées sur l’instant final. Il faut en effet, écrit-il,
« que ce même bonheur de notre vie, qui dépend de la tranquillité et contentement d’un esprit bien né, et de la résolution et assurance d’une âme réglée ne se doive jamais attribuer à l’homme, qu’on ne lui ait vu jouer le dernier acte de sa comédie : et sans doute le plus difficile. En tout le reste il peut y avoir du masque […] Mais à ce dernier rôle de la mort et de nous, il n’y a plus que feindre, il faut parler François ; il faut montrer ce qu’il y a de bon et de net dans le fond du pot » (Essais, I, XVIII).
Ici, la mort fait partie de la comédie, mais elle se joue à nu, sans dissimulation possible ; c’est en tout cas ce qu’exige Montaigne, tant il est vrai que les codes sociaux tâchent de recouvrir jusqu’au temps de la mort :
« Il faut ôter le masque aussi bien des choses, que des personnes. Ôté qu’il sera, nous ne trouverons au-dessous, que cette même mort, qu’un valet ou simple chambrière passèrent dernièrement sans peur. Heureuse la mort qui ôte le loisir aux apprêts de tel équipage ! » (Essais, I, XIX).
En écho à Montaigne, Pascal soulignera lapidairement que la comédie humaine s’achève sur la mort de l’acteur - un immense silence, et le mystère de l’au-delà :
« Le dernier acte est sanglant, quelque belle que soit la comédie en tout le reste. On jette enfin de la terre sur la tête, et en voilà pour jamais » (Pensées, 197 Ferreyrolles-Sellier).
Article publié dans Baccalauréat Théâtre, L'illusion comique, SCEREN-CNDP, 2008