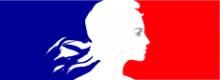Repères chronologiques
Les romans grecs :
De l’abondante production attestée par de nombreux fragments, seuls cinq romans grecs complets sont parvenus jusqu’à nous, selon une chronologie incertaine.
- Chariton, Chéréas et Callirhoé : Ier siècle ap. J.-C. au plus tard.
- Xénophon d’Éphèse, Les Éphésiaques, milieu du IIe siècle ap. J.-C.
- Achille Tatius, Leucippé et Clitophon, IIe siècle ap. J.-C.
- Longus, Daphnis et Chloé, IIe siècle ap. J.-C.
- Héliodore, Les Éthiopiques, IIIe ou IVe siècle ap. J.-C.
Les romans latins :
- Pétrone, Satiricon, fin du Ier siècle ap. J.-C.
- Apulée, Les Métamorphoses, IIe siècle ap. J.-C.
Avec le roman grec et latin, le pirate devient un personnage de fiction essentiel au déroulement d’une intrigue mettant en scène des jeunes gens issus de la bonne société dont la relation amoureuse est contrariée par ses méfaits. Cette figure ne se limite cependant pas à un simple stéréotype figé mais s’enrichit de l’héritage de la tradition littéraire.
S’il est difficile de dater avec précision les romans grecs et latins, les informations relatives à leurs auteurs font dans l’ensemble largement défaut. Les contours de ce genre littéraire sont eux-mêmes incertains, puisque l’on pourrait y intégrer des œuvres telles que le Roman d’Alexandre, attribué à Callisthène, la Vie d’Apollonios de Tyane de Philostrate ou encore les récits de voyages fantastiques.
Le pirate, moteur de l’intrigue romanesque
Romans d’amour et d’aventures, les romans grecs suivent, à quelques variantes près, une trame narrative similaire. Deux jeunes gens de milieux aisés y tombent amoureux l’un de l’autre, mais peu avant ou juste après leur mariage, un enlèvement brutal les sépare. Cet événement est à l’origine d’une série de voyages et d’événements souvent hautement invraisemblables au terme desquels ils se retrouvent. C’est à la faveur de nombreux déplacements –essentiellement maritimes- qu’interviennent les figures du pirate et du brigand.
Le contexte géographique de l’action, qui dépasse le cadre d’une cité unique, est essentiellement celui de la partie orientale du bassin méditerranéen, que parcourent les navires sur lesquels embarquent les amants. Chez Chariton, Chéréas frappe ainsi mortellement par jalousie sa bienaimée rencontrée à Syracuse. Sa tombe est pillée par des pirates. En vérité, Callirhoé n’est pas morte et la jeune fille est emmenée vivante à Milet (Ionie) par ses ravisseurs. Les amants se retrouvent après une intrigue dont le cadre s’étend jusqu’à Babylone. Dans Les Éphésiaques, les jeunes amants originaires d’Éphèse sont enlevés à Rhodes, emmenés à Tyr puis en divers lieux avant de se retrouver à Rhodes. Leucippé et Clitophon sont quant à eux enlevés sur les côtes égyptiennes où ils ont fait naufrage avant que les péripéties du roman ne les conduisent d’Alexandrie à Éphèse et Byzance. Daphnis et Chloé, originaires de Lesbos, se distinguent des autres héros des romans grecs par leur appartenance à un milieu social simple. Ce roman bucolique aux aventures peu nombreuses obéit toutefois aux codes du genre lorsque la véritable identité de ces enfants, fils de riches bourgeois adoptés par des paysans, est révélée à la fin du roman. Enfin, Théagène et Chariclée, qui fuient Delphes par la mer, sont capturés par des pirates dans le Delta du Nil avant de vivre une succession de péripéties qui les conduisent jusqu’à Méroé.
Une littérature de divertissement révélatrice des préoccupations de la société de son temps
L’intrigue de ces romans prend place dans un cadre temporel parfois éloigné du temps de la rédaction : les aventures de Chéréas et de Callirhoé se déroulent ainsi dans les années qui suivent l’expédition de Sicile pendant la guerre du Péloponnèse (415-413 av. J.-C.), tandis que l’intrigue des Éthiopiques d’Héliodore se situe à une époque où l’Égypte est toujours sous domination perse (avant 332 av. J.-C.). Les personnages représentés dans ces œuvres de fiction -au nombre desquels les pirates- n’appartiennent cependant pas aux périodes décrites et les multiples variations proposées autour d’une trame narrative commune représentent la bonne société de l’époque de leurs auteurs qui s’adressent à un public en quête d’une littérature d’évasion et de divertissement.
Mensonge, fourberie, lâcheté, cruauté : variation littéraire autour d’un thème classique
Si la piraterie est représentée dans la littérature depuis l’épopée homérique, le pirate devient dans le roman un personnage à part entière, moteur essentiel de l’action doté d’une véritable personnalité. Sa présence n’obéit pas seulement aux codes d’un genre. Chariton fait ainsi du pirate Théron, qui enlève la belle Callirhoé du tombeau où elle était enfermée, un personnage haut en couleurs : menteur, profondément de mauvaise foi et plein de malice. En se présentant mensongèrement comme Crétois, il s’appuie sur une double tradition antique : une tradition populaire et philosophique qui voulait que tous les Crétois fussent des menteurs, et une tradition littéraire héritée de la figure d’Ulysse qui s’inventa des origines crétoises (Odyssée, XIX,180). Il conduit la bande de ses complices, eux-mêmes profondément lâches, en étant mu par le seul désir de s’enrichir. Il refuse ainsi la proposition des membres de sa troupe de tuer la jeune fille ou de la rendre aux siens. La figure de Théron est également ici l’occasion de développer un discours critique sur Athènes : la délibération avec ses complices (I, 10) prend la forme d’une caricature de débat démocratique. Dans le chapitre suivant, l’escale athénienne est redoutée car les habitants de la cité sont présentés comme indiscrets, bavards, procéduriers, tandis que la sévérité des magistrats y est crainte. En comparaison, l’Ionie paraît plus hospitalière pour des pirates. La cruauté que les pirates ont en partage avec les brigands permet enfin de susciter l’émotion du lecteur au prix de représentations d’une horreur parfois caricaturale comme lors de la fausse mise à mort de Leucippé dans le roman d’Achille Tatius (III, 15) et dans sa prétendue décapitation (V, 7).
Mutations de la figure du pirate
La figure du pirate évolue et acquiert une réelle complexité chez Héliodore. Le plus tardif des auteurs dont les œuvres nous sont parvenues est aussi celui des romanciers grecs qui connut la plus grande postérité littéraire puisque Cervantes affichait dans le prologue de ses Nouvelles exemplaires l’ambition de rivaliser avec lui dans Les travaux de Persille et Sigismonde, roman achevé peu avant sa mort en 1616. Racine en fut un lecteur attentif malgré les interdictions de ses maîtres à Port-Royal. Plus près de nous, Verdi s’en inspira pour Aïda. Thyamis, chef d’une bande sévissant dans le Delta du Nil, est certes un homme brutal, mais il tombe aussi amoureux de sa captive Chariclée. Plus tard, il acquiert une réelle noblesse (VI, 13) en préparant la troupe qu’il dirige à s’emparer de la ville de Memphis afin de reprendre le sacerdoce dont son frère Pétosiris s’était traitreusement emparé. Personnage de roman, le pirate s’inscrit ici dans la tradition tragique. Il marche contre Memphis tel Polynice en route contre Thèbes pour reprendre le pouvoir qu’Étéocle refusait de lui céder (Eschyle, Les Sept contre Thèbes), et c’est devant les portes de la ville qu’il affronte son frère, dont la fuite lui permet d’être rétabli dans ses fonctions de prêtre. Au fil du roman, ce personnage passe ainsi du statut de pirate brutal tombé amoureux d’une belle captive à celui de prêtre rétabli dans ses fonctions selon un scénario hérité de la tragédie classique.
Le pirate, lieu commun littéraire ?
Les Métamorphoses d’Apulée sont riches de nombreuses figures de brigands et le récit de l’enlèvement de la belle Charité le jour de son mariage (IV, 26) reprend les principaux codes du roman grec. La représentation du pirate dans le Satiricon de Pétrone contraste toutefois fortement avec celle qui est proposée dans les autres romans grecs et latins. Le roman s’ouvre en effet sur une charge virulente de l’un des héros, Encolpe, contre la perte de l’éloquence et la vacuité de son enseignement. Les pirates (ch. 1), représentés les chaînes à la main sur le rivage figurent au premier plan des clichés qu’il dénonce, aux côtés des tyrans enjoignant à des fils de décapiter leur père et des oracles prescrivant de sacrifier des vierges pour remédier à des épidémies. Les pirates sont peu présents par la suite, si ce n’est pour désigner le capitaine d’un navire qui transporte les héros (ch. 101) ou dans une exagération épique faisant de Pompée l’« écueil des pirates » (ch. 123). La piraterie est raillée et tous les codes sont renversés : l’amour tendre d’un jeune homme et d’une jeune femme cède la place à une relation homosexuelle marquée par la débauche tandis que la violence de personnages douteux se substitue à celle des pirates et brigands.
Néanmoins, cette critique explicite présente dans le Satiricon doit être replacée dans le cadre de la société romaine de son temps et resta sans conséquence sur le succès postérieur du genre romanesque jusqu’aux Éthiopiques qui présentent sans doute la forme la plus aboutie du genre.