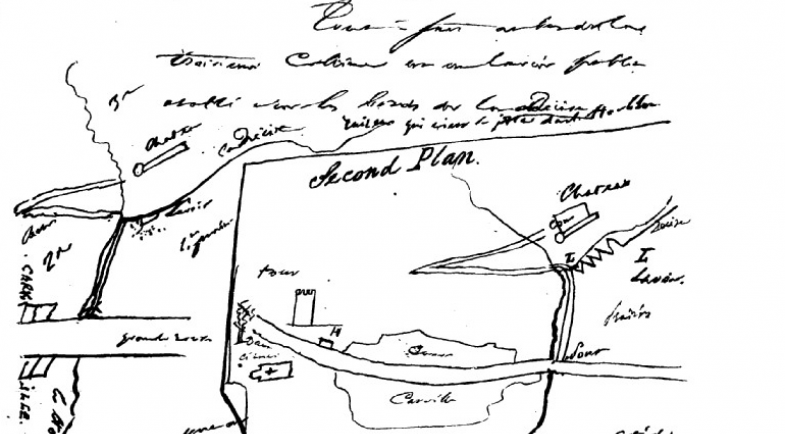Quelle fin Stendhal aurait-il donnée à Lamiel ? Il est difficile de le savoir, on est réduit à des conjectures. Mais s’il existe une logique de la création, comme je le crois, on peut supposer que l’histoire en apparence échevelée de Valbayre est la plus probable. On essaiera de dire pourquoi.
Lamiel, à la naissance incertaine – comme Fabrice, pour d’autres raisons – au prénom de garçon (Amable, prénom masculin auvergnat que l’on fête le 22 mai), est une enfant adoptée. Normande, sans doute, mais son cœur est bien singulier, son esprit fort peu « français ». Le vieux baron de Prévan dira que « c’est une fille d’esprit qui s’ennuie du ton de la bonne compagnie {…} elle a le courage plus humain que féminin de braver votre mépris » (p.1018)1. Si elle commence sa carrière romanesque comme une normande de basse condition qui va à Paris et y devient courtisane, elle aurait dû la terminer comme une révoltée et une criminelle, prise de passion pour un brigand.
Pendant que Stendhal écrit Lamiel, il polit La Chartreuse. Ses personnages qui ont « un cœur italien » côtoient la petite normande dans son esprit. Et parfois, quelques traits de ceux-là se mêlent au caractère de celle-ci. Elle est aussi ignare que Fabrice, elle est du côté de la nature beaucoup plus que de la culture, et ce sont les caractéristiques que Stendhal accorde à ses héros italiens. Elle ne sait pas grand chose, n’a rien lu, elle dévorera des livres le moment venu et se fera instruire par goût, par curiosité. On dira au passage quelle intuition a eu Stendhal en peignant cette héroïne de la curiosité : Freud, bien plus tard, affirmera que la curiosité est beaucoup plus développée chez les petites filles que chez les petits garçons, et que celles-ci sont tournées vers la connaissance dès leurs débuts dans l’existence : seule l’éducation les en détournera. Elle est un être rempli de grâce, (p.1017), rien ne la pousse à faire voir cette grâce, qu’elle ne cache ni ne met en avant : « Il (l’Abbé Clément) fut frappé de la grâce qu’il y avait dans la réunion d’un esprit vif, audacieux et de la plus grande portée avec une ignorance à peu près complète de toutes les choses de la vie, et une âme parfaitement naïve » (p.932)
Mais revenons au naturel de Lamiel : il est un état d’avant la chute, non pas dans le péché mais dans la lourdeur de la vie sociale. La qualité de liberté est plus forte en elle, l’insouciance, la curiosité, l’impulsion sans doute aucun, elle est un être intact traversé par une énergie vitale inattaquable, même par le libertinage, le sexe sans amour, l’orgie. Son naturel la préserve du desséchement qui la menace, de l’artifice, de la perte de soi pour n’être plus qu’une image, cette belle poupée qu’on exhibe à l’Opéra.
L’énergie vitale se manifeste par sa démarche rapide, ses mouvements, son besoin de courir par les champs et les bois comme le garnement Fabrice le fait dans son enfance. Et d’ailleurs, ces bois dans lesquels elle court ont une signification bien précise : ils renvoient au fantasme de l’Italie forestière, aux bois de la Chartreuse, qui abritent et protègent Ferrante, réserve du naturel de la vielle Europe. Revenir aux forêts, c’est revenir au naturel et à la liberté. On est en quelque sorte préparé à voir le personnage braver les interdits et se situer d’emblée au-delà du bien et du mal. Ce naturel la porte aussi à retourner vers le peuple, à reprendre ses sabots lorsqu’elle découvre la vanité et la vacuité du monde aristocratique : mais le peuple français est roublard et intéressé, elle n’est pas de la même étoffe, elle le quitte aussi, pour tenter autre chose.
Ce naturel qui la caractérise et qui n’est pas français, la protège, la curiosité et l’esprit de contradiction la poussent à chercher par elle-même. Lamiel réfléchit beaucoup, cherche à savoir mais ne planifie jamais sa vie. Lorsqu’il faut inventer un passé, elle le fait, mais elle n’a pas de stratégie de carrière, même dans le libertinage. Elle est en cela bien proche de la Sanseverina, qui prend ses décisions sur le moment et spontanément, qui se laisse guider par « l’impression du moment ». Comme Gina, elle cherche à se divertir, et l’ennui la saisit sans cesse, il lui faut céder à une autre impulsion. Le commencement est toujours agréable, il ne faut pas penser aux lendemains qui vont être si ennuyeux. On sait par Delécluze que ce qui fatigue le plus Stendhal, c’est qu’il y a eu une veille et qu’il y aura un lendemain : mieux vaut alors ne pas y penser. Lamiel partagerait ce point de vue, elle vit au jour la journée et accepte ce qui se présente. Elle fait des expériences, elle se donne à ce qui lui est proposé, elle vit dans le monde des commencements.
Lamiel résiste à Sanfin qui essaie de la rendre aussi cynique que lui et la posséder : il n’y parviendra pas. Elle partage plutôt avec les Italiens l’arte di godere : « cette façon de vivre était agréable physiquement, d’excellents dîners, des voitures rapides et bien douces, des loges bien chauffées, riches, tendues d’étoffe dans toute leur fraîcheur et garnies de coussins à la dernière mode… » (p.1019), voilà qui lui donne un plaisir à vivre dans la bonne société. Lamiel est un moi qui fait corps à la réalité, qui coïncide avec elle-même, avec ses sensations. L’Italien est « le développement simple d’une nature grandiose » écrit Michel Crouzet, comment mieux définir Lamiel ? Les jeunes filles italiennes sont « entièrement livrées aux inspirations de la nature », telle est Lamiel. Elle se laisse ravir innocemment au-delà du bien et du mal, par ce qui lui paraît en accord avec ses sensations. Et le torrent qui l’emporte, comme les Italiens, est celui de la vacuité de la vie sociale : rien ne la distrait de ses pulsions et de ses désirs.
Son pire ennemi est l’ennui – cet ennui que Gina chasse hors de la Cour de Ranuce Ernest -, mais au fait, qu’est-ce qui l’amuse ? Le sexe, certainement pas, la séduction non plus, plaire n’est pas son plaisir favori, elle n’aime pas qu’on la regarde, elle a peur des gens vulgaires et elle se sent gauche. Lamiel vit dans cette société sans attrait, océan d’ennui et de facticité. Ce qui l’amuse, c’est l’Opéra – elle accepte des choses ennuyeuses, seulement pour courir à l’Opéra - c’est la conversation, et pas le bavardage, les prêches et les discours, une conversation passionnante, comme celles qu’elle a toute jeune avec l’Abbé Clément. C’est aussi apprendre : se faire expliquer la comédie qu’on joue le soir (p.989). Ou se faire enseigner la géométrie. Ou bien encore regarder et étudier Mlle Volnys pour apprendre à se tenir et à bien porter les beaux chapeaux. Son atout est l’esprit et cela ne nous éloigne pas des italiens de La Chartreuse. « Bonne, simple, enjouée », elle ne demande qu’à être instruite et à faire fructifier ses talents. Et son œil a tant d’esprit ! (p.1007). Quand elle est heureuse, elle « est gaie jusqu’à la folie », ce qui est bien aussi un trait de Gina.
Comme Fabrice, elle se croit incapable d’aimer : « Suis-je insensible à l’amour ? » (p1019) se demande-t-elle, inquiète ? Elle vit – comme les italiens selon Stendhal – dans le monde du tout ou rien. Ou l’amour, ou rien. Elle s’applique, à découvrir le sexe, à jouer l’amour, mais tout cela ne lui apporte rien. Comme Fabrice, elle est heureuse quand elle est seule : « Cette nuit de voyage, fuyant un amour si aimable et si poli, fut, à tout prendre, le moment le plus heureux que Lamiel eût trouvé dans sa vie. »(p.995) tant qu’elle n’a pas trouvé son alter ego, elle se suffit à elle-même. Elle est méfiante, tout comme les Italiens, et se garde des autres, elle n’est unie aux autres par rien, elle se constitue en être-pour-l’amour, peut-être alors en être-pour-la-mort. « Il y a un beau livre à faire, l’éloge de l’assassinat » on le sait, quoi d’étonnant que Lamiel découvre l’amour passion avec un assassin ? Faire l’éloge de l’assassin, c’est faire l’éloge du sang, pas celui de la défloration qu’on essuie avec un pan de sa robe et qui est sans intérêt, celui de la violence et de la révolte, de l’énergie et du courage, de la transgression. Le poignard levé est bien plus excitant que le sexe dressé d’un campagnard empoté ou de nobles assez peu susceptibles de relancer le désir. La petite normande passera en terre « italienne », si on peut dire, en rencontrant enfin son Ferrante Palla, son brigand magnifique, son amant véritable. Lamiel doit aboutir à cette vibration de bonheur que la France ne sait pas donner, que seul celui qui s’oppose à la société française donnera : dans cette zone d’in-civilisation dont parle Stendhal. On s’aventure alors non pas dans les salons libertins qui ne présentent aucun danger, mais dans des régions mortelles, où on peut mettre tout « à feu et à sang ». Le pouvoir de l’assassin accroît incroyablement le plaisir, celui des sens et celui de l’existence. Dans les livres italiens de Stendhal, l’éloge de l’assassinat se fait de façon oblique, par un jeu de dénégations et des stratégies latérales, dans Lamiel il n’est pas écrit, le roman ne donne pas à lire la partie consacrée au plaisir, au bonheur, à la passion, à la mort. Et pour preuve de ce passage à l’italianité, on citera le moment où Lamiel est dite « méridionale »(« son caractère vif et presque méridional », p1017) ce qui est bien curieux pour une normande…
La dimension sublime est nécessaire au désir, comme lorsque la Sanseverina se jette dans les bras de Ferrante, « homme sublime ». Sans sublime, pas de désir sexuel, pas de passion. « Il est évident que le libertinage, ou ce qu’on appelle le plaisir dans ce monde-là et même ailleurs, n’avait aucun charme pour elle. » Les hommes français sont vaniteux et guindés, et surtout très politiquement corrects : comment pourraient-ils apporter la jouissance à Lamiel ? Mathilde a besoin de Julien et Clélia, de Fabrice, pour être sensuellement émues. Julien est dans un état d’excitation et de demie folie lorsqu’il tente de tuer Mme de Rênal, Fabrice tue Giletti et personne ne semble le condamner pour cela. L’un et l’autre sont violents et criminels, d’une manière ou d’une autre. Le danger stimule l’amour-passion, c’est dans une atmosphère de mort probable qu’on atteint la jouissance. Le sens moral s’égare d’autant plus qu’il est déjà bien faible : Lamiel veut surtout éviter l’ennui et ne recule devant rien pour cela. Les « mouvements contenus et ralentis » (p1017) s’opposent au mouvement de fureur de Valbayre, Lamiel a une vie désordonnée seulement pour côtoyer des dangers, et non pour le plaisir des sens (p.1035) : « …là où il n’y avait pas de danger, il n’y avait pas de plaisir ». Le sang, le crime stimulent le plaisir, crime gratuit et brutal, soulèvement de la révolte intérieure, embrasement de l’être, assez semblable à l’emportement du désir charnel ; les êtres sublimes comme Valbayre sont les seuls à pouvoir embraser les sens de Lamiel ; Valbayre est ce brigand italien, « au fond des forêts » qui vit intensément : elle connaît enfin l’amour.
Dans « Lamiel », il y a miel, certes, amie, elle, mais aussi l’âme et lame, Lamia…il y a le danger, et la passion : le roman qui est écrit est une longue initiation, un cheminement vers « l’italianité ».