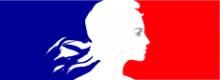Le mythe des âges successifs de l'humanité apparaît dans les Travaux et les Jours d'Hésiode, immédiatement après le mythe de Pandore. Prométhée a trompé les dieux en volant le feu ; Zeus, en représailles, envoie Pandore à Prométhée et enlève à l'homme nouveau les moyens de vivre ; le travail lié à l'arrivée de la femme clôt définitivement l'âge de la tranquillité et de la proximité de l'homme avec les dieux.
La différence essentielle avec l'Eden et la chute de la tradition biblique est que les dieux créent successivement plusieurs races d'hommes, sans grande précision sur la nature de leur reproduction, et que de fait la présence de femmes à l'âge d'or est laissée en suspens dans le récit d'Hésiode, comme l'a noté fort justement Jean-Pierre Vernant. Cette succession d'âges, correspondant à des races d'hommes successives (ge/nh), prend la forme d'une décadence et d'un éloignement progressif à la fois des dieux et de la valeur fondamentale qu'est la Justice.
L'association de métaux à cette décadence n'est pas une invention d'Hésiode. Il s'inspire probablement des civilisations orientales où la hiérarchie or / argent / bronze/ fer n'est pas inconnue ; les poètes latins reviendront à ces quatre étapes simples.
Hésiode, lui, insère entre l'âge de bronze et l'âge de fer l'âge des héros, qui est un arrêt dans la décadence, visant probablement à rendre compte du fait que chez Homère, la force brute et la fourberie qui vont avec la guerre sont tempérées par des valeurs de piété, d'honneur, de sagesse et de justice.
Il serait donc hâtif de réduire ce mythe une vision pessimiste du temps ou de l'histoire. La question de la représentation du temps selon une ligne continue ou une série de cycles reste aussi en suspens. C'est ainsi que ce mythe a été repris par Platon en liaison avec la succession des régimes politiques, qui n'a rien d'irréversible. Chez lui, les valeurs métalliques coexistent dans la société humaine et rendent compte à la fois d'une hiérarchie sociale originelle et de la possibilité de mutations à l'intérieur de cette hiérarchie.
De même, à l'époque hellénistique, des poètes astronomes ou astrologues comme Aratos de Soles dans ses Phénomènes lient l'âge d'or à la constellation de la Vierge : il s'agit ici clairement d'une succession dans le cadre d'un grand cycle de l'année ou de la "Grande année".
La poésie latine des guerres civiles et du début de l'Empire, en particulier chez Ovide, n'exclut pas du tout cette cyclicité, puisque le mythe des âges est utilisé à la fois comme instrument de critique à l'égard du présent et d'ouverture à une renaissance possible. Mais l'ambivalence de ce rêve à l'égard de la société réelle fait qu'il est imprudent de le réduire à la propagande d'un avenir radieux.
Ce serait faire preuve de démesure que de prétendre embrasser la postérité du mythe, mais on peut poser quelques jalons : l'âge d'or véhicule l'idée d'une décadence et d'une perte des vraies valeurs : mais on ne peut pas en conclure qu'il est toujours au service d'un discours réactionnaire parce qu'il a à la fois une portée critique et que le temps hors du temps qu'il laisse entrevoir est analogue du lieu hors de tout lieu qu'est l'utopie : on pourrait risquer de le concevoir comme "uchronie", autrement dit de restituer au regret son versant de désir.
Il sert en effet aussi à construire la représentation d'un avenir radieux, soit immédiat avec la venue d'un nouveau régime : l'âge d'or comme espérance ou propagande - le "retour de l'âge d'or" chez un certain nombre de littérateurs toujours prêts à louer par avance un gouvernement qui se met en place - , soit reporté sine die à la fin de l'Histoire au terme de tribulations nécessaires ; - le christianisme augustinien projette l'avènement de la cité de Dieu au terme de souffrances et d'acceptations de régimes imparfaits. - le communisme a pu être envisagé, au terme de révolutions et d'étapes douloureuses de socialisme, comme une sortie ultime de l'Histoire.
Le mythe est aussi traité sur divers registres critiques : le burlesque au XVIIe, le polémique au XVIIIe et au XXe : nous donnerons quelques exemples de cette veine iconoclaste qui démythifie l'âge d'or. L'âge d'or est lié sans nul doute à d'autres mythes qu'il n'est pas dans notre propos d'étudier ici : le voyage permet de faire savoir ou de faire croire qu'il existe d'autres civilisations, d'autres pays qui peuvent avoir maintenu cet état : c'est le mythe du bon sauvage ou de l'Eldorado. cet ailleurs peut être rêvé et construit avec plus ou moins d'actualisation du virtuel : c'est le propre de l'utopie. Nous nous bornons aux représentations d'un temps d'autrefois en excluant les simples espaces de l'ailleurs. Nous excluons aussi la notion judéo-chrétienne de paradis perdu ou espéré, même si la représentation plastique de l'âge d'or est influencée par celle de l'Eden. Jean Delumeau a excellement analysé l'amalgame dans le Jardin des délices, premier volume de son Histoire du Paradis, en 1992.
Il faut en effet constater l'absence de représentation iconographique ancienne de l'âge d'or : nulle trace de ce mythe sur les vases, peintures ou mosaïques antiques. Il faut attendre les représentations du Paradis chrétien pour voir apparaître, dans la lignée du texte d'Ovide, beaucoup plus rarement d'Hésiode, des images, qu'il s'agisse de peinture ou de gravure, de l'âge d'or et des âges de l'humanité en général. Il est normal et légitime de s'interroger sur les raisons de cette absence. Il est plus hasardeux d'y répondre.
Hésiode donne successivement au début des Travaux et les Jours deux mythes qui rendent compte d'une chute ou d'une décadence : le mythe de Pandore et le mythe des races (ge/nh).
Le mythe de Pandore
Dans ce premier mythe, les malheurs de l'humanité jusque là en harmonie avec les dieux proviennent d'un affrontement entre Zeus et le Titan Prométhée :
- Prométhée essaie de tromper les dieux en faisant la part des dieux et la part des hommes dans les animaux sacrifiés (aux dieux les os enveloppés sous la belle graisse, aux hommes la bonne viande enveloppée dans la panse répugnante) : c'est le partage de Mékônè.
- Zeus se venge en privant les hommes du feu.
- Prométhée vole le feu en le cachant dans une tige de fenouil.
- Zeus envoie Pandora et sa jarre. Si Prométhée (litt. "celui qui réfléchit avant") se méfie, son frère Épiméthée (litt. "celui qui réfléchit après") tombe dans le piège de l'amour et accepte Pandora : celle-ci ouvre la jarre qui libère tous les maux sauf l'espoir. Les hommes sont condamnés au respect de la loi divine et au travail du fait de la transgression irrespectueuse (les Grecs disent "hybris") des Titans.
Les hommes n'y sont pour rien. Il leur reste à gérer le monde tel qu'il est depuis l'existence de la femme, belle à l'égale des déesses et l'obligation qui en découle de travailler pour vivre.
Le mythe des races
Dans ce second mythe, qui est censé couronner le premier et être plus explicite, cinq races se succèdent du fait de la volonté de Zeus, conduisant d'une harmonie primitive à un avenir apocalyptique.
Il n'y a pas une seule humanité, mais cinq versions, de plus en plus éloignées des dieux.
L'homme n'est pas non plus coupable de cette décadence comme dans le récit judéo-chrétien de la Chute, mais il est en mesure d'en tirer des leçons : il faut choisir la justice et le travail contre la tentation de la violence et de l'hybris.
Points communs
Ces deux mythes ne sont pas reliés, mais proposés l'un après l'autre, d'une manière qui est caractéristique de la pensée grecque : les mythes laissent toujours à l'auditeur le choix de faire ou non la liaison.
Il y a cependant deux points communs :
- Le premier point commun en l'occurrence est l'hybris, et le danger qu'elle représente.
- L'autre point commun est dans l'intention énonciative : Hésiode est censé s'adresser à son frère Persès qui, déjà mécontent de sa part d'héritage, perd son temps en procès au lieu de travailler la terre. Les deux mythes sont des mises en garde.
Justice et démesure
C'est l'opposition entre la justice (di/kh) et la démesure (u(/brij) qui structure la succession des races (sachant qu'il faut entendre par "races" des univers humains distincts) ; ces races sont sans liaison génétique ; les deux premières sont créées par "les Olympiens", les suivantes par Zeus tout seul, la prise de pouvoir de Zeus correspondant à l'anéantissement de la race d'argent.
- l'âge d'or est caractérisé par une harmonie avec les dieux sans rivalité.
- l'âge d'argent par une explosion finale d'hybris sous forme de mépris des dieux.
- l'âge de bronze par une hybris guerrière sans valeurs.
- l'âge des héros par la guerre aussi, mais une guerre ordonnée à la défense de valeurs justes.
- l'âge de fer, correspondant au présent, par un choix libre, dans un temps où le mal et le bien coexistent, entre la justice et la démesure, avec la menace d'une victoire de l'hybris.
Réversibilité ?
Le récit s'achève sur la fuite d'Aidôs et Némésis, divinisations de l'honneur et la justice : l'humain est définitivement séparé du divin.
Rien dans le texte d'Hésiode ne laisse supposer clairement un retour de l'âge d'or sauf le souhait du vers 175 : "Plût au ciel que je sois mort plus tôt ou né plus tard". Rien non plus ne relie explicitement l'âge d'or à un acte créateur de Cronos.
L'âge d'or est créé par les Olympiens en général. C'est là que se distinguent la mythologie grecque et la mythologie romaine avec son mythe de Saturne en Ausonie.
L'idée de temps cyclique et l'association de l'âge d'or à Cronos, que l'on trouve chez Platon et chez les "astronomes" alexandrins comme Aratos de Soles, aurait un lien avec la tradition orphique...