Note
1 Comme le veut la coutume dans les carnets de voyage du début du XIXe siècle, les noms de personnes ne sont pas cités pour respecter leur anonymat.
Le voyage a été dans l’ensemble extrêmement agréable et certainement de loin le plus intéressant que j’ai jamais accompli — mes dessins, me semble-t-il, non seulement sont bons, mais du plus grand intérêt, indépendamment du fait qu’ils sont de simples images. Je suis le premier artiste, au moins de nationalité anglaise, à avoir fait ce périple et cela est déjà beaucoup.
J. 20 déc. 1838
Quand David Roberts (1796-1864) trace, de son crayon à mine de plomb, ces propos dans son journal de bord, il vient d’accomplir le voyage de trois mois qui l’a conduit d’Alexandrie au temple d’Abou Simbel en Nubie, sur plus de quinze cents kilomètres. Affichant la satisfaction du travail bien fait, sûr de lui — il y a de quoi! —, il se frotte les mains comme un habile commerçant venant de conclure une bonne affaire. Certain de son originalité, il ouvre une page brillamment et savamment colorée, insurpassée de nos jours, d’une Égypte qui n’est plus.
David Roberts naît dans le quartier de Stockbridge, à Edinbourg, le 24 octobre de la même année que la découverte de la lithogravure, en 1796. Sans doute est-ce là un des éléments qui marquera définitivement son œuvre. Sa carrière, classique, commencée dans un atelier de peintre, fut avant tout, dans son ensemble, celle d’un artiste de vedutte, spécialisé dans les effets de lumière. Ses dessins, reproduits grâce au procédé de la lithographie, ont, de son vivant, été l’objet d’un considérable succès, en particulier ceux qui paraissent sous la forme de trois volumes, entre 1846 et 1849, édités à Londres chez F. G. Moon et intitulés Egypt and Nubia faits à partir des dessins et esquisses réalisés lors de son voyage sur les rives du Nil pendant l’hiver 1838-1839, et lithographiés par Louis Haghe. Il a quarante ans.

Bien avant Roberts, on a représenté les monuments qui s’élèvent le long des rives du Nil. Frédéric Louis Norden a publié, en 1755, dans son Voyage d’Égypte et de Nubie, de nombreux croquis qui, s’ils donnent de l’Égypte une vue moins complète que celle des savants de Bonaparte dans la Description de l’Égypte, présentaient déjà l’intérêt d’offrir quelques vues spécifiques des principaux monuments ; mais, effectuées de loin, elles ne sauraient prétendre à l’extraordinaire, si ce n’est de son temps quand l’information, faute de pouvoir accéder aux sites, faisait défaut. Ce n’est que peu à peu que le voyageur s’approche des monuments égyptiens, siège de l’imaginaire, et cette quête est, pour une grande part, celle du XIXè siècle. Les premières grandes expéditions, organisées sous l’égide des nations européennes, ont une vocation archéologique et scientifique ; en Occident, où la concurrence académique est rude, chacun veut être le premier à publier tel ou tel monument, faire connaître telle ou telle inscription. Et, avant Champollion, avant le retentissement de la formidable découverte de 1822, les commentaires vont bon train. Grâce au déchiffrement de l’écriture hiéroglyphique, le rapport avec le monument devient plus étroit, la familiarité d’autant plus grande que les textes, auparavant muets, parlent ; l’œil s’adapte aux proportions inhabituelles de monuments indéfinissables ou sans rapport avec l’art grec, standard de l’étude académique et parangon, dans les écoles de David et d’Ingres, de toute expression artistique. En dépit de cet apport neuf, la perception change ; il se profile une vision qui ne se veut plus uniquement tributaire du seul angle de vue archéologique. Au diable les savants et leurs lubies ; on est las d’une Égypte morne, en noir et blanc, d’une Égypte griffée par le burin d’artistes qui, s’ils sont merveilleusement habiles, livrent de ce pays une image composée de traits et de lignes tandis que ceux qui l’ont visitée savent combien sa lumière est incomparable. Même les planches aquarellées de la Description de l’Égypte, avec leur contenu hautement érudit, sont loin se s’adapter au rêve oriental qui sourd progressivement d’une société frustrée de lumière et de récits d’Orient ; et, au début du siècle, Vivant Denon, qui se rattache à l’Ancien Régime, a fait naître dans les esprits un romantisme auquel participent des eaux-fortes parfois inégales mais cependant très documentées par un séjour dans des conditions extrêmes forçant l’admiration. Disons que le dessinateur et graveur qu’est le baron Vivant Deonest à la hauteur de l’homme de plume et que l’image et le texte se porte mutuellement assistance pour retracer une épopée scientifique et historique. Il est indubitable que Denon, qui a croqué avec talent les monuments égyptiens sous les angles les plus pittoresques, a impulsé en Occident ce goût des peintres pour l’aventure qui se poursuit dans la vallée du Nil, au-delà de l’apparition des premiers callotypes. De plus, sur bien des points, par son indépendance farouche, il complète avec bonheur la couverture iconographique de la Description de l’Égypte, œuvre qui se rattache davantage à l’esprit des encyclopédistes. En dépit de leurs proportions inexactes, les dessins du baron ont le charme du “ pris sur le vif ” exécuté avec maestria, entre deux assauts ne laissant que peu de répit aux artistes et aux savants qui emboîtent le pas à la colonne conduite par le général Desaix. Pourtant, malgré la documentation qui abonde, alors que les bords du Nil ont été dessinés sous tous les angles, nul artiste n’est paradoxalement à la hauteur de l’enjeu qui se profile : livrer le portrait de l’Égypte immortelle, au moment où s’amorcent déjà les coups de boutoir qui vont faire verser ce pays calmement agricole dans l’ère industrielle, sous la férule de Méhémet ‘Alî, haute figure d’origine albanaise sachant tenir sa partition dans le concert des nations. Dans cet univers en pleine effervescence où l’approche artistique ne le cède en rien à la politique, David Roberts est l’un de ceux dont le regard a profondément marqué son époque par sa remarquable acuité qui, avant la photographie, lui permet de donner des vues dont il semblerait presque qu’elles eussent procédé d’une technique d’avant-garde. Ses dessins n’expriment nullement la volonté d’apporter une touche savante supplémentaire, une démonstration incontournable. Il préfère l’impression sublimée par le savoir-faire au froid fac-similé et à la précision photographique des lieux qu’il laisse à d’autres, une technique correspondant à la phase suivante — celle des années 1850 — de la découverte de l’Égypte, grâce aux dessinateurs-photographes à partir de l’invention qui révolutionne le regard, le pionnier de cette technique en Égypte étant Maxime Ducamp en 1849. Toucher, jeux de lumière, dans les atmosphères qu’affectionne parfois Turner, règles de composition rigoureuses en font les pierres de touche des représentations de monuments pharaoniques élevés sur les bords du Nil. Malgré des sentiments personnels parfois réservés sur la nature de certains temples, il parvient, en deux temps — le voyage aller, relativement court, où il visite et le voyage de retour, plus long, durant lequel il se met l’œuvre — à imposer sa propre vision et a magnifier tout ce qui lui tombe sous les yeux ; tout le génie de Roberts consiste à ennoblir pour le plaisir des sens, en accentuant certains effets, des sites bien connus, à cueillir les derniers rayons d’une Égypte autant paysagère et arcadienne qu’elle peut être désertique et que le voyageur ne se lasse pas de contempler, tandis que la dahabeya ou la cange glisse lentement le long des berges verdoyantes où dorment, affalés, des crocodiles. La découverte de l’Égypte par ce moyen qu’est le bateau, même s’il présente quelques inconvénients — incommodités de toutes sortes dont les moindres sont l’inconfort et la petite faune du bord —, offre ces longues plages de silence et de méditation ayant permis à maints voyageurs de faire le point sur eux-mêmes, de confier leurs impressions à leur journal ; mais c’est aussi, paradoxalement, une occasion de retrouvailles entre amis ou compagnons, de franches lippées, et de plaisirs recherchés par de jeunes gens fortunés désireux de jeter leur gourme. Roberts, pour sa part, tient de l’homme mûr, vertueux de surcroît qui ne se laisse que peu détourner de sa mission : la sérénité d’une âme pure. Dans l’œuvre aquarellée et lithographiée de D. Roberts, l’œil, tout à un émerveillement qui dure, se repaît de pittoresque, de vêtements richement colorés, de carnations teintes par le soleil ; il ère vers les lignes de fuite, vers des lointains imaginaires et détient ainsi l’univers du rêve dans un réalisme irréel. Le lecteur, feuilletant les planches des albums égyptiens, se plonge dans un voyage fictif et délicieux, confortablment installé au cœur d’une bibliothèque bien éclairée, sans prendre d’autre risque que la dégustation d’une tasse de thé. En un mot, sa plus grande gloire est d’avoir su être célèbre — à défaut d’être immédiatement populaire — et d’obtenir le plus grand succès par la diffusion de ses images, quoique ses ouvrages fussent inabordables et réservés à une élite fortunée dans sa première édition, parue entre 1842 et 1849 en trois volumes de grand format (62 x 46,5 cm), édition à laquelle succédèrent trois rééditions, en format réduit, entre 1844 et 1858, dédiées à Sa Majesté Louis-Philippe, roi des Français. Le moins que l’on puisse dire est que le commentaire accompagnant les aquarelles de Roberts lithographiées avec talent par le grand artiste belge et ami du peintre Louis Haghe, commentaire dû à la plume de William Brockedon, inventeur et peintre, détone ; il ravale l’œuvre de Roberts au rang de vues uniquement destinées à étayer des clichés biblistes et pédants sur fond archéologique emprunté à la lecture de J. G. Wilkinson alors qu’elles rendent une atmosphère nécessitant, comme tout bagage, que la seule disposition à l’émerveillement. Les aquarelles se suffisent à elles-mêmes ; elles sont avant tout faites pour être vues, non pour être décodées ni pour servir de support à des mesures de tous ordres et à des comparaisons de mauvais aloi. Les propres commentaires de David Roberts eussent amplement suffi, de son temps, à les illustrer, car l’artiste, d’une culture étendue, n’en faisait pas étalage. Il suffit de prêter l’oreille pour entendre le cri des bateliers, le clapotement des vagues du Nil sous l’étave des dahabeya, le grincement des drisses et le claquement des voiles, sentir le souffle de l’air du soir rafraîchissant l’atmosphère saturée de chaleur, l’appel matinal du muezzin du haut d’un minaret décati pour comprendre des panoramas qui se passent de mots.
Bien entendu, l’œuvre orientale de David Roberts est née sous l’influx de courants de pensée typiquement anglais dont l’archéologie britannique est l’héritière, à commencer par l’esprit bibliste anglo-saxon qui fait que l’égyptologie pionnière outre-Manche fut celle des clergymen et des révérends. Sont englobés dans un même courant l’Égypte, les Lieux-Saints et les pays tels que Palestine, Judée, Syrie. En 1836, un événement d’importance marque de son sceau la connaissance de l’Égypte et de l’Orient, c’est la parution de la somme de l’arabisant Edward William Lane (1801-1876), intitulée An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptian written in Egypt during the Years 1833-1835. Cet ouvrage représente une synthèse de tout ce qu’il convient de savoir sur les us et coutumes des Égyptiens et des Turcs, principalement pour le voyageur qui s’aventure dans ces parages où prudence doit tenir lieu de conduite en toutes circonstances. Mais les années 30 sont surtout les années de parution des travaux de Sir John Gardner Wilkinson (1797-1875) comme Topography of Thebes, and General View of Egypt, London, 1835, mais surtout The Manners and Customs of the Ancient Egyptians, London, 1837, en trois volumes, qui relance une vogue d’égyptomanie insulaire suite aux expositions organisées à Londres, à l’Egyptian Hall de Piccadilly, en 1821, par Giovanni Battista Belzoni (1771-1823). Wilkinson force l’admiration ; il est le seul qui puisse supporter la comparaison avec Champollion ; sa démarche — l’apprentissage de l’arabe et du copte — lui aurait peut-être permis d’aboutir à un résultat dans la course au déchiffrement des hiéroglyphes. D’ailleurs, bien avant Champollion, Wilkinson est le premier à entreprendre une exploration archéologique de l’Égypte tout entière où il séjourna pendant douze années. On comprend alors, dans ces conditions, dans l’effervescence régnant en Angleterre, que Roberts ne tenait pas à être en reste ; il devine l’engoument que l’Égypte, sous l’effet croissant du Voyage dans la Haute et la Haute Égypte, de la Description de l’Égypte, des travaux anglais et européens, sous la montée du désir de découverte, fera naître parmi les Anglais habitués aux brumes du Nord et découvrant, comme jadis la lumière vénitienne de Guardi et de Canaletto, celle de l’Orient.
L’une des caractéristiques du succès de David Roberts vient de ce que parmi les artistes anglais il soit un des rares à être venu en Égypte et à avoir laissé à la postérité autant de peintures et de lithographies, quoique d’autres artistes insulaires comme Frederick Catherwood (1799-1854) — qui entreprit d’illustrer les sites archéologiques d’Amérique centrale — aient réalisé un voyage similaire (1825). Personne n’a reçu en partage le talent de Roberts ni même sa patience, sa robuste santé, sa ténacité et sa puissance de travail. Sûr de lui, dans les termes d’une fierté toute britannique, le peintre, qui n’ignore rien de la réception de l’Orient en Angleterre, est pratiquement certain du succès qu’il remportera lorsqu’il rentrera ses cartons à dessin remplis de croquis et d’aquarelles minutieusement retravaillées à plusieurs reprises, au Caire et à Londres. L’examen de son œuvre orientale permet de comprendre pourquoi il ne pouvait en être autrement, car les aquarelles du peintre sont de celles que l’on ne saurait oublier en raison d’un travail sur la lumière transfigurant les monuments, où le bleu est quasi proscrit : des ciels pommelés, des arrières-plans vaporeux en accentuent les effets romantiques. On est bien loin des grandes compositions historiques et délirantes du peintre telles le Départ des Israëlites (1829) ou Aaron délivrant le message aux Sages d’Israël, où Roberts est tributaire de l’ouvrage de Vivant Denon ; ces compositions, luxueuses de détails qui en font des morceaux de réception d’Académie, sont l’opposé des aquarelles de 1838-1839.
Alors qu’il s’est laissé aller, dix années auparavant, à ces grands tableaux montrant sa virtuosité dans le rendu de l’architecture, de sa culture historique sous l’influence des grands recueils égyptologiques, Roberts, dès lors qu’il croque sur le motif, ne se mêle plus d’être ni historiographe, n’insistant que très peu sur les détails qui permettrait une autre lecture que romantique, ni archéologue ; il se contente de traduire une réalité avec sa sensibilité propre. Il est très éloigné de l’état d’esprit d’un architecte comme Hector Horeau (1801-1872), visitant l’Égypte la même année, à qui on doit des vues visionnaires où du haut des pylônes des temples, des Égyptiens assistent comme si les sanctuaires égyptiens étaient des immeubles de rapport, au spectacle grandiose d’une ville empruntant ses traits caractéristiques à l’interprétation grandiloquante des auteurs antiques et des visionnaires modernes. Roberts est fasciné par les ruines qu’il dépeint mieux que personne, et quelle classe possède son recueil de lithographies par rapport aux vues ternes qu’Hector Horeau publie dans son Panorama d’Égypte et de Nubie, en 1841. D’un côté un aquarelliste à sensibilité atmosphérique ; de l’autre l’architecte visionnaire. Seul Richard Lepsius, dans l’édition de ses Monuments d’Égypte et d’Éthiopie (Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien) parus entre 1849 et 1859, l’équivalent, pour l’Allemagne, de la Description de l’Égypte de Bonaparte, offre des vues à la fois d’une extrême précision et d’où se dégage un charme romantique. Mais l’expédition de Richard Lepsius est une expédition avant tout archéologique ; elle ne se veut pas, à l’exception du premier volume, purement artistique.
Le voyage de David Roberts pourrait tenir dans le cadre de la vue cavalière représentant l’Égypte et la Nubie d’Hector Horeau qui s’inspire d’une autre vue célèbre, celle qui orne le frontispice de l’édition impériale de la Description de l’Égypte. Quand il débarque sur le sol égyptien, rien a changé depuis 1798, lorsque le corps expéditionnaire français, commandé par Bonaparte, a débarqué non loin d’Alexandrie. A peu de chose près, l’Égypte qu’a l’occasion de découvrir le peintre écossais est celle-là même que Vivant Denon avait dessiné dans des conditions et une perspective différentes. De plus, l’Égypte offre des avantages considérables pour un voyageur qui veut la découvrir, car tous les sites — mis à part les oasis et les temples du désert de l’Est — sont accessibles par voie fluviale. Tant la Grèce continentale et insulaire est l’occasion de faire un périple, autant l’Égypte se découvre par un simple déplacement linéaire sur le fleuve saint du Nord au Sud et du Sud au Nord, en empruntant les moyens de déplacement locaux, des dahabeya spécialement affrétées, avec leur équipage, un reïs et un cuisinier, pour affronter le voyage. Mais là commence pour l’inconscient qui n’est pas averti, tout un cortège de maux auxquels il lui faut remédier avec la plus grande fermeté — voire recourir à la bastonnade — à défaut de laquelle il sera vite un objet de dérision, détroussé et grugé de mille façons, surtout s’il n’a pas pris à son service un serviteur de confiance qui se chargera d’éloigner les importuns. Apparemment, Roberts, malgré sa prudence, n’a pas réussi à franchir sans encombres les écueils que représente l’entreprise et son journal, qui évoque au jour le jour son activité, fait état d’une mutinerie et de problèmes avec le reïs de son bateau, sans compter tous les tours habituels que se jouent les membres de l’équipage. Ismaïl, le serviteur de Roberts se fait dérober, une nuit, ses vêtements et ce dernier sait qu’il devra, en définitive, compenser la perte de ce malheureux.
Quand le feuillage commence à roussir en Europe, il est temps d’entreprendre le voyage et de gagner les cieux plus cléments des côtes africaines. L’automne est, en effet, l’époque la plus propice pour se rendre au pays des pharaons en empruntant la ligne de vapeurs qui relient Marseille à Alexandrie, relâchant à Malte et dans les Cyclades. Il s’agit non seulement de la période la plus agréable pour visiter l’Égypte et la Nubie, mais c’est également celle qui permet de remonter le cours du Nil, étant donné que l’on est à l’époque des hautes eaux car, contrairement au régime des fleuves européens, les hautes eaux du Nil coïncident avec l’été et connaissent leur plein au cours de l’automne. Remontant le cours du Nil aussi rapidement que l’autorisent à la fois le vent et la bienveillance de l’équipage qui connaît toutes les astuces pour retarder la marche de la dahabeya — en clouant des planches sur le gouvernail ou en en laissant filer l’ancre de pierre —, les voyageurs peuvent ensuite calmement redescendre, se laissant porter par le courant, et faire des haltes plus longues sur les sites qui les intéressent, sans connaître le risque des hauts-fonds qui se profile dès que le Nil baisse. Le phénomène saisonnier de la crue conditionne ainsi le voyage de David Roberts.
Telles sont les conditions lorsque le peintre débarque à Alexandrie, le 24 septembre de l’année 1838.
Le jour même, Roberts se rend sur le site de la colonne de Pompée. Étrange monument commémorant sous Dioclétien la victoire remportée, en 296, contre Achille (Elpidius Achillæus), proclamé empereur à Alexandrie en 292 après J.-C., la colonne en granit rose à chapiteau corinthien se dressant, du temps de Roberts, à l’extérieur des murailles d’Alexandrie, n’a rien à voir avec le rival de César, le divin Pompée ; érigée par le préfet d’Égypte Publius, elle surmontait l’hippodrome, le temple de Sérapis (le Sérapéum et les catacombes de Kôm el-Chougafa). Roberts affiche clairement sa déception : “ je dois avouer avoir été déçu par la Colonne de Pompée. Cela ne pouvait tenir au site, puisqu’elle s’élève sur une hauteur qui la met à son plus grand avantage. Elle est en cinq parties : le piédestal, la plinthe, la base, le fût et le chapiteau. Il ne fait aucun doute qu’elle était surmontée d’une statue qui pourrait bien provenir d’un temple, chose qui me paraît probable à voir le monticule sur lequel elle s’élève. ” Il ne joue pas, à l’inverse du dessinateur Protain de la Description de l’Égypte sur un effet de perspective rapprochée mettant la ville à touche-touche de la colonne. Le monument, que les voyageurs apercevaient de la mer et qui figure sur la plupart des dessins anciens de la ville, était très prisé des visiteurs qui se faisaient hisser à son sommet à l’aide d’un cable placé par un cerf-volant afin de découvrir un panorama d’ensemble de la ville. L’agglomération s’étend au loin, après une plaine rase et marécageuse, tapie derrière des murs blanchis, d’où émergent, à gauche, la mosquée des Septante ou des Mille colonnes, et, à droite, ce qui est vraisemblablement la mosquée abusivement dite de saint Athanase, alors que le ciel au loin annonce un grain.
David Roberts visite l’ancienne citadelle de Rhâcotis, guidé par Maurice-Adolphe Linant de Bellefond (1799-1883) — il s’agit dans son journal de “ Mr. L. ”, 1, géographe et explorateur du Soudan rédacteur d’un projet du percement de l’Isthme de Suez, qui lui a été recommandé par Robert Thornburn (1784-1860), consul général d’Angleterre en Égypte. Divers monuments reconaissables attirent aussitôt son attention, tant ils sont célèbres. Depuis plusieurs siècles, les voyageurs européens ont été accueillis à Alexandrie par des éléments qui faisaient partie intégrante du paysage : l’obélisque que l’on attribuait à Cléopâtre (“ l’aiguille de Cléopâtre ”) mais qui, avec l’obélisque couché, formait la paire que Thoutmôsis III avait élevée à l’entrée du sanctuaire de Rê à Héliopolis, site ayant servi, à la fin de l’époque ptolémaïque, de carrière aux bâtisseurs d’Alexandrie. Ils furent déplacés, lors de l’agrandissement de la ville, sous la dernière Cléopâtre qui les fit ériger pour orner un débarcadère au devant du Césaréum. Le paysage a étonnamment changé depuis la visite de l’Expédition française ; ladite Tour des Romains, se trouvant à l’arrière-plan, a laissé la place à une redoute ayant essuyé des tirs d’artillerie ; un mur doté de meurtrières a remplacé les décombres d’une muraille de l’ancienne Alexandrie, également nommée “ l’enceinte des Arabes ” (A. vol. V, pl. 32). Dans son journal, Roberts exprime en quelques mots la nature des monuments dont il reproduira plus tard les traits, dans une aquarelle intitulée l’Obélisque d’Alexandrie, communément nommée Aiguille de Cléopâtre : “ Une grande partie du célèbre obélisque que l’on appelle aussi Aiguille de Cléopâtre semble enfouie dans le sol. Étant donné sa position, il n’est pas impossible qu’il se soit dressé sur un piédestal — il y en a justement un gisant non loin et de la même dimension ; je l’imagine à l’entrée du temple. ” Les deux obélisques figurent dans la plupart des perspectives restituées de l’Égypte à partir d’Alexandrie et, déjà dès le début du XVIIè siècle, sur les cartes d’Alexandrie. Au temps de l’Expédition d’Égypte, l’obélisque de Cléopâtre se profilait devant la Tour dite des Romains qui, présente en 1798, céda la place à un fort, à l’angle de l’enceinte de l’ancienne Alexandrie, destiné à garder le grand port. Le second obélisque gît à terre, dégagé par les fouilles qu’entreprirent respectivement les membres scientifiques de l’Expédition d’Égypte puis ceux de l’Expédition franco-toscane sous la direction de Champollion.
Après qu’on eut proposé de les dresser sur la place des Consuls à Alexandrie même, la possession de ces deux obélisques représentent une pomme de discorde entre la France et l’Angleterre, car Méhémet ‘Alî, Pacha d’Égypte, les proposa à la France sous le règne de Louis XVIII. Finalement, l’Aiguille de Cléopâtre, donnée à l’Angleterre en 1820, ne prendra le chemin de Londres qu’en 1875 pour n’être érigé qu’en 1878, tandis que le monolithe couché fut attribué aux États-Unis, en 1869, pour être dressé à Central Park, à New York, en 1881. Afin de maintenir le fragile équilibre diplomatique entre le pachalik d’Égypte et les nations européennes, on sait ce qu’il advint de l’obélisque droit du temple de Louqsor, chargé dans une barge spéciale — le Louxor — à destination de la France en 1834.
Roberts profite de son séjour alexandrin pour préparer, en trois jours, un voyage de trois mois, et loue les services d’un serviteur, Ismaïl. Il commande également trois mois de vivres, reçoit du consul général les indispensables lettres d’introduction auprès du Pacha d’Égypte, et s’apprête à accomplir le voyage en direction du Caire, en compagnie de deux autres personnes rencontrées dans la ville des Ptolémées : M. Vanderhorst — dans son journal “ Mr. V. ”, également nommé “ Pickwick ” d’après la ressemblance qu’il offait avec le personnage imaginé par son ami Charles Dickens —, un mystérieux “ Mr. A. ” et le Capitaine Nelley, appartenant au 99e régiment, le East Middlesex, chargé du rôle d’interprète. Le fameux Pickwick, qui tient à voyager confortablement, prend également à son service un Maltais, et un cuisinier italien. La cange de Vanderhorst, un ancien planteur de canne à sucre, est fréquemment représentée par Roberts sur ses dessins et croquis au cours du voyage. Le lendemain, dès potron-jacquet, en compagnie de Linant bey, il parcourt la ville ancienne où il a l’occasion de visiter le portique à côté de la mosquée dite de saint Athanase puis, le 26 septembre, il se rend aux Bains de Cléopâtre et aux catacombes d’Anfouchi. Le 27 septembre, l’expédition est fin prête et les trois embarcations quittent Alexandrie à six heures du matin.
Le 28 septembre, Roberts et ses compagnons parviennent à la jonction du canal Mahmoudieh et du Nil. Pour le peintre, la rencontre avec le Nil est un choc : “ Le courant était très fort et les eaux aussi épaissies qu’il est possible… Le Nil coule ici très rapidement ; ses eaux sont brunes et épaisses. Il est à deux pieds au-dessous de son niveau normal. ”. Il cède au romantisme oriental, examine la nature luxuriante des lieux somptueusement cultivés. Puis les voyageurs visitent, sur le chemin, les ruines de l’ancienne Saïs. Dans le Delta, il est assailli par toutes les plaies d’Égypte réunies, comme il l’exprime dans son journal, le 29 septembre. Bien que la condition du voyageur se fût considérablement améliorée par rapport aux voyages du siècle précédent, Roberts, pendant son excursion, n’échappe pas aux moustiques dont il se protège par une moustiquaire et des gants qu’il s’est confectionnés lui-même, quand il n’est pas réveillé, la nuit venue, par les rats. Lentement les trois dahabeya gagnent l’apex du Delta, où s’étendent des sites prestigieux : Memphis et Héliopolis…
Vu en direction de l’Est, l’obélisque d’Héliopolis, dressé sous le règne de Sésostris Ier, est le seul monument émergeant des mornes sables de l’antique Iounou à peine animés par trois palmiers, et où s’élevait les temples dont le clergé avait, par ses connaissances et sa haute tradition religieuse, régné sur les cultes égyptiens. On a bien du mal à reconnaître dans ce lieu dépourvu d’attrait, dont l’animation se concentre sur deux groupes de janissaires bigarrés, armés de lances, l’On de la Bible, réputée pour ses penseurs et ses sages ayant attiré les philosophes de Grèce et d’Asie mineure. Hérodote puis Platon vinrent y parfaire leurs connaissances à l’ombre de ces ruines prestigieuses, lorsque l’Égypte, encore indépendante, régnait sur l’Orient. C’est en ces lieux que s’institua la synthèse entre la culture grecque et la culture égyptienne sous l’égide de Ptolémée Ier, lorsque Manéthon de Sebennytos, grand-prêtre de Rê à Héliopolis, sage gagné à la philosophie grecque, créa le culte de Sérapis. Aujourd’hui isolé et privé de son jumeau, ce monolithe ornait vraisemblablement l’entrée du temple. Au loin s’étendent les trois pyramides de Gîza qui offrent à l’imagination une chance de fuir en direction d’un autre univers. Gageons qu’en des temps anciens, la sainte Famille, immortalisée par le tableau de Luc Olivier Merson, amenée par les massacres d’Hérode à se réfugier en Égypte, passa près de ce monument comme le veut la tradition plaçant non loin de là, dans le village de Matarieh, l’arbre de la Vierge.
Le 30 septembre, ayant changé de barque deux jours plus tôt, il arrive en vue des pyramides. Après que l’équipage eut amarré l’embarcation et enfoncé le pieu dans un épais dépôt d’alluvion, il a l’occasion de voir le site dont il ne peindra l’aquarelle des pyramides de Gîza détachées de la chaîne libyque qu’au retour, dans le courant du mois de janvier 1839. La composition est centrée sur les pyramides, équilibrées par la masse d’une famille traditionnelle assise auprès du Nil. Dans les vapeurs, les tombeaux majestueux des rois de l’Ancien Empire dominent dans un effet de perspective rapprochée. Il s’agit, d’avant en arrière, et de droite à gauche, des pyramides de Khéops, de Khéphren et de Mykérinus, souverains de la IVe dynastie. Les monuments plus petits, visibles devant la pyramide de Khéops et derrière celle de Mykérinus sont les pyramides dites des reines. Là plusieurs personnages dont l’un porte la couleur du Prophète, installés auprès d’un escalier, tournent le dos à la rive ouest affectant l’aspect d’un désert. Seul le village devant lequel se détachent quelques voiles dans un bouquet de palmiers rappellent la vie : “ Aussi loin que porte la vue, d’un côté comme de l’autre, le pays apparaît richement cultivé et saupoudré de nombreux villages entourés de palmiers, lesquels, se combinant avec les minarets des mosquées, forment le plus pittoresque des tableaux. Les mosquées sont blanches tandis que les habitations, qui sont de simples cahutes faites de boue du Nil, ne se distingueraient pas de la terre qui les entoure si leur forme carrée ne les trahissait. ”

Tempête de sable arrivant sur le sphinx au coucher du soleil à Gîza, © Wikimedia Commons
La vue des pyramides, le 30 septembre avant de débarquer à Boulaq, cause à Roberts une surprise d’autant plus vive et contrastée qu’arrivé dans la capitale égyptienne, il pénètre dans un espace de quartiers (harah) aux activités spécialisées, de rues étroites et populeuses, surmontées de moucharabieh et abritées du soleil, et dont il émane les senteurs si spécifiques de l’Orient. Arrivé à destination, empruntant une route sur une élévation de terre — nous sommes en pleine inondation — menant du port de Boulaq au Caire, Roberts et ses compagnons se frayent un chemin pour trouver “ le seul hôtel anglais ” de la ville : le Hill’s qui, selon les guides de l’époque, est loin de jouir d’une bonne réputation, une partie des voyageurs étant obligée de coucher à même le sol de la salle à manger exposée aux courants d’air que laissent passer les fenêtres cassées. Avant que ne s’élève le Shepheard au Caire, qui révolutionne les conditions du voyage en Égypte, la vie y est une véritable aventure dont plus d’un Européen aura à souffrir.
Roberts séjourne une semaine au Caire, entre le 30 septembre et le 6 octobre ; il rend ses devoirs au Consul d’Angleterre, visite la ville et ses mosquées, ayant pris soin au préalable de louer les services d’un janissaire. En même temps, il contracte, le 2 octobre, un accord avec le capitaine du bateau jusqu’à la deuxième cataracte pour la somme de quinze livres, et le 3 octobre effectue l’excursion aux pyramides. Il reviendra en janvier de l’année suivante pour prendre la majorité des dessins du site qui parlent le plus à l’imagination : le plateau de Gîza. Le site, vierge, est encore tel que l’ont connu des générations de voyageurs occidentaux au cours des siècles passés. Sur la plupart des aquarelles, des janissaires, marqués par des taches rouges et quelques piques dressées dans le ciel rappellent que l’excursion à Gîza n’était pas, naguère, sans danger, les voyageurs étant contraints de faire le trajet dans la journée pour revenir avant la fermeture des portes de la ville du Caire, une pratique encore en usage en 1838. Et nul n’aurait pris le risque de s’aventurer sur le site, le soir venu, parmi les djinns qui passaient pour peupler les lieux où émergeaient les vestiges de monuments antiques, riches d’un formidable passé.
Il est difficile de trouver chez David Roberts composition plus sophistiquée et, peut-être, plus dépravée que l’approche du simoun. Désert de Gîza . Le simoun ou vent chaud, équivalent du sirocco du Maghreb, se lève au coucher du soleil et surprend une caravane, tandis que l’instant est renforcé par la présence dramatique du sphinx surmonté, à droite, par la silhouette de la Grande Pyramide, reconnaissable à son bout tronqué. Les bédouins, montés sur leurs chameaux, et venant à bride abattue s’abriter du phénomène qui menace. Déjà le vent souffle et, sur une ligne qui part du premier plan vers le second plan à droite, on ressent les premiers effets dévastateurs de ce fléau. Plusieurs hommes tentent de retenir une toile de tente qui risque de s’envoler au moment où ils s’apprêtaient à l’installer, tandis que les autres nomades font baraquer leurs chameaux, encore bâtés et à l’abri desquels les hommes se couchent afin de trouver une protection. Les pyramides que l’on perçoit dans le lointain, pourtant noyé dans la lumière rougeoyante de l’énorme soleil, sont soit celles de Dahchour soit celles des reines, quoique par une astuce de composition destinée à accroître la portée de la scénographie, le sphinx se trouve placé au nord de la Grande Pyramide, alors qu’il se dresse entre celle-ci et celle de Khéphren, à laquelle il est associé.
L’image de David Roberts, réalisée lors de son retour au Caire, vient ici renforcer le sens des différentes descriptions des Européens pour qui le simoun, “ le poison ou venin ”, représente un terrible fléau pour les voyageurs dans le désert qui peut se terminer de façon tragique. Nulle plume n’a mieux décrit le phénomène que Vivant Denon :
Au soir, je me sentis envahi comme anéanti par une chaleur étouffante ; la fluctuation de l’air paraissait suspendue. Au moment ou j’allais me baigner pour remédier à cette situation pénible, je fus frappé à mon arrivée sur les bords du Nil du spectacle d’une nature nouvelle : c’était une lumière et des couleurs que je n’avais jamais encore vues : le soleil, sans être caché, avait perdu ses rayons, plus terne que la lune, il ne connaît qu’un jour blanc et sans ombre. L’eau ne réfléchissait plus ses rayons et paraissait troublée ; tout avait changé d’aspect ; c’était la plage qui était lumineuse ; l’air était terne et semblait opaque : un horizon jaune faisait paraître les pierres d’un bleu décoloré, des bandes d’oiseaux volaient sur le rivage ; les animaux effrayés erraient dans la campagne et les habitants qui suivaient en criant ne pouvaient les rassembler. Le vent qui avait élevé cette masse immense, et qui la faisait avancer n’était pas encore arrivé jusqu’à nous. Nous crûmes qu’en nous mettant dans l’eau, qui était calme alors ce serait un moyen de prévenir les effets de cette masse de poussière qui nous arrivait du sud-ouest ; mais à peine fûmes-nous entrés dans le fleuve qu’il se gonfla tout à coup comme s’il eût voulu sortir de son lit, les ondes passaient sur nos têtes, le fond était remué sous nos pieds ; nos habits fuyaient sur le rivage qui semblait être emporté par le tourbillon qui nous avait atteint ; nous fûmes obligés de sortir de l’eau ; ainsi nos corps mouillés et fouettés par la poussière furent enduits d’une boue rose qui ne nous permit plus de mettre nos vêtements ; éclairés un moment par une lueur roussâtre et sombre, les yeux déchirés, le nez obstrué, notre gorge ne pouvait suffire à humecter ce que la respiration nous faisait absorber de la poussière ; c’est dans ces moments que nous sentîmes vivement quel devait être le malheur de ceux qui sont surpris dans le désert par un pareil phénomène. ” (Vivant Denon, Voyage dans la Basse et dans la Haute Égypte, p. 49-50).
De cette aquarelle, Roberts tirera une huile en 1850, intitulée A Recollection of the Desert on the Approach of the Simoun, qu’il offrit à Charles Dickens, “ Comme une marque de respect et d’admiration pour son talent et son travail, de la part de son ami et admirateur. David Roberts, Janv. 1850 ”.

Sphinx de GÎza et pyramides © Wikimedia Commons
L’énigmatique sphinx de Gîza, dénommé par les Arabes Abou el-Hôl “ le Père de la Terreur ”, dans la scène précédente, semblait arbitrer le conflit entre l’homme et la nature. Immergé dans les sables de Gîza, ce protecteur de la nécropole a frappé l’imagination de tous ceux qui, pendant des siècles, sont venus, accompagnés de janissaires, chercher des objets de curiosité et qui ont gravi les assises de pierre de la Grande Pyramide, afin d’inscrire, depuis l’an 1355 de notre ère, leurs noms au sommet, endroit que les anciens voyageurs nommaient “ la Taverne ”. C’est d’ailleurs l’escalade du plus haut monument de Gîza qui permet de rendre compte au mieux de ce site incomparable. Et Roberts lui-même est cet avis : “ Ce n’est que lorsque j’ai entrepris l’ascension de la Grande Pyramide, ce qui est une épreuve redoutable, que j’ai réellement été frappé par l’énormité de ses dimensions. Le sphinx me plaît encore davantage que les pyramides ” (J. 3 oct.). Les traits défigurés du sphinx qui, jadis, évoquaient ceux de Khéphren, firent l’objet de nombreux portraits qui prêtent aujourd’hui à sourire : le temps n’est pas encore aux descriptions fidèles, ni aux dessins précis. Cette aquarelle est complétée par une autre où les deux masses de pierre formées par les pyramides de Khéops à droite et Khéphren constituent l’une des vues des pyramides les plus curieuses de David Roberts, car prise sous un angle inhabituel, à partir d’un promontoire détaché au sud de la chaîne libyque. Quelques mastabas, à gauche, ont été taillés à même le roc libyque, tandis que le sphinx, auprès duquel s’est arrêté un groupe, redresse fièrement la tête. Là, d’autres voyageurs, que l’on distingue par quelques petits points de couleur, ont gagné le sommet de la Grande Pyramide. Les pierres arrachées au parement de la pyramide de Khéops, à droite, ont servi à la construction de nombreux monuments du Caire tandis que subsiste encore, accroché au sommet du monument de Khéphren, un fragment de la couverture de calcaire de Toura qui donnait jadis aux pyramides de Gîza l’image d’un blanc éclatant.
Défiguré à l’époque mamelouque à la suite d’exercices de tir au canon, on ignore encore, avant le dégagement incomplet du sphinx entrepris par Auguste Mariette une vingtaine d’années plus tard, l’existence du sanctuaire entre les deux pattes avant et la stèle dite du Songe dressée là, à la XVIIIe dynastie, par Thoutmôsis II et relatant le rêve dans lequel le dieu promettait le trône d’Égypte au jeune prince ayant trouvé abri une nuit au cours d’une partie de chasse, en l’échange de son désensablement. L’effet du sphinx renforce l’espace grandiose qui est celui du site de Gîza aux monuments écrasants et accréditant si fortement, par leur masse indestructible, les récits des voyageurs antiques et modernes. Le groupe d’hommes, installé sur des tapis tandis que des ânes attendent patiemment le retour du voyageur qui s’en doit retourner vers le Caire, établit une ligne de lecture de la scène vers la gauche.
Le séjour au Caire de Roberts et de ses compagnons s’achève le 6 octobre, après avoir visité les tombes des califes et d’autres mosquées du Caire, les 5 et 6 octobre. La nuit du 6 au 7, la navigation ayant été empêchée la veille par un vent contraire, n’est pas des plus réjouissante : Roberts est dévoré par les moustiques et les fourmis. Qu’à cela ne tienne, il reprend l’observation le lendemain matin, le vent étant tombé et l’équipage obligé de progresser à la rame. La section d’un Nil bas, prise en amont des pyramides de Dahchour présente l’activité sur le fleuve. L’élément principal est la cange, aux vergues posées, et manœuvrée à l’aide du seul gouvernail. Toutefois Roberts montre, par ce détail, qu’il a composé cette scène à travers des éléments saisis isolément, car il est impossible, ainsi, de naviguer à contre-courant. A l’arrière-plan, on distingue le champ des pyramides de Dahchour — les deux monuments de Snéfrou, dont la pyramide dite rhomboïdale —, puis, dans le lointain, celles de Saqqâra-Sud. Cette scène permet de mieux appréhender non seulement le système des élévateurs d’eau, à droite, mais aussi l’aspect d’un Nil qui n’est plus. Roberts lève surtout un pan du voile couvrant un trafic sordide, celui des esclaves. Sur les bancs de l’embarcation, où l’on économise la place, de jeunes esclaves soudanaises dont certaines dissimulent leur nudité sous un drapé blanc, s’entassent sans possibilité de repos. La scène apparaîtrait presqu’anodine si le peintre n’avait pris soin, dans son journal, de consigner cette rencontre : “ c’était un bateau d’esclaves de petites dimensions pour cet usage, transportant à son bord des femmes esclaves en provenance de Kordofan, et appartenant à un fieffé coquin : un Grec qui eut l’effronterie de me dire qu’il était chrétien. Mais, si ce n’est que ces femmes étaient privées de leurs proches — malheur suffisamment pénible en soi —, cette traite des esclaves ne semblait s’accompagner d’aucunes des horreurs qui président à cet odieux commerce au départ de la côte d’Afrique occidentale… La traite devait être assez lucrative car onze de ces pauvres filles vendues sur le marché suffisaient à rentabiliser le voyage… Seul un léger linge crasseux les couvrait. Comme le soir tombait, elles le serrèrent plus étroitement sur elles et se blottirent les unes contre les autres. ”
Le 11 octobre, après avoir assisté, l’avant-veille, au marché coloré de Béni Souef, et mis à la voile au milieu de la nuit, Roberts s’installe en vue des tombeaux de Béni Hassan qui fourmillaient de détails empruntés à la vie quotidienne du Moyen Empire : “ Les collines ou les rochers contenant les grottes sont la continuation de la longue chaîne de hauteurs qui court sur la rive orientale depuis le Caire… Devant et taillée dans la pierre, on voit une sorte de façade ou de portique soutenu par deux colonnes octogonales à plinthe dorique avec au-dessus l’indication devant dépasser, bien qu’elle ne soit pas partout toujours aussi distincte. S’il est vrai que les peintures à l’intérieur de ces chambres datent de neuf siècles avant l’ère chrétienne, comment douter que le style dorique grec vienne d’ici ? ”. Bien entendu, Roberts est loin du compte, car il faut ajouter à sa datation présumée un millénaire de plus, mais l’idée que l’ordre dorique fût originaire de Béni Hassan avait déjà frôlé plus d’un esprit, à commencer par celui de Champollion qui a immédiatement fait valoir la ressemblance des cannelures des colonnes avec celles des supports des temples grecs.
Transposition de l’entrée et du hall d’une maison du Moyen Empire, cette tombe, sur la rive droite du Nil, non loin de Minieh en Moyenne-Égypte, appartient à un gouverneur nommé Amenemhat, contemporain de Sésostris Ier. Les peintures de ces caveaux ont attiré l’attention des savants de la Description de l’Égypte qui en ont reproduit quelques scènes. Mais c’est surtout Champollion qui, au début du mois de novembre 1828, donne leurs lettres de noblesse à ces tombes. Au départ, l’espoir est mince pour Champollion de découvrir là quelque chose d’intéressant, dans la mesure où Jomard n’a offert de l’intérieur de ces tombes qu’un humble aperçu. Mais un coup d’éponge bien placé, avivant les couleurs des scènes, rend bientôt vie à des tranches de l’activité quotidienne exceptionnelles par leur originalité et leur composition.
L’aquarelle de David Roberts allie ici une image originale de la civilisation égyptienne à une scène de la vie quotidienne : celle d’un troupeau de chèvres pâturant un maigre herbage. Mais ces personnages et ces animaux ne sont là que pour renforcer le contraste d’avec ce monument qui émerge, comme par magie, de la falaise de Béni Hassan dont les tombes abritent, à l’époque du peintre, des familles de bédouins. On sourira à l’idée que du temps des princes du nome de l’Oryx, le portrait de ces nomades du désert de l’Est avait été tracé avec talent, en particulier dans la tombe de Khnoumhotep. Il aura fallu plusieurs millénaires pour que les habitants du désert prennent possession de l’endroit que l’art leur avait réservé d’emblée.
Roberts séjourne avec ses compagnons à Assiout du 13 au 18 octobre, mais l’agglomération, malgré son statut de capitale de Haute-Égypte, ne possède presque plus rien de son glorieux passé pharaonique : “ Quelques monticules de détritus à l’extérieur de la ville et un certain nombre de sépulcres éventrés sont tout ce qui reste de l’ancienne ville… En y entrant, la première chose qui frappe est la grande mosquée et son minaret élevé ; j’en ai fait un dessin ”. La ville est dominée, à gauche par la haute falaise où s’ouvrent les tombes des nomarques célèbres du Moyen Empire, dont celle d’Hâpydjéfaï Ier, représentée par les dessinateurs de la Description de l’Égypte. Mais déjà le pillage a fait son œuvre et il ne reste plus, dans les tombes de la Lycopolis des Grecs, que des fragments de momies et de bandelettes révélant un trafic fructueux d’antiquités.
A l’époque de Méhémet ‘Alî, au moment ou David Roberts la visite, Assiout est encore traditionnellement le lieu d’arrivée de la caravane qui vient tous les ans ou tous les deux ans, du Sennar et du Kordofan, apportant des produits africains — l’ivoire, les plumes d’autruche, la gomme, la casse et le sené — et des chameaux, que les caravaniers échangent contre des miroirs de Venise, de l’ambre de la Baltique, de l’outillage et de l’armement. Empruntant le Darb el-‘Arbaïn, “ la Route des Quarante (Jours) ”, les caravanes se regroupaient à El-Facher et à El-Obeid puis transitaient par les pistes jalonnées par les puits ; parvenues dans l’oasis de Kharga, à la latitude de Louqsor, le kachef local calculait les droits, puis elles obliquaient vers le nord-est pour gagner Assiout où hommes et bêtes parvenaient dans un état d’épuisement décrit par les voyageurs européens. Les observateurs rappelaient que cette caravane, à laquelle se joignaient parfois celles du Niger et du lac Tchad, comprenait des milliers d’hommes et environ quinze mille chameaux, avant que n’éclatât la révolte qui aboutit à la mort tragique d’Ibrahim Pacha, fils de Méhémet ‘Alî.
Ce commerce finit par décliner au moment où l’administration égyptienne, par mesure de rétorsion sur les pays qui ne voulaient pas se plier à sa loi, préleva des taxes de plus en plus lourdes sur les marchandises échangées, et au moment de la conquête du Soudan. Méhémet ‘Alî, par administration interposée, met un terme à ce trafic faisant d’Assiout un lieu particulièrement animé et qui, dans la seconde partie du XIXe siècle, entra progressivement en léthargie.
Au loin la grande mosquée d’Assiout et les bâtiments de la ville. Au premier plan s’élève le minaret d’une mosquée ruinée, de l’autre côté du fleuve, tandis qu’un groupe de trois hommes montés sur chameaux, mené par la bride par un homme à pied, s’éloigne.
L’arrivée à Assiout, lors du voyage de retour de David Roberts, après de multiples incidents, des problèmes avec son reïs et un début de mutinerie de l’équipage, est l’occasion, pour le peintre, de s’apercevoir qu’il a perdu le carnet de croquis exécutés en Nubie. Impossible de revenir sur ses pas quand il arrive, le 13 décembre. Par chance, il peut envoyer deux serviteurs, grâce à un bateau qui remonte vers le nord, vers Guerzeh où ceux-ci découvrent le carnet égaré.
Roberts débarque à Dendara le 19 octobre. Le peintre ne pouvait qu’être séduit par le temple dont l’aspect est connu depuis le début du XVIIIe siècle grâce au voyageur Paul Lucas qui en livra, le premier, une perspective. L’impression sur Roberts est forte : “ En y pénétrant, je fus frappé d’émerveillement — tout d’abord par le superbe état de conservation dans lequel je trouvais chaque partie, mis à part celles qui avaient été volontairement défigurées, ce qui était le cas pour presque tout ce qui se trouvait à portée de main ; et ensuite par le prodigieux travail dont les sculptures avaient fait l’objet ; tout était littéralement couvert de hiéroglyphes, de haut en bas et d’une extrémité du plafond à l’autre, à l’intérieur comme à l’extérieur et jusque dans l’étroit escalier où la lumière du jour ne peut pénétrer, des statues s’élevant à quinze pieds de haut jusqu’à celles si minuscules qu’il faudrait une loupe pour les examiner. Un travail qui s’était certainement prolongé sur des générations. ” (J. 19 oct.)
L’avis de Roberts sur l’art ptolémaïque n’est aucunement empreint des clichés ordinaires sur l’expression plastique tardive ; allant à contre-courant de l’opinion, c’est celui d’un homme sans préjugés. Frappé par la beauté du lieu, il reviendra trois jours en décembre, seul, et rendra la porte Est menant en direction du sanctuaire d’Ihy, à l’ombre de laquelle se tiennent quelques personnages, ainsi que la petite structure du toit — le temple d’Isis sur le toit du grand temple de Dendara — qui, jadis, servait à exposer la statue d’Hathor aux rayons du soleil levant et que le peintre compare “ au lit de Pharaon ” de Philæ, qui n’est autre que le kiosque de Trajan. On connaît également de lui le mammisi d’Auguste alors considéré comme Typhonium, et émergeant d’un monticule. Comme l’indique très clairement le peintre, à gauche de la reproduction de la façade du temple, l’aquarelle a été réalisée le 7 décembre 1838. Les abords de l’immense pronaos, aux colonnes hathoriques, du temple de Dendara, l’antique Tentyris, ont déjà bien changé depuis le temps de l’Expédition d’Égypte lorsque les savants de Bonaparte y bivouaquèrent et en firent dégager l’entrée afin d’en prendre les mesures et de copier les bas-reliefs des parties basses de la façade, sans doute aidés par les récolteur de sébakh, riche matière azotée prélevée sur les sites antiques. L’époque de Méhémet ‘Alî marque le début d’un redéploiement de l’agriculture, de sorte que la plupart des kôms antiques, formés de matériaux accumulés par des générations, disparaissent progressivement sous les houes maniées par ces paysans à la recherche de la précieuse matière. Grâce à l’institution de corvée, système médiéval, Mariette parvient à déblayer totalement ce temple, un des sanctuaires les mieux conservés de toute l’Égypte. Revêtues de couleurs somptueuses, les trente-deux têtes de la force divine locale, Hathor assimilée à l’Aphrodite des Grecs, sommant les colonnes du pronaos, soutiennent le plafond décoré de scènes astronomiques. Ce bâtiment tiendra en haleine Champollion et ses compagnons qui, armés jusqu’aux dents, s’y rendent de nuit, au clair de lune :
Les temples nous apparurent enfin. Je n’essaierai pas de décrire l’impression que nous fit le grand propylon et surtout le portique du grand temple. On peut bien le mesurer, mais en donner une idée, c’est impossible. C’est la grâce et la majesté réunies au plus haut degré. Nous y restâmes deux heures en extase, courant les salles avec notre pauvre falot, et cherchant à lire les inscriptions extérieures au clair de la lune. Nous ne rentrâmes au mâash qu’à trois heures du matin pour retourner aux temples à sept heures. C’est là que nous passâmes toute la journée du 17. (Champollion, à Champollion-Figeac, à Thèbes, le 24 novembre 1828).
Roberts, attentif au détail, n’a pas manqué de reproduire les traces de la dédicace en grec du monument, sur le rebord de la corniche du pronaos. Il ne cherche pas non plus à enjoliver la réalité, à l’inverse des dessinateurs de l’Expédition d’Égypte, mais il a tout de même pris soin, aidé au voyage aller par le capitaine Nelley, de faire un relevé du plan du sanctuaire. Les faces de la déesse de l’amour, de la musique et de la danse ont été saccagées par les premiers chrétiens voyant dans le lieu abritant cette force divine un des endroits où la religion traditionnelle avait le plus d’emprise. Force céleste, Hathor-Aphrodite protégeait les naissances, et les mariages étaient placés sous son égide, garantie de fertilité. Si l’impression générale, forte, est admirablement rendue, les détails semblent ne revêtir, dans l’œuvre de l’artiste, que peu d’importance. Pourtant, l’impression que produisit le temple sur David Roberts fut si forte qu’il ne s’éloigna avec peine, “ comme le soleil couchant dorait les éminences de la chaîne libyque et jetait de larges ombres sur le temple même à travers la plaine… ”.
Dans le passage axial du pronaos de Dendara dégagé jusqu’à l’antique pavement, se pressent plusieurs personnages armés de javelots (ou djerid), et habillés à la mode turque ou vêtus à la façon de janissaires, et destinés à maquer les proportions majestueuses du sanctuaire. Aucun d’entre eux ne prête attention au monument même dont la reproduction de la partie haute paraît inachevée. Ici, plus qu’ailleurs, Roberts dessine avec soin des Orientaux sous le regard desquels les colonnes restent muettes. Au-dessus de cette animation du monde, les raides silhouettes des parois répètent le rituel à l’infini : tableaux d’offrande représentant Pharaon devant les forces divines du sanctuaire, Hathor, Ihy ou Harsomtous, “ fils ” d’Hathor de Dendara et d’Horus d’Edfou. Plus que dans la plupart de ses dessins, l’aquarelliste qu’est Roberts tente de rendre la prolixité des artistes chargés de réaliser le décor du temple. De plus, l’animation du groupe au sein duquel on distingue des Albanais reconnaissables à leur costume traditionnel, contraste étrangement avec le hiératisme des figures, offrant ainsi une sorte de contrepoint à l’alignement, à l’ordonnance et à la symétrie d’un monde virtuel composé de règles et de mesures.
Le premier regard de Roberts sur l’antique Thèbes aurait dû se porter sur les ruines de Médamoud et son portique remontant au règne de Ptolémée VIII se détachant sur un fond pâle de chaîne arabique, mais qu’il découvrira qu’au retour. Personne ne saurait reconnaître le site actuel dans un paysage nu et désolé avec, comme toile de fond, la chaîne arabique. Parvenant, le 21 octobre, à Karnak, Roberts ne manque pas d’être lyrique : “ Grâce à Dieu, voici que nous approchons de cette ville si célèbre. L’armée française y a marqué un temps de silence avant d’exploser en un cri unanime en contemplant ce champ de ruines. ” A la vue du prestigieux sanctuaire, il pense à ses lectures, et principalement aux pages laissées par Vivant Denon qu’il a vraisemblablement sous les yeux au cours du voyage :
… cette cité reléguée que notre imagination n’entrevoit plus qu’à travers l’obscurité des temps, était encore un fantôme si gigantesque pour notre imagination, que l’armée, à l’aspect de ses ruines éparses, s’arrêta d’elle-même, et, par un mouvement spontané, battit des mains, comme si l’occupation des restes de cette capitale eût été le but de ses glorieux travaux, eût complété la conquête de l’Égypte. (Voyage dans la Basse et la Haute Égypte, p. 117).
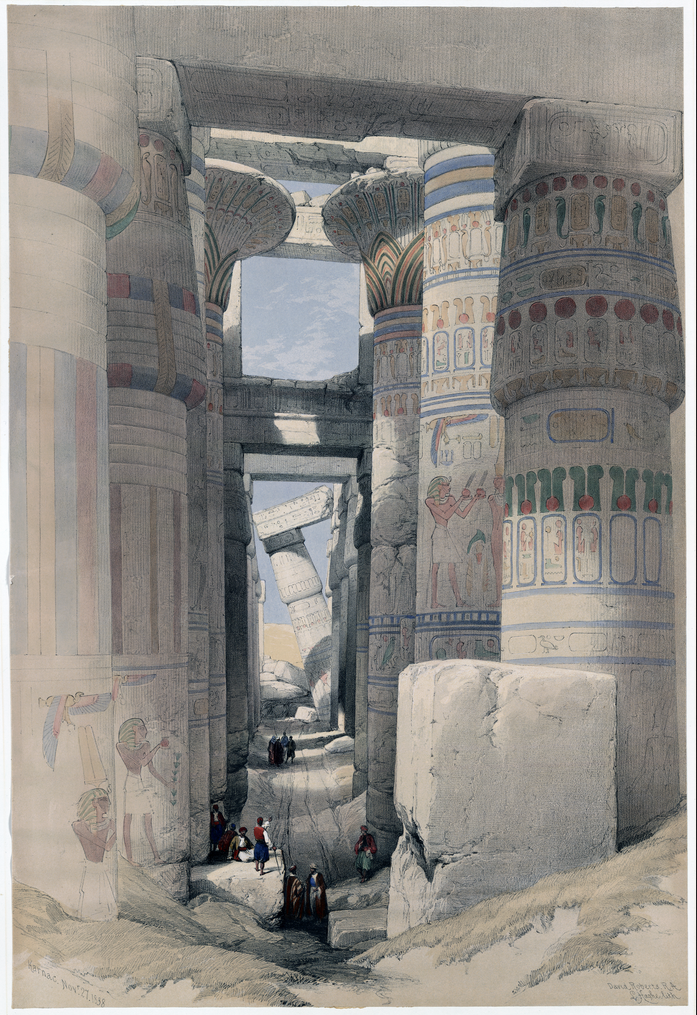
Mais la joie de la découverte du site est de courte durée ; lui et son groupe sont aussitôt assaillis : “ Déjà plusieurs guides entourent nos embarcations en brandissant des rouleaux de papier… qui se révèlent des recommandations de leurs précédents employeurs. La manière dont ils s’imposent à vous est d’un embarras affligeant, et le bruit et l’agitation qu’ils créent sont loin d’être compensés par le peu de choses qu’ils peuvent faire comme guides. ” Mais rapidement, l’ordre quotidien et l’observation reprennent le dessus. La journée du 21 est une journée faste tant la lumière est belle. Il reviendra plus tard, pour prolonger cet instant et brosser, à petites touches, des œuvres immortalisant Thèbes et sa région. Dans Ruines de Karnak, illuminé par le soleil levant, le temple, qui s’élève au cœur de la Thèbes-aux-cent-Portes des auteurs classiques, présente un aspect magique nimbé d’une lumière dorée qui n’appartient qu’au peintre. L’endroit de prédilection pour représenter l’axe est-ouest du grand temple d’Amon-Rê, seigneur de la création, est sans aucun doute le toit du temple de Khonsou, au-dessus de la cour qui précède la salle des offrande du sanctuaire. C’est là, sur cette terrasse, qu’autrefois les pèlerins laissaient une trace de leur passage qui revêtait l’aspect de deux plantes de pieds sculptées dans les dalles, accompagnées d’une courte inscription témoignant de leur ferveur envers Khonsou. Pour une fois David Roberts paraît conquis par ces ruines gigantesques qu’il reproduit avec fidélité et dont il s’empresse de noter le jeu des contrastes des masses éclairées et de celles qui restent encore dans l’ombre. Il recourt pour cela à un procédé artificiel à la Claude Lorrain, et montre le lever de soleil au nord-est de Karnak ce qui, dans la réalité, est impossible. On se plait à sourire quand on sait que le temple de Khonsou était encore, au temps où Richard Pococke le visita, un siècle plus tôt, l’endroit où un cheikh local avait logé son harem.
Le grand temple se déploie depuis le premier pylône à gauche jusqu’à la porte est, et l’artiste ponctue cette longue phrase architecturale successivement par la colonne de Pinedjem, les colonnes de la salle hypostyle de Ramsès II et de Séthi Ier, par les obélisques d’Hatchepsout et de Thoutmôsis III, puis l’Akhmenou, ou salle des fêtes construite par Thoutmôsis III. Au loin, se distingue la porte de Montou, qui faisait jadis partie du palladium sacré de Thèbes. Dans l’immense espace entre la ligne sombre du temple d’Amon et le lieu où se trouve le peintre, ce ne sont qu’allées de sphinx, de pylônes éventrés et de colonnes renversées. Quelques palmiers poussent non loin des points d’eau, vers le premier pylône et aux alentours de ce qui subsistait du lac sacré où les sacerdotes venaient autrefois accomplir leurs ablutions pour remplir leur devoir rituel quotidien. Tranchant d’avec cette apparente monotonie architecturale, voilà un groupe d’hommes et une femme portant une cruche pleine d’eau, image quelque peu anecdotique dans une scène de ce genre, et sans doute empruntée à un carnet de croquis sur le vif, dans la campagne de Louqsor ou ailleurs. Le soir venu, le temple est déserté et peu de riverains oseraient s’aventurer dans ces ruines. La nuit, en effet, les figures s’agitent et raniment les cultes de jadis, les afrit “ les démons ” se saisissent des imprudents qui oseraient venir surprendre leurs secrets. Ce sont eux qui gardent les trésors enfouis, et plus d’un suivra les traces du “ Livre des Perles enfouies ” donnant les indications destinées à retrouver les traces des richesses dissimulées dans les monuments antiques.
Changeant d’emplacement, David Roberts, qui plante son trépied sur le monticule correspondant aux demeures des grands-prêtres d’Amon, à l’est du lac Sacré, tourne autour du grand site de Karnak, afin d’en relever les aspects les plus spectaculaires. Jouant avec les effets d’un soleil couchant décalé vers le sud, afin d’accroître le jeu d’ombre et de lumière, le peintre compose, avec la scène précédente, un des tableaux les plus classiques de Karnak, un de ceux qui ont marqué la conscience collective. Sous la Cime thébaine, le flot argenté du Nil constitue la ligne de base du temple d’Amon-Rê, dont le môle sud du premier pylône divise l’espace en deux, entre la Cime et la colline de Drah Aboul’Naga. L’axe de la salle hypostyle se dessine, dominant les travées latérales, plus basses tandis qu’apparaissent les colonnes de la Salle des Fêtes au second plan et les colonnes du portique des Bubastides à l’avant du sanctuaire de l’obélisque unique, construit sous Ramsès II et dans lequel s’élevait l’obélisque dressé au Latran.
Le lac Sacré de Karnak n’est plus qu’une sorte de trou d’eau que les paysans des environs entretiennent pour abreuver le bétail et pour puiser de l’eau à usage domestique. Les déblais de curage sont rejetés sur les berges de cet espace liquide, formant comme une élévation au-dessus de l’allée qui longe le temple d’Amon-Rê. Les membres d’une caravane, accompagnée d’hommes en armes, empruntent cette piste poussiéreuse qui permet de gagner le village de Naga‘ el-Qaryeh puis d’aller, par la route du désert, jusqu’au village de Médâmoud.

Salle des colomnes, Karnak © Wikimedia Commons
Datée du 27 novembre 1838, la Salle hypostyle de Karnak vue en direction du nord (p. 32), dont il existe une autre vue analogue prise sous un angle décalé de 30 degrés vers l’ouest, met en relief le bouleversement qu’a subi la salle hypostyle de Karnak dont les colonnes, fissurées, menacent de s’écrouler. Il s’agit d’une vue transversale du programme architectural le plus ambitieux qui ait jamais été imaginé au Nouvel Empire. L’homme est là réduit à sa plus simple expression qui accréditait, pour certains, l’hypothèse d’une “ race de géants ”. Pourtant, la réalité est tout autre, et quelle que puisse être la nature impressionnante des colonnes dont les ombelles déployées atteignent près de quinze mètres de circonférence, le résultat procéda de la patience des hommes et du savoir-faire des architectes. Grâce à des moyens simples mais efficaces : le principe du talutage permettant de dresser les uns sur les autres les composants des tambours des colonnes puis le ravalement à mesure que l’on retirait l’échafaudage de brique crue remplissant toute la salle hypostyle. Les corps de métiers se succédaient pour donner à cette salle hypostyle son aspect aux couleurs vives et destinées à rendre vie à cet ensemble ainsi qu’aux scènes qui ornaient ces colonnes massives éclairées jadis par des claustras diffusant à l’intérieur une faible lueur. Roberts reprend la structure pittoresque du même axe latéral dans une autre vue effectuée en sens inverse de la précédente, procédé qu’affectionne le peintre, habitué à faire, par ce biais, le tour des monuments.
La salle hypostyle, bouleversée par les tremblements de terre successifs qui jetèrent à bas architraves et colonnes dans un chaos inextricable, est un monument qu’affectionne particulièrement le peintre. Après avoir évoqué l’enchevêtrement du passage Nord-Sud, Roberts porte son regard sur le calme arrangement de l’axe médian de la salle hypostyle autorisant les jeux d’ombre et de lumière diffusant, au soleil du soir, à travers les claustras. La grande vue axiale est réalisée deux jours plus tard que la précédente — le 29 novembre 1838. Elle fait apparaître, au deuxième plan, derrière les décombres du troisième pylône, l’obélisque d’Hatchepsout, tandis que plus loin, dans l’encadrement de la porte du IVe pylône, transparaît la porte du sanctuaire de l’Est. Prise en contre-plongée, la vue met en valeur les ombelles déployées des chapiteaux papyriformes de la travée centrale, ombelles si grandes qu’une cinquantaine de personnes pourraient s’y tenir debout. Dans une lumière attenuée, les personnages constituent une échelle microscopique à côté de ces ruines sur les chapiteaux desquels se déploient les cartouches des rois constructeurs, exprimant à l’infini leur gloire au vu de tous. La silhouette bleutée d’Amon-Rê portant une coiffure surmontée de deux hautes rémiges apparaît sur les colonnes formant l’axe vertical du dessin ; à la différence près que Roberts a privé Amon-Min de sa virilité. Prise sous un angle identique, un des dessins de Richard Lepsius présente une différence fondamentale qui tient au fait que les dessinateurs de l’expédition allemande font ressortir les textes des architraves qu’avec prudence Roberts laisse dans l’ombre. Déséquilibrées comme des quilles lors d’un tremblement de terre, les colonnes latérales de la grande salle hypostyle de Karnak offrent là, avant que la catastrophe fût consommée en 1899, lors d’un autre séisme qui jeta à bas les colonnes, un bien triste aspect. Le sol est comme soulevé par endroits et l’on voit même à l’arrière plan, dans le chas de l’aiguille que représente la percée de la travée latérale, l’une des colonnes prête à s’effondrer et à entraîner avec elle d’autres supports.
En outre, Roberts ne manqua point de rendre, de façon experte, l’allure de la première cour, entre les premier et deuxième pylône du grand temple de Karnak. La colonne qui reste encore debout de l’antique colonnade de Pinedjem est un des points d’appuis de la plupart des représentations — dessins, gravures, photographies du milieu du XIXe siècle — du temple de Karnak. On pouvait juger là du travail de l’Égypte ancienne étant donné que les hautes colonnes de ce kiosque, jadis destiné à abriter la barque d’Amon à l’entrée du temple lors de ses sorties solennelles, s’étaient effondrées comme les piles de pions d’un jeu de dames. Le deuxième pylône, éventré à la suite de l’action de sape des eaux d’infiltration, donnait, avant les travaux de Georges Legrain, l’aspect d’un chantier abandonné s’accordant avec le revers du premier pylône auquel s’adossait encore l’échafaudage de briques crues qui avait servi à son élévation. L’effet de la lumière qui frange à l’intérieur de la salle hypostyle et qui guide l’observateur vers le point focal — l’axe du grand temple — est un des plus réussies des vues de Karnak.
Roberts réalise avec minutie l’examen des lieux, à commencer par le propylône du temple de Khonsou et le sanctuaire d’Opet vus en direction du nord. Cette vue formant la vignette de la page de titre de l’édition de 1849, à Londres, chez F.G. Moon, est celle que jadis les voyageurs découvraient lorsque, venant de Louqsor, ils arrivaient dans la partie méridionale de Karnak. Après quelques sphinx acéphales ayant perdu leur attrait et essuyé les injures du temps, ils étaient accueillis par la majestueuse porte de Ptolémée III Évergète, qui, dans l’antiquité, était encadrée par un mur de briques crues aussi élevé que sa corniche — on en aperçoit un vestige à gauche — de sorte qu’il était impossible au riverain d’apercevoir, ne serait-ce que le pylône du temple de Khonsou se trouvant juste à l’arrière-plan. L’artiste, afin de donner le plus de cohérence monumentale possible à son dessin, a étonnamment joué sur l’effet de perspective rapprochée. En effet, par un jeu subtil, l’enfilade du temple de Khonsou semble mener, comme s’il s’agissait de propylées, au temple perpendiculaire d’Amon-Rê. On ne peut imaginer, en admirant les aquarelles de Karnak, que Roberts eût été saisi par le doute, et pourtant… S’étonnant du passage de Vivant Denon relatant l’admiration du corps expéditionnaire français découvrant les ruines de Karnak, Roberts confie à son journal (J. 23 oct.) : “ Ce n’est qu’en se rapprochant que l’on est submergé d’étonnement ; il faut être en dessous, lever les yeux et marcher ici et là, et c’est pour cette raison que je crains que mes peintures ne puissent rien traduire de ce que je veux exprimer. ”
Dominant le paysage de son impressionnante silhouette, le propylône construit sous le règne de Ptolémée III Évergète se profile au devant du temple de Khonsou, expression lunaire de l’être divin de Karnak, tandis que les sphinx acéphales à la suite du grand malentendu consécutif à l’essor du christianisme assistent, muets, au ballet des allées et venues de personnages armés de lances et aux vêtements richement colorés qui tranchent d’avec la masse ternie des monuments. Roberts a su saisir une atmosphère spéciale, sous le ciel de Thèbes pommelé de nuages, sur le fond duquel apparaît, au troisième plan, la ligne formée par le grand temple d’Amon. Ruinée par les incendies, dépossédée de ses statues, privée de son gigantesque mur d’enceinte qui englobait sous sa protection l’ensemble des temples de Karnak à l’époque de Nectanébo, la ville sacrée montre ici l’empreinte des eaux de l’inondation qui, inexorablement, sappe les fondations des monuments telle jadis cette force souterraine maléfique qui s’opposait à la progression de la barque céleste. Hector Horeau emploie le même subterfuge pour une vue identique mais avec moins de talent que Roberts, et les grands placards de couleur n’ont rien à voir avec la délicatesse des valeurs qu’emploie le peintre écossais.
Après avoir étudié Karnak sous les angles, il se tourne, le 23 octobre, vers Louqsor et exécutera, à son retour de Nubie, quelques-unes des aquarelles les plus saisissantes de son voyage. L’une d’elles, vue générale, représente le temple de Louqsor de l’arrière vu en direction du nord-ouest. Naguère le Nil formait une courbe beaucoup plus marquée que de nos jours, même si la perspective de Roberts paraît exagérée. Protégées par l’épaisseur du temple, les maisons blanchies du village s’étendent au sud-ouest, dominé par la mosquée du saint Abou el-Haggag. A part quelques palmiers, on ne peut qu’être frappé par la nudité d’un pays, en passe, grâce à Méhémet ‘Alî, de devenir un pays industrialisé sous la direction d’ingénieurs européens. Roberts s’est probablement installé sur une île nommée Géziret el-Gédîda, sur laquelle il surprend un fellah prenant un peu de repos après avoir manœuvré le balancier de son chadouf, à côté duquel poussent des cactus, tandis que de l’autre côté du bras du Nil, des hommes s’activent auprès de deux batteries d’élévateurs d’eau, à deux niveaux différents.
Néanmoins, l’obélisque et le premier pylône du temple de Louqsor vu en direction du nord (p. 36 b) est l’occasion de replanter le décor, devenu classique, du temple de Louqsor vu par l’un des dessinateurs de l’Expédition d’Égypte : Cécile (A. vol. III, pl. 3). Fidèles aux techniques de construction du passé, les pigeonniers qui entourent le sanctuaire de Louqsor présentent un léger fruit qui les met à l’abri des écroulements. Ces pigeonniers, dont les locataires sont protégés des prédateurs terrestres par des branchages plantés dans la paroi et des oiseaux de proie par d’étroites entrées qui conviennent à leur silhouette, représentent une des principales richesses des campagnes égyptiennes et la fierté de leurs possesseurs. Cette structure dont la forme se discerne au-dessus d’une maison signale le statut d’un propriétaire terrien, dont certains habitent même à l’intérieur du temple, comme le signale la vue que l’on a à travers l’échancrure des deux môles du premier pylône. L’axe du sanctuaire est, pour des raisons qui tiennent à l’histoire du site et au tracé de la vallée du Nil, complètement distordu. A l’intérieur de la voie qui mène au temple et, surtout, à la mosquée d’Abou el-Haggag, incluse dans sa muraille, règne une véritable atmosphère de caravansérail. Des hommes armés de lances veillent, tandis que des janissaires se tiennent près de leurs chevaux et que des chameaux s’apprêtent à être chargés. Au moment où Roberts dessinait l’entrée du temple, un faucon venait de temps à autre se percher sur l’obélisque unique et allait voler au-dessus des pigeonniers. L’artiste n’a pas manqué de représenter ce seigneur des airs qui a marqué le sommet du monument d’un capuchon blanc.
L’obélisque et le premier pylône de Louqsor vus en direction de l’est quatre années après le passage de l’équipage du Louqsor et l’érection de l’obélisque sur la Place de la Concorde, forme une vue des plus étranges du site spolié ; elle est sans équivalent dans la Description de l’Égypte. Au sein d’une atmosphère de brume artificielle, alors que le soleil frappe le môle est du premier pylône du grand temple de Louqsor où la charrerie égyptienne — Ramsès II à sa tête — renverse la confédération hittite devant la ville syrienne de Qadech, se dresse l’obélisque cadet du sanctuaire. Un trou béant, devant le premier colosse de Ramsès II, sur la face duquel les premiers chrétiens se sont acharnés, rappelle seul la présence de l’Obélisque de la Concorde donné par Méhémet ‘Alî à la France en 1833. Ce don fut l’occasion d’une expédition placée sous la direction de l’ingénieur Lebas qui commanda toutes les opérations de la dépose du monument, allant jusqu’à diriger la manœuvre sous la silhouette de l’obélisque afin de ne pas survivre au déshonneur au cas ou ce dernier se serait affaissé malgré la mise en place des cabestans. Afin que la mission fût menée au mieux, une barge spéciale avait été construite dans les arsenaux de Toulon, baptisée le Louxor, tandis qu’un vapeur nommé le Sphinx, bateau mû par des roues à aubes, tracta la barge dans un sens, jusqu’à Louqsor, puis dans l’autre jusqu’à Toulon. Longeant les côtes de l’Espagne et du Portugal, puis celles de la France, le monolithe, tiré au Havre par un remorqueur — la Héva —, parvint plus tard à Paris, où il fut dressé, par les soins de Lebas, sur la Place de la Concorde en 1836.
Les maisons en briques crues du village de Louqsor, qui semblent dressées sur des collines de déblais, disparaissent ici dans une brume poussiéreuse, tandis que les personnages, habillés de vives couleurs, rehaussent les monuments figés dans une lumière irréelle. Pour une fois, Roberts s’est livré à une copie assez fidèle des textes hiéroglyphiques, composés de titulatures et de panégyriques de Ramsès II.
Dans les ruines du temple de Louqsor vues de l’ouest, depuis le Nil , le sanctuaire, déjà privé d’un de ses fleurons — l’obélisque droit —, a perdu, en 1838, sa physionomie antique. Là se côtoient l’antiquité pharaonique, le quotidien traditionnel et le “ modernisme ”. Réduit à des ruines grandioses, le temple émerge des décombres et du sébakh qui l’envahissaient et masquaient l’ensemble des richesses qu’il recèle. Les photos contemporaines de son dégagement montrent à quel point les cours d’un sanctuaire où se massaient jadis les participants à la grande fête d’Opet étaient remplies aux deux-tiers. La mosquée d’Abou el-Haggag, le santon local, se dresse au-dessus des monticules, à l’intérieur de la première cour, à droite du premier pylône, et son minaret, blanchi à la chaux, jaillit du sein du sanctuaire. A l’extrémité du temple, c’est-à-dire à l’extérieur du village de Louqsor, au-dessus des chambres les plus intimes réservées aux cérémonies tenues secrètes, on voit des constructions blanches qui correspondent à la “ Maison de France ” construite à l’époque à laquelle on vint prélever le futur Obélisque de la Concorde afin d’abriter les ouvriers et les ingénieurs dirigés par Lebas, puis occupé par l’agent consulaire de France à Louqsor. On aperçoit, devant le premier pylône, la large tranchée qui permit de dégager l’Obélisque en exil lors du voyage qui devait le mener vers la France.
Répondant aux deux creux formés par la première et la seconde cour, se déploient les voiles des canges et des felouques, aux vergues desquelles flotte le drapeau égyptien, et la cange de l’artiste, prêtes à remonter vers l’amont. Les marins d’une cange, en travers du courant, sont grimpés sur la vergue de l’embarcation afin de carguer la voile. A l’arrière de la cange au-dessus de laquelle flotte un drapeau européen, se trouve un cafas — sorte de caisse formée de spathes de palmier — dans lequel le cuisinier œuvrant à bord enfermait les poulets que l’on embarquait lorsqu’on remontait le Nil. Deux hommes traversent le Nil, à droite, équilibrant la composition, sous la “ Maison de France ”.
Les habitations flottantes des voyageurs, qui portent, selon leur taille, les noms de dahabieh, cange, djerme, font toujours l’objet, avant le départ, des tractations les plus étonnantes, tant sur le prix de la location que sur le fait qu’il convient d’éliminer du bord toute trace de rat et de vermine en immergeant pendant un certain nombre de jours les bateaux. On ne partait pas sans emporter un stock de denrées — et Roberts, on l’a vu, fait le plein pour trois mois — destinées à couvrir le nombre de jours que durerait le voyage, car l’Égypte d’alors est un pays où les habitants vivent en autarcie et n’acceptent qu’avec réticence de vendre leur production. Ainsi doit être faite provision de vin, de sucre, de thé et de café, ainsi que de farine, de poules et de poulets, quand on n’emmène pas avec soi une vache pour avoir du lait. De plus, tous les voyageurs hissent leur pavillon afin de pouvoir être reconnus par des compatriotes et afin de se conformer aux usages du pays. Roberts n’a pas manqué à l’usage de voir flotter le “ British flag ”, en achetant un Union Jack à Boulaq, le 4 octobre. Et plutôt deux fois qu’une : “ Ce n’est pas sans une bouffée d’orgueil à notre fanion britannique lorsque nous croisons quelque embarcation avec son drapeau en haillons, sur lequel figure une inscription en arabe ou le croissant et l’étoile du Pacha ” (J. 18 oct. 1938). Les rencontres sont alors l’occasion d’invitations réciproques entre hôtes de marque, moments de convivialité appréciés comme le montre la lecture de l’ouvrage de Louis Pascal, la Cange (1860), qui décrit mieux que d’autres récits de voyage la nature des relations entre Européens et administration ottomane. S’il passe quelques bons moment, en dépit d’un labeur harassant, Roberts, en revanche, aura à se plaindre amèrement de la vermine qui commence inexorablement à infester le bateau et qui préférait, comme le faisait remarquer Lawrence d’Arabie, la peau rosée anglaise à l’épiderme indigène. Sans doute n’avait-il pas pris soin de faire immerger l’embarcation pendant quelques jours avant le départ comme l’usage le recommandait.
Invitation à la découverte de la rive gauche de Thèbes, celle des antiques Memnonia, ainsi qu’on les nommait du temps de Diodore de Sicile, les montagnes de la chaîne libyque vues du temple de Louqsor (p. 43), fournissent l’occasion à Roberts d’étendre vers l’ouest notre regard. Étonnant paysage que la plaine thébaine prise à partir d’une architrave de la grande colonnade du temple de Louqsor, datant du 1er décembre 1838, et qui réunit les éléments essentiels d’une perspective à la David Roberts, réalisée à l’aide des procédés de composition chers à l’artiste : la Cime thébaine au second plan à laquelle répond le haut de la colonnade, et le chemin menant au village, placé à l’avant du premier pylône et dont les personnages, représentés à des échelles différentes, obligent à porter le regard vers la Cime thébaine. L’étrangeté vient de cette Égypte en friches, à travers cette section de la vallée du Nil, autrefois, d’après les textes, si riche et si prospère ; la plaine de Thèbes, désolée, confirme bien la vision qu’ont eue les savants de la Description de l’Égypte, où les seules terres cultivées ne sont représentées, sur les cartes, qu’aux alentours des villages, tandis que le reste est laissé à l’abandon. Trois masses blanches émergent de la rive ouest : à droite Gourna, au centre Kôm el-Bayrat, et à gauche sans doute Naga‘ Abou Hamed. Entre les deux derniers villages se dressent, isolés, les deux colosses de Memnon. Une autre ligne de fuite vers la droite est celle du Nil sur lequel les felouques tirent des bords, tandis que des canges sont amarrées au quai de Louqsor. Une petite scène pittoresque, où deux personnages aident un autre à gagner le sommet d’une architrave vient distraire le regard dans une scène où l’esthétique prime sur la vision archéologique. Bien entendu, on a beaucoup de mal à croire à cette scène irréaliste et à l’angle sous lequel la colonnade est prise, qui laisserait croire que le peintre se trouve à l’arrière, à un point plus élevé qui n’existe pas. De plus, rien ne permet, en effet, d’accéder aux architraves de la grtande colonnade qui culmine à 15,80 m. Il est donc clair que cette vue est une composition imaginaire à l’aide de croquis combinés, rapprochant en outre la perspective de la Cime thébaine, ainsi magnifiée.

Colosses de Memnon © Wikimedia Commons
Entourés d’un paysage bucolique dans une atmosphère dorée, les colosses de Memnon nommés pour l’occasion “ Toomy ” et “ Doomy ”, qui représentaient une halte indispensable pour les voyageurs cultivés de l’antiquité, semblent condamnés à assister à l’aurore sous les rayons desquels l’un d’entre eux émettait un “ chant ” aux dires des auteurs anciens. D’aucuns ont inscrit une trace de leur passage sur le colosse de gauche qui évoquait, selon les Grecs, le héros chanté par Homère. En revenant de Nubie, le 3 décembre, il réalise trois aquarelles dont celle de la présente page alors que le niveau du Nil a baissé par rapport aux premières vues où le fleuve était encore haut, un mois avant. Roberts, qui avait eu l’occasion de les voir en octobre, n’avait pas été particulièrement frappé par les deux statues : “ Nous continuâmes notre route vers le sud jusqu’aux célèbres statues de la plaine ; elles sont effectivement immenses, mais il n’en reste pas assez pour se faire une idée. Nous arrivâmes ensuite aux fouilles effectuées par Mr Salt, sur l’emplacement du temple dont on pense que ces sculptures étaient les gardiennes. ” (J. 21 oct.). L’artiste force donc sa nature pour magnifier les deux sentinelles de la plaine. Dans ses statues de Memnon à Thèbes pendant l’inondation, Roberts choisit une mise en scène réunissant les deux ensembles monumentaux de la rive est. Deux témoins muets contemplent, impuissants, l’image du déclin dans un soleil redonnant vie à la plaine. Sur le fond des premières montagnes des déserts de l’Est se profilent, à gauche les ruines gigantesques du grand temple de Karnak, à droite celle du grand temple de Louqsor. Ces deux statues, qui se dressaient jadis devant le premier pylône du “ Temple des Millions d’années ” d’Aménophis III, roi de la XVIIIe dynastie, baignaient jusqu’en 1967 dans les eaux de la crue. Très vite, cet immense monument, construit par l’architecte Amenhotep fils de Hapou, qui passa pour un des plus grands sages que l’Égypte eût connus, et à ce titre vénéré, fut démantelé et ses fragments remployés dans les constructions ultérieures. Il ne subsiste plus aujourd’hui que les traces de son plan au sol et des bases des colonnes de sa salle hypostyle, redécouvertes il y a peu. A la fois défigurés mais aussi restaurés dit-on par Tibère, à la suite du tremblement de terre qui se produisit en l’an 27 de notre ère et précipita à terre la partie supérieure du colosse dit de Memnon, ces deux statues monumentales, qui atteignent près de dix-huit mètres de haut, représentent, chez Roberts, une des expressions du romantisme égyptien.
En direction du nord, au-dessus d’une terre d’où l’eau s’est retirée et qui craquèle sous l’effet de la sécheresse, la vue des deux colosses en direction du nord présente leur masque détruit par ceux qui voyaient en eux des forces maléfiques de l’antiquité pharaonique. Le parti choisi est très différent de celui pour lequel opte Dutertre (A. vol. II, pl. 20) qui rend, comme dans l’aquarelle de David Roberts, le sol craquelé après le retrait de l’inondation. Fissurés par différents séismes, ces deux personnages de quartzite, sur l’un desquels se distinguent les assises de grès de la restauration de Tibère, sont accompagnés chacun d’une représentation de reine en ronde-bosse : la mère du roi, Moutemouia, et la grande épouse royale, Tiyi, mère de Toutânkhamon et d’Aménophis IV. Un homme, escaladant le colosse de Memnon, profitant d’une fissure provoquée par un tremblement de terre antique, tente de rejoindre deux autres personnages cueillant les derniers rayons du jour sur la plaine des Memnonia.
Le “ Temple des Millions d’années ” ou temple funéraire de Ramsès II, actuellement nommé Ramesseum, n’est bien connu qu’à partir du moment ou les dessinateurs de l’Expédition d’Égypte en fournissent des vues, des plans et des restitutions, sous l’appellation inexacte de “ Tombeau d’Osymandias ” d’après la dénomination de Diodore de Sicile (A. vol. II, pl. 24-33). Dans la vue intitulée fragments du grand colosse au Memnonium, à Thèbes, Roberts convie le spectateur dans la seconde cour, dans une de ces perspectives dépravées qu’il affectionne, qui rappelle celle de l’architecte Dutertre (A. vol. II, pl. 25) qui a défini pour longtemps l’angle le plus pittoresque. Par amour pour la composition, il réussit un tour de force lui permettant de représenter l’angle nord-est de la cour à péristyle à colosses reproduisant jadis les traits de Ramsès II, les vestiges du colosse — atteignant autrefois dix-sept mètres de haut — de ce souverain, placé à l’entrée de la seconde cour, devant le second pylône, et qui émerveillait les auteurs et les voyageurs de l’antiquité, à commencer par Diodore. Cet effet de perspective lui permet également de représenter, décalé vers la droite, l’entrée du premier pylône déjà rongé par les eaux de l’inondation qui parvenaient jusqu’à sa base, puis de marquer une ligne de fuite à partir d’un groupe de personnages bigarrés — hommes, femmes et enfants — debout ou assis ou appuyés sur des morceaux d’architraves. Au loin, mais artificiellement rapprochés, on voit les contreforts du désert de l’Est. Les personnages-prétextes donnent l’échelle des différentes parties du temple funéraire de Ramsès II, et Roberts n’a pas manqué de suggérer, sous le portique, au revers du second pylône, des scènes de la bataille de Qadech, tandis qu’au loin, au revers du massif sud du premier pylône, se déploie une scène triomphale représentant Ramsès II sur son char et mettant en déroute la confédération hittite devant la ville syrienne, sur l’Oronte. Par le plus étrange des hasards, l’effet que Roberts communique à ce dessin — composition des plus étonnantes — est sans commune mesure avec son sentiment personnel : “ Plus loin se trouve le Memnonium, dont les proportions me déçurent ; je fus en revanche surpris par la masse de blocs qui le composent. Les proportions des piliers, de deux modèles différents, sont remarquables. La tête et les épaules du Memnon gisant sur le sol sont énormes, et l’on se demande comment cette masse est arrivée là. ”
La première visite de Roberts sur la rive gauche avait commencé par le nord : “ Nous ne perdîmes guère de temps, en arrivant à Gourna, à louer des ânes pour nous rendre jusqu’aux ruines ; il suffisait de traverser un champ pour arriver, sur la droite, à ce qui restait d’un petit temple, dans un grand état de délabrement. ” (J. 21 oct.) Il revient le lendemain, pour, dit-il, “ étudier le temple en détail ”. C’est probablement à cette occasion qu’il eut le temps d’esquisser quelques-uns des éléments qui lui permirent, en atelier, de réaliser cette aquarelle. Profitant du fond fourni par un site de la rive gauche — le “ temple des millions d’années ”, temple funéraire de Séthi Ier —, Roberts rassemble les diverses physionomies de la société égyptienne, les unes habillées à la mode traditionnelle de l’Orient ou bien vêtues du costume turco-grec qui s’impose sous le règne de Méhémet ‘Alî. Le monument est là réduit à l’état de décor, et l’arrangement des personnages choisis dans les différentes classes de la société égyptienne, s’avère artificiel. A droite, coiffé d’une calotte noire et vêtu d’une galabîyya blanche courte se distingue un fellah ; puis, vêtus de grands manteaux et la tête enturbannée, et campés dans des attitudes diverses, deux hommes de la société traditionnelle encadrent la silhouette d’une femme. Coiffé d’un bonnet rouge et tenant un chibouk — longue pipe en bois terminée par un fourneau en terre cuite — un commerçant probablement se profile devant le groupe précédant. Habillés à la mode turco-syrienne, un autre groupe de personnages — des négociants — dont l’un, assis, s’apprête à fumer le narguileh. A gauche, l’artiste a réuni un Albanais, chaussé de babouches rouges et coiffé du bonnet grec, marque d’appartenance à l’administration de Méhémet ‘Alî, lui-même d’origine albanaise, une femme voilée de noir portant une cruche (ballas) pleine sur sa tête, tandis que deux enfants affichant les marques distinctives de deux classes sociales, se tournent vers les deux adultes. Dans cette image, Roberts fournit des types sociaux divers marquant leurs différences, dans l’enfance comme dans l’âge adulte, par le vêtement et d’autres signes.
Les colonnes papyriformes fermées de ce monument délabré du réel fondateur de la XIXe dynastie émergent à peine du sol, le temple ayant été submergé peu à peu par le limon du Nil.
Dans la foulée, quittant le temple de Gourna étudié dès le lever du soleil, Roberts se rend, après le déjeuner du 22 octobre, à la Vallée des Rois : “ Après le déjeuner, nous partîmes pour Bîban el-Molouk, les tombes des rois de Thèbes. La route qui y conduit serpente sur environ deux miles entre les montagnes qui bordent immédiatement la plaine. Je ne peux rien imaginer de plus grandiose que ces ruines, si radicalement différentes les unes des autres du même ordre ; rochers sur rochers, pas un brin d’herbe, pas la moindre végétation. La chaleur était intense. ” (J. 22 oct.) Revenant sur le site, il réalise l’aquarelle intitulée tombes des rois de Thèbes : Biban el Molouk. Dominée par la “ Cime thébaine ”, falaise sacrée des anciens Égyptiens qui l’assimilaient à une force divine, qui revêtait la forme de Meret-seger “ Celle qui aime le silence ”, s’étend une vallée sèche dans laquelle furent percés les hypogées des rois du Nouvel Empire. Dans cette vue prise alors que le soleil n’est pas encore au zénith, les sépulcres royaux s’ouvraient à flanc de falaise, béants et vidés de leur contenu depuis des millénaires, sauf l’hypogée de Toutânkhamon, découvert en 1922 par Howard Carter et Lord Carnavon. Au premier plan, à droite, afin de marquer la ligne de fuite vers la gauche, en direction du sommet de la Cime thébaine, Roberts, qui visite le site le 22 octobre et y revient le lundi 3 décembre, a installé un groupe de trois Européens habillés à la mode du temps, et accompagnés de deux chaoux locaux, discutant d’un dessin que l’un d’entre eux trace sur le carnet ouvert devant lui. Un autre groupe, non loin de là, à l’entrée d’une tombe, semble attendre le retour de ceux qui ont accompli une visite dans un des caveaux royaux, sans doute la tombe dite de Belzoni, ou sépulcre de Séthi Ier. Le site, connu grâce aux descriptions d’Hérodote à qui les prêtres de l’Égypte ancienne avaient confirmé qu’il existait quarante-sept tombes, fut l’objet de nouvelles découvertes quand Giambattista Belzoni vient y pratiquer des fouilles durant l’automne 1817 ; le Titan de Padoue met successivement à jour les hypogées de Ramsès Ier et de Séthi Ier. Champollion, un peu plus tard, au printemps 1820, réalise la première analyse des tombes royales. Quand Roberts parvient sur le site, il n’est nullement question d’insister sur ce que tout le monde sait déjà et c’est là une évocation sobre, mais combien évocatrice d’un site prestigieux. Cependant le peintre ne se prive pas, ajoutant foi aux propos de Belzoni, de consigner les méfaits de Frédéric Cailliaud, noté pudiquement dans son journal sous un “ C. ”, dans la tombe de Séthi Ier. Cette tombe, inachevée, permet à Roberts de prendre une leçon de dessin égyptien : “ Ce splendide mausolée n’ayant jamais été terminé, on peut y suivre tout le processus depuis l’applanissement de la roche jusqu’au tracé préalable à la craie rouge ; ensuite une main apportait des corrections en noir avant la mise en forme définitive. ” (J. 22 oct.)
Le même 22 octobre, Roberts, débouchant de la Vallée des Rois, se rend à Médinet-Habou, sans doute le mieux conservé des sites de la rive gauche, qu’il avait déjà visité la veille, et qui passe, à ses yeux, pour “ l’édifice le plus extraordinaire, dépassant toute description de la rive occidentale ” (J. 21 oct.) Ce n’est qu’en décembre qu’il exécute la grande vue de face du temple — Médinet-Habou. Thèbes 8 déc. 1838 —, une des plus étonnantes puisque là où aujourd’hui les bouquets d’arbres et la végétation verdoyante dissimulent le monument, s’étend le désert : le temple, qui se détache sur le fond vaporeux de la chaîne libyque dominé par la Cime thébaine, est entouré du village — l’ancienne Djêmé des documents copto-grecs — à l’identique d’Edfou. C’est assurément le lieu le plus pittoresque de la rive gauche car le village et le temple, qui tranche par sa masse blanche sur la brique crue de maisons, répondent à la Cime. Le temple s’élève au cœur de l’agglomération anciennement habitée par les Coptes à l’intérieur de l’enceinte en brique crue abritant plusieurs sanctuaires d’époque pharaonique dont le temple funéraire de Ramsès III qui vient ainsi profiter de la proximité d’un édifice cultuel dédié à l’Amon des origines : Kneph. Encore aujourd’hui, quelques maisons de l’ancien village restent accrochées à l’enceinte cernant le monument dans l’antiquité. La vue intitulée Médinet-Habou. Thèbes 5 déc. 1832, évoque la première cour du “ temple des millions d’années ” de Ramsès III ; l’espace s’est actuellement modifié en raison des dégagements au détriment de la vision étonnamment romantique du temps du peintre. Au premier plan, appuyé à une colonne, un personnage isolé gardant les affaires de l’artiste sert d’échelle. Les colonnes aux chapiteaux corinthiens dont certaines s’entassent pêle-mêle au centre et dans les angles de la cour de ce prestigieux monument, forment les vestiges d’une basilique chrétienne du IVe siècle construite pour éloigner les démons anciens ; par crainte des djinns, esprits des dieux susceptibles d’émerger des parois où leurs silhouettes sont tracées, les habitants du lieu, parmi lesquels se sont répandues des superstitions remontant par tradition aux temps pharaoniques, préfèrent vivre à l’extérieur.
Roberts insiste fortement, comme à Philæ, sur le caractère de remploi de ce monument antique, les déprédations consécutives à l’utilisation des lieux à l’époque chrétienne. A gauche et à droite, les piliers monumentaux revêtant la forme du souverain défunt, et que les savants de l’Expédition d’Égypte nomment “ caryatides ”, ont été détruits ; l’édifice menace ruine en maints endroits ; des trous ont été pratiqués dans les architraves, à gauche, dans lesquels s’encastraient des poutres. Sur le mur du fond, au nord, Roberts trace presque en filigrane les scènes de la “ fête de Min ”, jadis recouvertes, comme les scènes du sanctuaire de Louqsor, par un enduit de plâtre. Sous les galeries et dans le temple tout entier se déploient de multiples scènes témoignant non seulement des grandes solennités, des rites funéraires pratiqués pour l’Osiris Ramsès III, mais aussi de la gloire royale, dans la mesure où les événements du règne ont été reproduits avec fidélité : la victoire de l’Égypte sur les Peuples de la Mer, des exploits cynégétiques. L’artiste quitte Médinet Habou à regret lors de sa première découverte d’octobre pour se rendre au petit temple d’Hathor-Maât, niché à Deir el-Médîna et dont il a laissé une surprenante aquarelle. Sur le chemin du retour, dit-il, “ nous rencontrâmes plusieurs Arabes, au bord du chemin, qui nous proposèrent de nous vendre des momies, dont une était admirablement peinte, et un certain nombre d’ornements. ” (J. 21 oct.). Le commerce des antiquités est devenu une activité des plus lucratives, car les objets antiques sont extrêmement prisés des voyageurs et des collectionneurs : statues, sarcophages et momies de la rive gauche de Thèbes partent par milliers vers l’Europe.
Puis s’annonce le départ de Thèbes pour les sites méridionaux. En chemin, le 24 octobre, David Roberts à l’occasion de jeter les yeux sur le temple d’Armant, l’ancienne Hermonthis, charmant petit édifice périptère — le mammisi de Césarion — détruit en 1860 pour la construction d’une sucrerie : “ Le temple est petit, et en partie couvert de maisons ; le pronaos n’a plus de toit et les piliers se dressent tout seuls… les fondations d’un autre temple ont été dégagées à proximité ” (J. 24 oct.) Comme maints autres artistes et dessinateurs-photographes, il ne passera pas, en redescendant le Nil, sans donner de ces ruines charmantes une vision de rêve intitulée Armant 26 nov. 1838. Ancienne Hermonthis, où le mammisi, environné de monticules servant de cimetière, se détache de la chaîne libyque, sur fond de palmeraie. Le même jour d’octobre, lui et ses compagnons abordent à Esna, l’antique Latopolis des temps gréco-romains. Le temple est leur premier objectif : “ Nous touchons encore terre pour aller visiter le temple, mais le trouvons assiégé par les maisons de la ville ; après quelques temps, nous pouvons y avoir accès. Il sert actuellement de poudrière ; les murs sont noircis et couverts des habituelles divinités. Les piliers sont imposants et en forme de lotus, mais si nous n’avions pas pris soin d’emporter nos lumignons, nous n’aurions strictement rien pu voir. ” (J. 24 oct.)
Esna, au moment au David Roberts et ses compagnons y débarquent, est une petite ville davantage connue par les Européens de l’époque par la présence des almées éloignées du Caire par Méhémet ‘Alî. Elles constituaient l’attraction locale et plus d’un, à commencer par Gustave Flauvert et Maxime Ducamp, viendra goûter à Esna les charmes spéciaux de l’Orient et assister, dans les vapeurs du raki (l’arack) et les volutes de fumée, à leurs danses lascives. C’est également à Esna, ainsi que Roberts le consigne dans son journal de voyage, que les prisonniers aux travaux des mines d’or du ouâdî ‘Allaqi, en Nubie, sont rassemblés. Assailli par l’amabilité des Coptes qui semblent le considérer comme un des leurs, il va jusqu’à en représenter certains, reconnaissables à leur turban et à leur vêtement noir.
Le peintre, dans le temple à Esna. 25 novembre 1838, montre, à son retour, ce qui reste du sanctuaire d’Esna, dédié à Khnoum et à Neith et comblé aux deux-tiers de sa hauteur par des déblais. A l’époque de Roberts, et jusqu’au moment où on le dégage de ses structures adventices, l’incroyable temple d’Esna n’échappe à la destruction qu’au fait qu’il est employé successivement comme entrepôt de coton puis comme arsenal sous le règne de Méhémet ‘Alî. Au moment où David Roberts y pénètre, il est vide, et il est étonnant de constater le contraste apparent entre les colonnes témoignant des textes théologiques comptant parmi les plus complexes que l’Égypte ancienne ait laissés et les groupes de personnages sur des tapis qui ont posé leurs babouches à l’écart. Un fonctionnaire de l’administration ottomane paraît écouter les conseils de deux hommes qui, à leur allure, sont des notables, tandis que sur un papier déroulé sur ses genoux, un scribe semble consigner des plaintes émanant de paysans allant pieds-nus. Le pittoresque marque cette page du volume, où apparaissent pêle-mêle les images du passé pharaonique, réduites à des formes, à des contours à peine visibles, et celles du présent. En outre, les effets d’ombre et de lumière, doux et veloutés, traités en clair-obscur, sont considérablement accentués dans un édifice plongé, une grande partie de la journée, dans l’obscurité.
Au matin du 26 octobre, le capitaine Nelley et David Roberts se font débarquer à cinq miles au nord d’Edfou et gagnent la ville à pied, à travers la campagne, guidés au loin par les deux môles du pylône qui dominent l’espace environnant. Cheminant, les deux compagnons découvrent le tombeau d’un cheikh abritant des zîrs (jarres employées pour rafraîchir l’eau) destinés aux voyageurs assoiffés ; un chien et deux vautours, que Roberts décrit comme des “ aigles blanc ”, occupés à se repaître du cadavre d’un dromadaire, interrompent à peine leur besogne à leur passage. D’Edfou, que Roberts pensait être le plus beau temple de l’Égypte, l’artiste a tiré plusieurs vues car, ainsi qu’il le notait, “ il n’atteint pas l’immensité de Karnak non plus qu’il est aussi bien préservé que Dendara mais il possède ce que les autres n’ont pas : de tout point d’où on peut l’observer, c’est une image ” (J. 26 oct.) Roberts et le capitaine Nelley traversent les champs de doura (sorgho) au moment où ils agitent leurs panicules chargés de graines, quand soudain le temple surgit, majestueux, au-dessus de la plaine. Dans le temple d’Edfou. Ancienne Apollinopolis. Haute-Égypte, on ne peut qu’être frappé, à la vue de l’immense sanctuaire ptolémaïque jadis consacré à une émanation de la divinité nommée Horus-behedety, par les débordements du kôm sis au premier plan, où s’élevait l’ancienne Apollinopolis magna des Égypto-Grecs, installée sur la rive gauche du Nil, dans un terroir qui, aux dires des textes gravés sur les parois du temple, passait pour un des plus riches d’Égypte. Les maisons s’entassant sur le pronaos et le sanctuaire du temple sont une des marques distinctives des villages de Haute-Égypte, en général bâtis sur les édifices anciens. Il n’est pas un lieu-dit, habituellement désigné dans la topographie par le vocable kôm (du grec kômè “ village ”) qui ne recèle, dans ses entrailles, les vestiges d’une chapelle dédiée à une émanation locale de la divinité. Ici, comme à Dendara ou à Louqsor, le cas est limite, et le temple majeur reste debout, splendide, au milieu d’un amas de ruines byzantines et coptes, romaines, grecques et pharaoniques. Le sable a lentement enseveli la cour sous un manteau de couleur ocrée. Le groupe de janissaires ou de villageois armés de lances au premier plan donne à peine l’échelle quand on sait que le pylône, qui atteint trente-six mètres de haut, est le plus élevé de tous les temples d’Égypte. Les images des “ dieux ” et des rois anonymes de l’antiquité veillent sur cet humble village dont l’exiguité tranche d’avec les proportions grandioses du sanctuaire tardif le mieux conservé de toute l’Égypte et les dimensions de l’ancienne Apollinopolis. Roberts, sur le chemin du retour, passe trois jours entiers à peindre différentes vues de ce temple qui, après l’austère Nubie, le délasse ainsi que l’équipage occupé à jeûner au moment du ramadan. Son journal tente d’évoquer les violents contrastes entre ce monument et l’atmosphère du village dont les maisons occupent les moindres espaces, le tout dans l’ambiance du chant des coqs et des cris des enfants, tandis que le fond du monument est inaccessible du fait qu’il est rempli jusqu’au plafond. Pendant deux jours, alors qu’il n’y avait pas un souffle de vent, Roberts doit attendre l’approche du soir pour échapper à la fournaise d’Edfou, et s’installer afin de réaliser ce qui reste un modèle du genre.
Jamais plus dessinateur ne pourra, du fond du pronaos, exécuter une vue telle que l’a dessinée Roberts : vue prise de sous le portique du temple d’Edfou. Haute-Égypte. La lithographie se prête ici parfaitement à l’effet vaporeux désiré par l’artiste afin d’accentuer la romantisme qui émane de ce temple, dont le pronaos, aux heures chaudes de la journée, abrite la compagnie de David Roberts. Les personnages sont vêtus à la mode du temps de Méhémet ‘Alî et coiffés, pour certains, du bonnet grec, le futur tarbouch, à l’imitation d’Ibrahim Pacha, original qui institua le port de vêtements adaptés aux saisons. Les personnages sont installés sur les abaques des colonnes encadrant le passage entre la cour et l’hypostyle, dominées par les myriades d’ombelles de papyrus. Des maisons du village, masses blanchies à la chaux, s’accrochent au toit du péristyle de la cour. Dans l’échancrure de la porte entre les deux môles du pylône, décoré de tableaux où Pharaon dialogue, pour la sauvegarde du Double-Pays, avec les principales forces divines du lieu, se détachent les maisons du village de l’extérieur. Le carton à dessins et la valise en osier du peintre trônent près du groupe de personnages de droite, saisis dans une discussion animée réunissant des habitants du village. Tout, dans cette image, tend à la fois à rendre le mouvement des êtres, pris dans l’accomplissement d’un geste, et à accentuer la passivité d’une architecture grandiose, pourtant acteur essentiel. Observant la ligne d’horizon du pylône, les ouvertures qui éclairaient les chambres ménagées dans son épaisseur, entretiennent le souvenir de la mort de plusieurs soldats du corps d’armée de l’Expédition d’Égypte, commandé par le général Desaix, lors d’une escarmouche qui opposa le général aux troupes de Mourad Bey. Du même angle, Roberts tire une autre vue peinte datée de 1840 et appartenant à une collection particulière, où l’artiste a multiplié les personnages, Turcs et janissaires armés jusqu’aux dents.
David Roberts exécute, en date du 23 novembre 1838, une vue particulièrement saisissante, intitulée portique du temple d’Edfou. Haute-Égypte, mettant en relief les maisons et les pigeonniers sommant le toit de l’hypostyle. Le lendemain il reproduit ce même portique sous un angle différent, la vue reproduite ici : Edfou. 24 nov. 1838 (p. 61). Roberts a d’ailleurs confié ses impressions à son journal soulignant un attachement particulier au pronaos : “ La façade du pronaos est de la forme la plus exquise, et le fait que les chapiteaux soient tous de forme différente, loin de nuire à sa beauté, à mon sens, ne fait que l’exalter. Une colonnade entoure tout le dromos ; chaque fût en est différent, et bien que l’ensemble ait été défiguré et mutilé, il reste, même en ce état, de toute beauté. ” (J. 26 oct.) Envers du décor précédent, dans un ciel ou la poussière diffracte la lumière, le pronaos est envahi par les sables éoliens accumulés dans ses entrailles et qui ne livrent plus des textes et du temple que le dernier tiers. Sur l’abaque, indifférent aux hiéroglyphes monumentaux qui l’entourent, un homme vêtu d’un costume turc s’abîme dans la contemplation du paysage qui s’offre devant lui tandis que deux personnages s’apprêtent, en devisant, à gagner l’abri sous les papyrus et les palmiers fructescents de pierre. Les maisons qui surmontent le toit apparaissent déjà comme les ruines d’un ancien village abritant les habitants contre les attaques de l’extérieur. La fusion de la brique moderne et des blocs de pierre de l’antiquité offrent ici l’image saisissante de plusieurs mondes qui se superposent.
Mettant à la voile le 27 octobre, même si Roberts note que “ c’est à peine s’il y a aujourd’hui un souffle d’air ”, le groupe quitte le rivage d’Edfou et poursuit son chemin vers le sud. Voguant sur le Nil, dérangeant à peine les crocodiles vautrés placidement au soleil sur le sable des berges, et rencontrant ça et là des huppes ou des ibis arpentant les rives à la recherche de nourriture, le groupe formé par Roberts et ses compagnons atteint bientôt Gebel Silsila ou “ Montagne de la Chaîne ”, car le Nil rencontre là un verrou rocheux rendant impossible son accès par voie de terre. Le Gebel Silsila, dans Hager Silsilis, est une de ces vues dépravées qu’affectionne l’artiste, où il convient de jouer avec les effets afin d’obtenir un résultat spectaculaire. Là où la photo ne pourrait l’y autoriser, Roberts s’offre quelques libertés avec le soleil couchant afin de mieux mettre en valeur la voilure et l’ombre portée des voiles ferlées des felouques, tendues par le vent du nord. Ici, rien d’archéologique mais la simple vie des riverains du Nil campés dans leurs activités quotidiennes. Les paysans musculeux manient les vergues de leurs élévateurs d’eau au niveau supérieur. Un felouquier, à droite, manœuvre une embarcation dans laquelle prend place un groupe d’hommes et de femmes. Au loin, la chaîne montagneuse rappelle l’existence des carrières de grès d’où furent extraits la majeure partie des blocs qui servirent à construire les sanctuaires thébains à partir de la XVIIIe dynastie (Nouvel Empire) et de l’époque ptolémaïque. Le rocher en forme de champignon, sur la gauche, et auquel la tradition attachait la “ Chaîne ” (silsila) barrant le fleuve, marque le site des carrières de l’ouest, de la ville ancienne et du sanctuaire rupestre d’Horemheb. La vue représente un exercice de composition soutenu, mettant en relief les lignes de fuite vers l’horizon où la leçon de Claude Lorrain est parfaitement assimilée.
Le séjour au Gebel Silsila est l’occasion d’un épisode comique. Au moment où ils s’y attendent le moins, le vapeur du Pacha remonte le cours du Nil à la stupéfaction de la population qui n’avait jamais vu un bateau propulsé par un moyen mécanique. Malgré tous les efforts déployés par Roberts et ses compagnons, habillés pour la circonstance et montés à bord du navire bondé, le Pacha ne daigne pas apparaître ; au moment où il ordonne le départ, pressé de rejoindre Assouan, tous sont obligés de quitter précipitamment le navire, perdant toute contenance.
D’après son journal de voyage, Roberts atteint Kôm Ombo, le 28 octobre à neuf heures du matin. A ses yeux, l’approche de ce sanctuaire, malgré une intense chaleur, est la plus belle de celles auxquelles il avait été confronté. Lorsque l’artiste l’aperçoit, le temple ressemble à un bouquet d’arbres pétrifiés émergeant d’une dune : “ Le temple est à demi-enterré par les sables du désert et, si j’en crois le témoognage des voyageurs qui m’ont précédé, il s’y est encore beaucoup enfoncé au cours des vingt dernières années ” (J. 28 oct.) Détruit dans sa majeure partie, le pittoresque s’attache à la partie restante du pronaos. Cela ne dérange pas Roberts qui, lorsqu’il y revient, le 21 novembre, en dessine plusieurs vues sous une chaleur de plomb : “ J’ai fait deux dessins, un du portique, un autre regardant les pylônes par le dromos. Pour le premier, j’ai été obligé de m’asseoir au soleil, sous mon ombrelle, alors que la température avoisinait aujourd’hui les cent degrés f. (40°c.) à l’ombre. J’ai peur d’avoir bien mal travaillé. Dieu fasse que le résultat ne soit pas trop mauvais ; mais le portique est tellement beau en lui-même que je n’ai pas pu y résister ” (J. 23 nov.) La vue présentée ici — Kôm-Ombo. 21 nov. 1838 —, est la plus surprenante ; elle représente l’entrée double et vivement colorée du sanctuaire, dédié à deux manifestations complémentaires du divin, crocodile et faucon — Soukhos et Haroéris —, et offrait, aux yeux des voyageurs du début du XIXe siècle un effet insolite, tant il avait servi de carrière depuis l’antiquité et constituait un superbe enchevêtrement d’architraves et de colonnes affaissées, noyées dans son épais manteau de sable éolien. Démantelé, ce sanctuaire, dont les textes expriment à la fois une théologie double et complexe, est noyé dans une lumière de soir de tempête, alors que le ciel s’obscurcit : “ L’entrée d’un pylône, ou plutôt d’un portail rappelant ceux de Karnak est tout ce qui reste debout… Les couleurs du globe ailé, la décoration invariable du plafond, sont encore en excellent état ” (J. 28 oct.) De petits personnages, dont les deux marins nubiens de Roberts, marquent l’échelle tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’édifice lézardé, dont les blocs seraient prêts à se détacher à la moindre secousse sismique. Par cette vue, David Roberts exécute une véritable nature morte montrant la fragilité du temps et de l’existence, dans un Orient désabusé laissant libre cours à l’imagination et à la rêverie. Roberts aurait certainement été encore plus frappé par le fait que non loin se trouvait une nécropole de crocodiles sacrés momifiés, le site de Kôm Ombo étant un des endroits d’Égypte où ces sauriens pullulaient. Dans son journal, Roberts écrit : “ Je réalisai de cette glorieuse ruine deux croquis colorés et, dans l’après-midi, ayant posé ma palette, exécutai une étude à l’huile de l’ensemble au coucher du soleil. Avec succès pourrais-je dire ! car l’effet du soleil levant et du soleil couchant sont tellement splendides, mais que cette transition est si rapide qu’il est presqu’impossible d’en transmettre sur des esquisses une idée juste ” (J. 23 nov. 1838).
Quittant Kôm Ombo le 27 octobre, Roberts parvient à Assouan, le lendemain. Abordée si péniblement par le corps expéditionnaire commandé par le général Desaix, Vivant Denon, après la traversée d’un désert, découvre, à Éléphantine, une vision paradisiaque : “ A Éléphantine, la culture, les arbres, les végétations, les habitations, offrent déjà l’image de la nature perfectionnée ; c’est sans doute ce qui a fait donner en arabe le nom Qeziret-êl-Sag ou d’Isle fleurie. Je fis un dessin de ce pays, qu’il faudrait peindre, et dont je puis offrir qu’une carte à vol d’oiseau ”. Depuis toujours, Assouan et Éléphantine offrent la nature pittoresque des lieux à tous les peintres de passage. La vue générale d’Assouan et de l’île d’Éléphantine (p. 67) peut être considérée comme une des vues-phares du recueil où Roberts a déployé tout le génie de sa palette.
En aval de la première cataracte se trouvent en effet l’île d’Éléphantine et la ville d’Assouan, anciennement nommée par les Grecs Syène. Voiles carguées sur leurs habitacles, trois canges, au-dessus de deux desquelles flotte le pavillon égyptien rouge et or, ont jeté l’ancre, à proximité d’une petite île, à peu de distance de la vieille ville d’Éléphantine qui surmonte le Nil à gauche et la vieille ville de Syène dont on aperçoit les fortifications à droite. Elles s’apprêtent à redescendre le fleuve, mues par le simple courant ou bien attendent de passer la première cataracte. Fidèle à son habitude Roberts ménage une ligne de fuite donnant de la profondeur à son dessin ou l’impression et la lumière, qui vient du fond, domine, laissant dans l’ombre le paysage archéologique, l’essentiel étant cette flottille où les personnages se préparent pour affronter la soirée. Quelques bouquets de palmiers, à droite et à gauche, égayent ce paysage minéral aux rochers grisâtres noircis, dans leur partie basse, par la montée des eaux de la crue. Un village de tentes, à gauche, sur une petite île, où s’entretient un groupe de personnages dont des janissaires, émerge des quelques palmiers, abritant sans doute la suite du Pacha. En revanche, pas l’ombre d’une vie dans les ruines abandonnées à leur seul rôle de décor. Seul un marabout blanchi à la chaux, à flanc de colline, à droite, constitue une lointaine réminiscence de la présence humaine.
Roberts est frappé, pendant son séjour à Assouan, par le commerce des esclaves qui y est pratiqué, puisque cette ville, au-delà de la cataracte, accueille un trafic en provenance du Soudan qui ne prendra oficiellement fin qu’en 1860, sous le règne de Saïd Pacha. Ce commerce marque alors la conquête du Soudan, d’où l’Égypte tire une partie de ses revenus. Le peintre et ses compagnons attendent là de pouvoir franchir la cataracte que tente de remonter infructueusement Méhémet ‘Alî avec son vapeur, après, ainsi que le peintre le note dans son carnet, avoir trouvé le moyen de faire pendre un infortuné découvert avec une coupe lui appartenant. Attendant leur tour de franchir ce passage difficile, à l’aide des reïs de la cataracte, Roberts et le capitaine Nelley louent des ânes afin d’aller voir la “ Perle de l’Égypte ”.
Le 30 octobre, Roberts et le groupe qui l’accompagne passent les carrières de granit d’Assouan, traversent le petit désert d’Assouan longeant la cataracte et qu’empruntent les marchandises venant de Nubie et débouche à El-Mahatta, où les produits nubiens étaient débarqués. Ils apprennent alors que le Pacha, dont ils sont les débiteurs en vertu du firman reçu, poursuit sa route vers le Sud, monté sur un bateau plus petit, et que ce dernier a ordonné au Bey d’apporter aide et assistance à la compagnie du peintre afin de franchir sans encombre les écueils de la cataracte, tandis que leurs bagages seront transportés par chameau. Il faut dire que le franchissement de la première cataracte est alors l’affaire des reïs de la cataracte qui, de père en fils, avaient pour fonction de diriger la manœuvre dans les flots houleux d’un chenal où cette opération délicate, en raison d’une profondeur suffisante de ses eaux, pouvait être menée. Roberts décrira, le 1er novembre 1838, la progression des trois canges, allégées de leur contenu, tractées à la ridelle par soixante hommes. En attendant, Roberts se résoud à effectuer la traversée du bras du Nil afin de voir l’île : “ … nous fîmes la traversée jusqu’à l’île de Philæ où je me passionnai pour la beauté des ruines que je savais y trouver en abondance. Tout l’espace intermédiaire qui n’est pas couvert des restes du temple porte les débris éparpillés de l’ancienne ville ” (J. 30 oct.) De retour de Nubie, il se passionne pour ce haut-lieu du paganisme dont il produit un portrait décliné en diverses facettes montrant le site dans toute sa splendeur. Il plante son trépied dans l’île de Bigga, surmontant Philæ, d’où il réalise la vue générale de l’île de Philæ. 18 nov. 1838 (p. 69). Philæ, exposée dans toute son étendue, est sans doute l’une des vues les plus prestigieuses ayant fait école du recueil sur l’Égypte de David Roberts ; elle marque un des principaux jalons de la diffusion d’une image de l’île passant pour classique, avant que s’impose la photographie. On peut dire que l’artiste, en déployant tout le luxe de la palette, a donné de cette île le statut qu’elle mérite : “ Ses ruines, même vues de loin, sont les plus pittoresques que j’ai jamais vues ; sans doute cela est-il dû aux rochers nus et élevés dont elle est entourée. ”
C’est dans ce temple majestueux que Nubiens et Égyptiens, réunis dans un hommage commun, fêtaient le retour de la Lointaine, lionne féroce assimilée à l’inondation. Des processions fluviales auxquelles la statue de la déesse prenait part se rendaient dans es sanctuaires nubiens afin de visiter les hôtes divins, pour la plupart acteurs de la grande mise en scène annuelle qui aboutissait au retour, sous la forme d’un félin apaisé, de Tefnout-Sakhmis, adoré à Bubastis, à l’est du Delta, sous l’aspect d’une chatte. Noyée annuellement par l’inondation, les couches de limon s’accumulent sur son sol qui abrite le village divin témoin, au VIe siècle de notre ère, sous le règne de l’empereur Justinien, des luttes farouches entre les partisans de la nouvelle religion d’État — le christianisme — et les derniers tenants des cultes traditionnels : les nomades blemmyes qui, chaque année, venaient en barque, à la suite d’un accord passé avec le pouvoir byzantin, chercher la statue de culte de leur patronne Isis afin de lui rendre hommage. Ce fut là le siège d’un massacre qui mit fin, en Nubie, aux dernières manifestations officielles du paganisme. D’une froide blancheur, les monuments de l’île, dont le temple majeur dédié à Isis, se profilent sur la rive est, sombre désert arpenté par les caravanes allant d’El-Mahatta à Asouan afin d’éviter le risque encouru dans la première cataracte. L’accent est porté sur l’aspect des monuments, sans autre connotation historique qu’accidentelle. Les ruines de Philæ gisent comme une pierre tombale affaissée et ne sont autre que le décor d’une impressionnante scénographie, où si les proportions et l’architecture sont parfaitement respectées, la lumière et les fonds, en revanche, ont été adaptés afin d’en tirer le meilleur parti.
Au premier plan ont été regroupés les personnages dont certains assis à l’ombre de colonnes. Les bouquets de palmiers contribuent à renforcer l’image d’un paysage où il n’y a de végétation que le strict nécessaire. C’est très curieusement sur cette île — Bigga —, à l’intérieur de ce que les Grecs nommaient Abaton, un des nombreux cénotaphes construit pour abriter une des reliques d’Osiris (ici la Jambe), que Roberts a choisi de regrouper ses personnages, alors que les prescriptions de jadis n’y autorisaient aucune manifestation bruyante, afin que l’expression du divin endormie en ces lieux n’y fût pas dérangée. Roberts donne de cette pseudo-tombe reposant aujourd’hui sous les eaux du lac Nasser une des vues les plus étonnantes de tous les paysages romantiques égyptiens, là où les dessinateurs de l’Expédition d’Égypte n’imaginent qu’un édifice secondaire. Dessinée lors des basses eaux, l’île de Philæ, aux murs marqués par le niveau supérieur de la crue, paraît beaucoup plus basse que le point d’où la vue est prise. Il s’agit là d’un des effets spéciaux de David Roberts qui augmente ainsi l’effet de perspective entre la ligne qui conduit entre l’axe marqué par l’entrée et l’arche de l’Abaton et le premier pylône du grand temple d’Isis.

Assez éloignés de centres urbains importants, le village divin de l’île de Philæ, “ île de la Fin ”, a conservé une très grande part de ses superstructures même si les habitations des desservants des cultes d’Isis, d’Onouris, de Tefnout, et d’Hathor, construites en brique crue, ont disparu. Le peintre, ayant planté son chevalet sur le rebord du débarcadère sud par lequel, jadis, les Blemmyes emportaient la statue de pèlerinage d’Isis, saisit la vue de l’esplanade du temple bordée des deux colonnades est et ouest : grande approche du temple de Philæ, Nubie. Le petit kiosque débarcadère sud présente d’élégants chapiteaux hathoriques que peut lui envier le kiosque de Trajan, à droite. Les colonnes de ce kiosque se trouvent à terre, au premier plan. Fidèle à ses principes, Roberts inscrit au centre du kiosque un groupe de trois personnages occupés à bavarder. D’autres silhouettes ont gagné l’angle sud-ouest de la colonnade de droite. Au fond, majestueux, émerge le pylône du grand temple d’Isis et sa perspective désaxée qui ne montre du second pylône que le môle ouest. Le jeu des ombres et les traces d’humidité sur le sol limoneux de la cour diapré, après la crue, d’un parterre de fleurs, permet à l’artiste d’accentuer l’effet de profondeur, au moment où, au matin, les ombres s’étirent et attirent le regard du spectateur vers le fond, à droite, d’où jaillit la lumière.

La première découverte de Roberts, le 30 octobre, est le kiosque de Trajan devant lequel il s’extasie : “ … c’est au milieu de ce chaos que nous progressâmes, non sans difficulté, jusqu’à un temple carré qui s’élève au sud de l’île. Il est resté inachevé, avec des chapiteaux en forme de lotus simplement ébauchés. L’ensemble donne l’impression que maçons et tailleurs de pierre viennent de quitter le chantier. Il est bâti en un grès si léger et aux détails si délicats et aigus que j’arrivais pas à concevoir que je contemplais une ruine vieille de deux mille ans. ” (J. 30 oct.) Le lendemain, la première cataracte franchie, les trois canges de Roberts et de ses compagnons jettent l’ancre à proximité dudit kiosque. A l’émerveillement qui s’ensuit sont dues plusieurs vues du monument que la tradition des voyageurs affublaient du nom de “ Lit de Pharaon ”. La vue principale de l’édifice s’intitule : le temple hypèthre de Philæ appelé “ Lit de Pharaon ”. Dans les lueurs dorées du soir, les colonnes du kiosque paraissent inachevées. Les traits les plus forts du dessin portent encore sur l’aspect anecdotique des deux canges dont les voiles ont été affalées sur le pont. Sur les cabines, l’agitation fait presque oublier la présence de ce monument, mis en valeur par un écrin de végétation formé de quatre palmiers et de ce qui semble être des acacias. La composition, parfaite, équilibrant d’une part la vie moderne — les canges et ses occupants — et, d’autre part, un monument considéré, à l’époque de Roberts, comme une perfection de l’art égyptien, justifie la réputation de l’artiste qui joue avec les valeurs et les tonalités. L’effet recherché est déjà l’impression et non la réalité archéologique restant œuvre de géomètre ou d’architecte. Alors que l’île scintille sous les derniers feux du soleil couchant, les uns et les autres regagnent les embarcations ou bien conversent tranquillement tandis que deux personnages, revêtus du costume turc, marquent discrètement les proportions du monument même qui, dans un flou vaporeux, semble passer, au propre et au figuré, au second plan. Profitant du séjour de Vanderhorst affublé du sobriquet de Pickwick, dans l’île, Roberts réalise à l’aquarelle, alors que les trois canges sont à l’encrage, un autre aspect semblable du “ Lit de Pharaon ”, vu en direction du sud-ouest, actuellement dans une collection particulière.

Vue de l'île de Philae, temple d'Isis et Kiosk de Trajan, Nubie. © Wikimedia Commons
De sa palette émanent des teintes pastel qui donnent à une autre aquarelle du site prise du Nil, au nord, un effet vaporeux d’où surgissent, comme dans un décor, le kiosque de Trajan et le premier pylône du grand temple d’Isis, équilibrés par les voiles de felouques qui se reflètent dans l’eau du fleuve. Dominée par les masses grisâtres du sud-ouest, l’île de Philæ marquée au nord-est par la présence du kiosque de Trajan complète cette série qui donne de l’île une approche quasi photographique à distances différentes. Une cange au premier plan, dans l’axe duquel se dresse un palmier, les masses décalées des premier et second pylônes du temple d’Isis, un fourré de plantes aquatiques, le tout centré et entouré d’un halo de brume, voilà le portrait d’identité d’une île ayant fait rêver les Anglais épris de lumière et de liberté.
Il est, dans l’œuvre des védustistes passant par la vallée du Nil, des monuments de référence, car ils représentent des pierres de touche auxquels tout bon peintre doit être confronté. La cour hypostyle du grand temple d’Isis appartient à celles-là, car elle fit l’objet d’une des premières vues en couleur connues : “ la vue perspective coloriée, prise sous le portique du grand temple ” et œuvre de Le Père. Il y a, entre Le Père et Roberts, une différence fondamentale qui tient au fait que la première, un peu froide, fait l’objet d’une restitution avec des personnages vêtus de façon néo-classique, tandis que la second apparaît comme un véritable état des lieux. Aujourd’hui où les murs de Philæ ont perdu les couleurs qui les rendaient, jadis, efficients devant le divin, les vues de cette partie du sanctuaire d’Isis passent presque pour surnaturelles tant elles sont vives et traduisent l’émerveillement de la nature des anciens Égyptiens. Les colonnes en forme de bouquets de papyrus, de lotus et de palmiers sont autant d’éléments de la nature transposés dans la pierre, et destinés à suggérer les effets bénéfiques de la crue qui émergeait, d’après les textes anciens, de l’île de Bigga. Dans cette cour hypostyle, où architraves, linteaux brisés gisent à terre, les personnages destinés à animer ce haut-lieu de la vie liturgique égyptienne prennent la pose sans passion. On surprend comme une sorte de gêne parmi les personnages, dont certains, à gauche et à droite, marquent l’emplacement des croix coptes rappelant qu’autrefois le grand temple d’Isis fut transformé en église. Vers le fond, avançant peu à peu dans la pénombre qui augmente l’intensité du mystère divin, on devine le sanctuaire, antre d’une grande déesse-mère.
La vue de la cour est complétée par plusieurs autres qui montrent les portiques, de la même façon que la salle hypostyle de Karnak, sous des angles divers (p. 84). Les croix, inscrites dans des cercles, soulignent la présence du christianisme triomphant là où défilaient les processions des prêtres portant la barque sacrée d’Isis.
Fidèle à l’optique d’un l’inventaire aquarellé des lieux qu’il traverse, il immortalise l’île de Bigga d’où il a déjà effectué la grande vue de l’île. On ne peut imaginer perspective plus sophistiquée que celle de l’arche de l’église construite sur les ruines mêmes de l’Abaton de Philæ, à l’avant de laquelle Roberts a représenté l’entrée de ce monument. Sur les basses branches d’un arbre à peine suggéré, sont posés des échassiers blancs que les habitants nomment aboukardan mais qui peuvent également se révéler des trochyles du Nil, seul habilités à venir débarrasser les dents des crocodiles du Nil des débris de nourriture qui leur causent des abcès. A l’arrière-plan, simplement suggérée, transparaît la masse du temple d’Isis.
Avec la Nubie, le rythme s’accélère, car les proportions des temples, dans ces contrées, diminuent, du moins pour la majorité d’entre eux. Ce ne sont plus les amples compositions de la vallée du Nil à partir d’Assouan, mais des temples sur ciels bistres, chargés de poussière, dans lesquels ils se fondent. En progressant sur le cours du Nil, Roberts apprend à connaître les Nubiens dont deux font partie de l’équipage des huit marins de son bord. Le peintre ne reste pas insensible aux malheurs de la population, tour à tour l’objet de convoitise des trafiquants d’esclaves ou sujets à la conscription forcée. Aucun temple n’échappe à sa vigilance, non plus que les scènes de la vie quotidienne. Il traverse le jardin nubien, ordonné et soigné, tranchant par rapport au désert proche : “ Collines et rochers sont de couleur sombre et, depuis la rivière, produisent le même effet que mes collines natales ; stériles et nues, elles ne donnent cependant pas cette impression de loin, alors que les rives du fleuve et les vallées abondent de palmiers-dattiers, de figuiers et d’acacias, et que chaque parcelle de terre est couverte de végétation ; les rives qu’inonde régulièrement le Nil sont de parfaits jardins. ” (J. 2 nov.). En Nubie, Roberts se mue en ethnologue et son œil attentif ne manque aucun des faits auxquels il assiste : les noces, les enterrements. Il est frappé par la beauté de ses habitants, pratiquement nus, “ bien faits, gracieux, ouverts et intelligents et leurs dents comme de l’ivoire ”. Les femmes, au corps revêtu de beurre afin de se protéger du soleil et de la vermine, lui seraient même désirables si l’odeur du beurre rance ou les fortes fragances de l’huile de ricin, dont elles imprégnaient leur chevelure à l’égyptienne, n’avait prévenu en lui tout instinct. La petite troupe rencontre d’abord Dabôd, sur la rive gauche, où il croise un trafiquant d’esclaves abyssins se reposant près du temple, précédé de ses trois propylônes. Roberts profite de l’occasion de visiter le délicieux petit kiosque d’Hadrien à Kertassi dominant le Nil dont il donne deux vues spécifiques, intitulées Ruines du temple de Qertassi, Nubie, et Temple de Ouâdi Qertassi, Nubie, en contreplongée. Il utilise ce kiosque aux magnifique colonnes à chapiteaux hathoriques pour exécuter une aquarelle représentant des Bicharîn en costume traditionnel, armés de lances, d’épées et de boucliers. Il en profite également pour acquérir de nombreuses pièces ethnologiques nubiennes, et, le soir venu, lorsque la fraîcheur se fait à nouveau sentir sur le Nil, de lire des ouvrages ramenant son esprit vers l’Europe.
Après avoir visité le temple de Taffa déjà démantelé, lui permettant de peindre le Temple de Taffa en Nubie. 16 nov. 1838, l’artiste aborde à Kalabcha le 3 novembre au matin, dont il tire le charmant paysage des temples de Kalabcha, nov. 1838, traité dans des tons pastels. Plus qu’un temple, c’est une atmosphère qui se dégage : les monuments semblent comme émerger d’un vieil album de photographies sépia adoucies par le temps. L’ancienne Talmis était le siège d’une garnison romaine en Basse-Nubie, comme le signalent les maints vestiges de cette époque sur le site urbain établi à proximité. A l’intérieur et à l’extérieur du temple et de son enceinte, à la charnière du passé et du présent, vit la population du village dont les maisons s’étagent au nord, afin d’échapper au khamsin, le vent brûlant du sud, et dont certaines somment le pylône et le toit du sanctuaire, comme à Médinet-Habou et à Edfou. Le débarcadère pharaonique accueille le visiteur avec son jardin planté de quelques palmiers, tandis que quelques habitants se rendent auprès du Nil. Dans le ciel, un vol d’oiseaux migrateurs rappelle que l’Égypte est le couloir de l’Afrique permettant aux espèces de gagner l’Europe.
Pénétrant à l’intérieur de l’enceinte du temple de Kalabcha dédié à Amon, à Mout et à une force divine lunaire locale, Mandoulis, qui joue le rôle du Khonsou de Karnak, on entre dans une de ces villes de Nubie dont les habitants doivent encore faire face à des attaques provenant du désert. Quoique de dimensions plus modestes, il rappelait le sanctuaire d’Edfou. C’est dans ce temple que Champollion découvre, le 27 janvier 1829, la nature universelle d’Amon dans la lettre qu’il expédie d’El-Mélissah à Champollion-Figeac, le 10 février 1829 :
C’est ici que j’ai découvert une nouvelle génération de dieux, et qui complète le cercle des formes d’Amon, point de départ et point de réunion de toutes les essences divines. Amon-Ra, l’être suprême et primordial, étant son propre père, est qualifié de mari de sa mère (la déesse Mouth), sa portion féminine renfermée en sa propre essence à la fois mâle et femelle : tous les autres dieux égyptiens ne sont que des formes de ses deux principes constituants considérés sous différents rapports pris isolément. Ce ne sont que de pures abstractions du grand Etre.
On est loin, dans l’œuvre de David Roberts, de cette découverte théologique majeure. Ici, seule est rendue une ruine atone, privée de couleurs en raison des débordements successifs du Nil qui a marqué de son empreinte la base du pronaos et recouvert la cour d’une couche de limon. Le pittoresque des ruines frappe l’imagination, d’autant que la couverture du pronaos s’étant écroulée, elle entraîna dans sa chute les maisons qui s’amoncelaient sur le toit et dont les vestiges sont regroupés à l’arrière et sur la cella. Le lieu témoigne, comme Philæ, des ultimes convulsions du paganisme. Silko, roi des Nobades converti au christianisme, se vante, dans un décret, gravé vers 550 en méroïtique et en grec sur deux colonnes de l’entrée, d’avoir défait les Blemmyes qui vouaient un culte aux idoles. L’intérieur du temple de Talmis, ville principale du Dodécaschène (nom grec de la Basse-Nubie), avait, dès le IVe siècle, été transformé en église et l’on voit encore deux ouvertures pratiquées de part et d’autre de l’entrée principale associées à cette église primitive.
Roberts quitte l’accueillant temple de Kalabcha et son jardin suspendu au-dessus du Nil pour Dendour, autre petit temple dans un écrin de montagnes, dont le plafond était encore délicatement coloré, puis ce dernier pour Gerf Hussein, également nommé Gircheh. La chaleur, à partir du 5 novembre, monte et le thermomètre enregistre des maxima. La Nubie capte davantage le peintre par ses teintes féériques ; il trouve son compte dans sa lumière : “ Nous eûmes droit, ce soir, à un véritable coucher de soleil africain. Avec les nuages incendiés se reflétant dans l’eau comme s’ils s’y trouvaient, les langues de sable s’étirant à l’assaut des montagnes parfois jusqu’à mi-pente, et de l’autre côté des hauteurs dominées par les ruines désolées de l’ancienne ville, on avait un paysage qui eut ravi Turner ” (J. 5 nov.) Le sanctuaire rupestre de Gerf Hussein (non loin du village de Gircheh, sur l’autre rive), aujourd’hui disparu sous les eaux du barrage, avait de quoi séduire bien des voyageurs, car ces hémi-spéos présentaient la particularité d’être taillés à même le roc des falaises, les sculptures en ronde bosse et les reliefs étant réservés dans la pierre. Découvert au début du XVIIIe siècle, ce temple, dédié à Ptah, Taténen et Hathor, fut entrepris sous le mandat de Sétaou, vice-roi de Kouch. La scénographie de Roberts est ici mise en évidence par la présence d’une source d’éclairage issue de derrière le pilier osiriaque de droite et qui illumine, au-delà de toute vraisemblance, les colosses portant un pagne et coiffés d’un pschent en face, tandis qu’un personnage, vêtu de bleu, sert d’échelle. Dans les travées latérales, creusées dans les parois, s’ouvraient huit niches dans lesquelles Ramsès II apparaissait aux côtés de forces divines nubiennes et égyptiennes. Vers le fond, une ouverture laissée dans l’ombre afin d’accroître le mystère, permettait d’accéder au dernier système de salles livrant accès au naos. Ce spéos, non seulement associé à la crue du fleuve, était aussi dû à la présence, au sud du site, d’un passage dangereux lorsque les eaux étaient basses. Ainsi ceux qui avaient pu franchir celle-ci sans encombre pouvaient-ils venir se recueillir devant la triade locale.
La vue de l’étroite silhouette du temple de Daqqa, voué au culte de Thot et précédé d’un unique pylône (14 novembre 1838). Le sanctuaire était jadis ceinturé d’un mur de protection. Daqqa, ancienne Pselchis des Grecs, rappelant que le nom antique de la ville était Per-Sereket “ la Demeure de Selkis ”. Au devant de ce bâtiment, fuyant vers la droite, se tient une famille de Barbarins, nom donné aux habitants de la Nubie, à l’époque de Roberts.
Passé le temple de Ouâdi Maharraqa, petit buisson de colonnes (il en livrera le portrait, le 14 nov. 1838), le peintre parvient à Ouâdi es-Seboua le 6 novembre après avoir visité le temple d’Amada. L’artiste et ses compagnons parcourent les ruines du temple construit par Ramsès II et auquel mène un dromos formé d’une double rangée de sphinx à têtes de lion qui lui vaut son nom. Le monument, comme le montre une vue prise de l’arrière, émerge des décombres. Il prend également soin de dépeindre le colosse de Ramsès II accueillant le visiteur à la naissance du dromos. A partir de Korosko, le 7 novembre, avant d’entrer dans le coude dit d’Amada où les bateaux doivent à la fois lutter contre la force du vent, qui vient du nord, et de celle du courant, les trois reïs font appel à une demi-douzaine d’hommes afin de tirer les embarcations et de franchir ce passage difficile. A la suite d’une accusation de vol, il s’ensuit une mêlée générale entre les hommes du village et l’équipage de Roberts dont un des membres, un des deux Nubiens est battu au point qu’il faut le remonter à bord inanimé. La petite troupe doit partir sous les quolibets et les jets de pierre des habitants du village. Après un jour et une nuit de navigation, ils arrivent en vue de Qasr Ibrim, en face d’Aniba, sitôt après avoir passé le temple de Derr.
Qasr Ibrim, la Primis de l’époque gréco-romaine, est une citadelle qui, du temps de Roberts, se dressait au-dessus d’un éperon rocheux dominant le Nil : “ A l’exception des anciens temples, c’est la première fois depuis le Caire que je rencontre une construction faite pour durer ; le long du Nil, toutes les villes sont bâties avec la boue du fleuve, ou en briques de cette même boue, séchées au soleil ce qui, vu de loin, revient au même ; et dans tout autre pays que l’Égypte, elles ne tiendraient pas plus longtemps que la boue elle-même. Cette forteresse, au contraire, se rapproche davantage par sa situation comme par la régularité de sa forme de celles que j’ai vues en Espagne, construites par les musulmans ; elle s’élève à l’aplomb du précipice et est flanquée, à intervalles réguliers, de tours en pierres carrées ou en moellons. L’ensemble est dans un état de dégradation des plus avancés et, je crois, totalement déserté ” (J. 8 nov.) Elle passait pour commander la Nubie et avait été dotée, au XVIe siècle, par le sultan Sélim Ier, d’une garnison bosniaque. Ibrahim Pacha, fils de Méhémet ‘Alî, avait dû abattre cette citadelle, en 1812, alors qu’elle servait de base-arrière aux forces mamelouques ayant échappé au massacre de la citadelle du Caire organisé une année plus tôt, en mars 1811. Méhémet ‘Alî avait, en effet, invité les chefs mamelouk à une fête ; dès que les infortunés entrèrent, les portes se refermèrent sur eux, et la tuerie commença, ne laissant qu’un seul survivant qui réussit à s’échapper à Saint-Jean d’Acre.
Comme au Gebel Silsila, à Elessîya, non loin d’Ibrim, des spéos ont été percés que l’on ne voit pas sur le dessin, mais qui furent réalisés sous les règnes de Thoutmôsis Ier, Thoutmôsis III, Aménophis II et Ramsès II. Telles les forteresses construites au Moyen Empire, qui autrefois jalonnaient la Nubie, prévenant les incursions des Nubiens le roc de Qasr Ibrim, occupant une position stratégique fondamentale, fut âprement disputée entre tous les pouvoirs, dans l’antiquité et à l’époque moderne. Attiré par la forme de la falaise d’Ibrim, Roberts profite de l’occasion pour donner une idée de la nature du paysage de Basse-Nubie et de sa rare végétation qui lui rappellent l’Espagne. L’habituelle ligne de fuite est tracée par la série de canges qui s’éloignent vers la droite dans l’ombre portée du rocher de Qasr Ibrim.
L’humble spectacle de la vie nubienne, avec les vaches venant s’abreuver directement au Nil, complète la vue précédente de Qasr Ibrim dans l’atmosphère saturée de chaleur, rendue par la lumière poussiéreuse dont on ignore la provenance. Les khors (vallées encaissées) s’enfoncent dans les falaises rocheuses, à gauche, tandis que le premier plan est occupé par ce qui semble être la cange de l’artiste, sur laquelle flotte le pavillon anglais tandis que le reïs de l’embarcation se tient sur le toit de l’habitacle et semble manœuvrer le gouvernail, au moment où les marins, perchés sur les vergues, affalent les voiles.
Roberts parvient devant les deux spéos d’Abou Simbel le 8 novembre 1838. Il reste seul devant ces deux monuments, tandis que ses compagnons, le 9, se rendent à Ouâdî-Halfa où s’achève le contrat passé avec les capitaines. Séparés par une coulée de sable nappant la falaise de grès nubien, les deux spéos d’Abou Simbel — l’Ibsamboul par les voyageurs du temps de Roberts —, ont été découverts par le Suisse Ludwig Johann Burkhardt, en 1813, puis ouverts, en dépit de moult difficultés, par Giambattista Belzoni, quelques années plus tard, entre 1816 et 1817. Ce dernier dut tour à tour employer la ruse, la menace afin de venir à bout des réticences des habitants du village d’Abou Simbel ne connaissant pas l’usage de la monnaie et n’appréciant que fort peu le travail manuel ; il lui fut surtout difficile de convaincre les cachefs locaux, à l’aide de présents, d’accorder leur autorisation. La surprise de la découverte dépassa l’imagination de Belzoni qui pénétra ainsi, après des siècles, dans le principal temple rupestre de Ramsès II en Nubie. Quand Champollion parvient sur les lieux, il est assailli par une crise de goutte, ce qui ne l’empêche pas de surveiller sur place les dessins qu’exécutent ses compagnons. Le grand temple offre l’aspect d’un temple traditionnel en négatif. Son pylône est précédé de quatre silhouettes de colosses assis entre lesquels se trouvent l’entrée, tandis que le temple rupestre de Nofertari “ pour l’amour de qui le soleil se lève ”, à droite, montre des formes divines se dégageant de la montagne. De la cange, amarrée sur le rivage, sont sortis les occupants qui se dirigent vers l’entrée du spéos.
On peut imaginer, en observant la vue de face du spéos principal, ainsi qu’une autre vue latérale prise dans un éclairage diffracté dans un souffle de poussière, les difficultés que rencontra le Titan de Padoue avant de pouvoir se glisser dans l’ouverture pratiquée par les habitants du village. Des quatre colosses assis, l’un a subi l’injure du temps et s’est effondré dans sa partie supérieure. Il est intéressant de constater que la vignette de la page de titre de l’édition Moon de 1846 reprend la partie centrale de cette lithographie. Elle est centrée sur l’entrée du grand temple dédié à plusieurs divinités, dont Ramsès II divinisé. Dans cette vignette, on ne devine qu’à peine les vestiges des colosses assis, aux traits du roi et dont une épaule porte le cartouche. Mais en revanche, l’attention de Roberts a été attirée par le hiéroglyphe monumental en haut-relief qu’accompagnent deux silhouettes du souverain présentant l’offrande de Maât, image de la sérénité et de l’harmonie. Sans le vouloir, Roberts insiste sur l’un des mythes les plus importants — sinon le plus important — de l’Égypte et de la Nubie réunies, puisque l’ensemble traduit, pour qui sait l’interpréter, le retour africain mythique de la Lointaine ramenée par le souverain auprès de son père Rê sous la forme d’un être humain à tête de faucon coiffé d’un disque solaire, lui-même composant le rébus du nom de couronnement de Ramsès : Ousermaâtrê. Ainsi, de ce temple-caverne, émergeait la crue du Nil, comme s’il se fût agi du gouffre d’où jaillissaient les eaux que garantissait la présence de la frêle silhouette accroupie placée sur une corbeille.
Pénétrant dans l’incroyable spéos (p. 86), rempli au tiers de sable, le voyageur apercevait huit colosses représentant Ramsès II sous l’aspect de souverains coiffés, au nord du pschent, et au sud de la couronne blanche, et vêtus d’un pagne comme à Gerf Hussein. Il s’agit là d’une des vues datées par erreur de 1836. Belzoni tout comme Champollion découvrent des scènes fascinantes dont le tableau le mieux conservé de la bataille de Qadech, scène présente sur la plupart des monuments de Ramsès II. Mais déjà l’irréparable a été commis, et Roberts peste avec virulence contre les voyageurs Yankee et les touristes qui n’hésitent pas à graver dans l’épaisseur du torse des colosses : “ Ils (les temples) doivent cet état au fait d’avoir été enterrés dans le sable qui s’est accumulé autour d’eux, et l’on se prend presque à souhaiter un nouvel assaut du désert à l’idée qu’avec l’invasion des voyageurs cokneys et yankees, ils ont toutes les chances d’être dégradés en quelques années. N’est-il pas scandaleux de voir ces glorieux témoignages de l’art, les plus anciens du monde, non seulement détruits par les chasseurs de reliques, mais défigurés par les noms gravés des Dupont, Smith et consorts ? ” (J. 9 nov.) Il eût été bien surpris de constater que, deux millénaires avant lui, les mercenaires cariens et lydiens, au moment de l’expédition punitive organisée par Psammétique Ier contre la Nubie, en avaient déjà fait tout autant.
Contrairement à la représentation de Gerf Hussein, Roberts a installé des torches dans le naos, dans lequel Ramsès II est présent en compagnie d’une triade. Par la froideur de leurs masses, David Roberts a su créer là une image irréelle en faisant entrer à flot la lumière, impossibilité eu égard à l’exiguité de l’entrée que Roberts a dû faire dégager. Au fond du naos, se tenaient les forces divines qui, au sud de Philæ, étaient susceptibles d’engendrer le mécanisme de la crue pour le bien éternel de l’Égypte, au moment du lever héliaque de Sirius : sous le pinceau de Roberts, éclairés par le flamboiement des torchères, apparaissent Ptah, Amon, Ramsès II divinisé et Rê-Harakhtès.
C’est à partir d’Abou Simbel, où abondent scorpions et serpents, le lundi 12 novembre, que Roberts, mettant le cap sur l’Égypte, tourne le dos à la Nubie, ses trois compagnons étant revenus sur leurs pas. Sur le chemin du retour, Roberts s’arrête à nouveau pour exécuter, en prenant son temps, les portraits des temples qu’il n’a fait que visiter. Le 17 novembre, il est enfin revenu à Philæ, alors que débute le ramadan, le 18. A partir de là, on perd la trace, dans le journal de Roberts, de ses trois compagnons, sans doute rentrés au Caire. Le 20, il passe la cataracte grâce à un des reïs d’Assouan, appréciant l’extrême précision avec laquelle celui-ci manœuvre dans les étroits chenaux. Le 20 décembre, non loin du Caire, il peut être fier : “ Le voyage a été dans l’ensemble extrêmement agréable et certainement de loin le plus intéressant que j’ai jamais accompli — mes dessins, me semble-t-il, non seulement sont bons, mais du plus grand intérêt, indépendamment du fait qu’ils sont de simples images. Je suis le premier artiste, au moins de nationalité anglaise, à avoir fait ce périple et cela est déjà beaucoup. ” Et il ajoute, avec une pointe d’ironie britannique : “ Je considère à l’heure actuelle que les travaux des Français ne donnent aucune idée de la splendeur de ces vestiges. ” (J. 20 déc.) A peine a-t-il effectué cette tâche qu’il pressent que le Caire lui apportera des vues d’un intérêt comparable : “ des sujets d’un autre genre mais d’un intérêt égal restent encore à traiter au Caire, autre domaine vierge à explorer. Si Dieu me conserve en bonne santé, il y a beaucoup à faire avec les splendides mosquées, les tombeaux des califes et des mamelouks ” (J. 20 déc.)

Grande salle hypostyle du Grand Temple d'Abu Simbel © Wikimedia Commons
Roberts arrive au Caire à la fin du ramadan, le soir du 21 décembre où, malheureusement, les portes sont fermées pour la nuit. Le lendemain, il loue une maison qui avait appartenu à Osman Effendi, nom de rénégat d’un certain Donald Thomson d’Inverness naguère au service de Sheikh Ibrahim, c’est-à-dire le Suisse Ludwig Johann Burckhardt. Roberts obtient une autorisation (firman) émanant du gouverneur du Caire, par le truchement du colonel Patrick Campbell, consul général d’Angleterre, afin de réaliser des aquarelles des mosquées de la ville à la condition expresse de revêtir le costume ottoman, ce dont il ne se fait pas prier, même si cela signifie pour lui de raser ses favoris ; de plus, il est accompagné, partout où il se rend, de deux janissaires. Il devenait ainsi le premier artiste à tracer le portait des mosquées cairotes. C’est dans ce costume qu’il apparaît, sous le pinceau de son compatriote Robert Scott Lauder dans le portrait de lui daté de 1840 et conservé à la Scottish National Portrait Gallery. Le port du costume mamelouk est en effet un shiboleth en Égypte, et il faut noter que les femmes de marque ne pouvaient paraître en présence du Vice-Roi que vêtues d’un costume d’homme ; certaines, comme l’aventurière Lady Stanhope, endossent ce vêtement.
Les plus grands monuments du Caire revivent sous ses pinceaux, dont il a abandonné l’usage selon le vœu du gouverneur du Caire de ceux faits en soies de porc afin de n’être pas frappé d’impureté. Le tombeau-mosquée de Qaïtbai (p. 89), restauré par Franz Pacha dans les années 1880, se dresse dans la “ Cité des Morts ”, la grande nécropole du Caire, à l’est de la ville, sous la silhouette massive du Moqqâtam. Construit en 1472, ce monument, avec son décor alternativement composé de lignes blanches et roses (pierre et brique), est, avec ses moucharabieh et sa coupole, sous laquelle repose le corps du calife, l’édifice qui caractérise le mieux l’architecture mamelouque avec la khânqâh du sultan Barkoûk. Sur le contrefort de la coupole, les armes de Qaïtbai se distinguent. Elle comprend, protégé par un claustra en bois, un sébîl, c’est-à-dire une fontaine où les habitants du quartier peuvent venir puiser de l’eau. Ces monuments sont en effet des fondations funéraires inaliénables ; il s’agit d’un ensemble complet, comprenant, à l’origine, le tombeau du calife ainsi que ceux de ses quatre femmes, mais également une bibliothèque ; au premier étage, une école coranique. La rue évoque une scène de la vie quotidienne avec les habitants du Caire occupés à discuter, menant par la bride ou montant des ânes, les chevaux étant réservés aux dignitaires de l’État.
Les marchés du Caire, comme tous les marchés de l’Orient, sont regroupés en quartiers spécialisés en un seul type d’activité. Le marché des soiries, où l’on vend des damas est ici abrité des ardeurs du soleil par une couverture en bois et en spathes de palmier. Les éventaires sont ouverts, les uns abrités, les autres sur des banquettes en pierre, quand les autres ne se sont pas déployés au milieu de la rue. De part et d’autre de la petite place s’ouvrent deux mosquées. A droite, deux personnages s’apprêtent à grimper la volée de marche tandis qu’au bas se tient assis un marchand de babouches.
On ne peut guère trouver plus animée que la rue du quartier du Mouristan où se bousculent pêle-mêle chameliers, hommes montés sur des ânes, porteurs d’eau, femmes voilées et toute une foule de personnages appartenant à diverses classes sociales, tandis que de part et d’autre de la rue les échoppes, surmontées de moucharabieh, sont directement ouvertes sur la rue afin d’attirer les chalands. Les boutiquiers, fumant leur chibouk, sont assis à l’entrée. Derrière les jalousies des moucharabieh, les femmes peuvent ainsi prendre part à la vie de quartier, cachées aux regards des passants. Au loin, dans l’enfilade, Roberts représente le minaret de la mosquée du Mouristan, c’est-à-dire celle adjointe à l’hôpital (mouristan) construit par le sultan El-Mansoûr Qalâoûn en 1284 et achevé par En-Nasîr, son fils, en 1293. Roberts se plaindra de cette agitation perpétuelle dans la mesure où “ ces rues étroites et populeuses rendent le dessin très difficile ”.
Le panorama de la ville du Caire vu en direction du sud passera encore longtemps comme l’image qui, mieux que la photographie, immortalise la ville du Caire enserrée dans son enceinte médiévale. Tendus vers le nord, les aérateurs (molkâfs) sont destinés à happer le moindre souffle d’air afin de ventiler les maisons dont il est difficile d’évacuer la touffeur des mois de mai jusqu’à octobre. Au moment où Roberts y séjourne, le Caire compte trois-cents mille habitants, vivant dans une atmosphère chaude et humide pendant l’été, battue par les vents l’hiver, submergée par la poussière du désert au printemps, pendant le khamsîn qui drappe la ville d’un fin nuage provenant du Moqqâtam. Sur les hauteurs du Caire, à peu près à l’endroit où Roberts se tient pour peindre, le corps expéditionnaire français avait implanté ses moulins afin qu’ils pussent profiter des moindres mouvements de l’air. En 1838, le Caire n’a encore rien perdu de son charme oriental et ses bazars bigarrés, qui font sa célébrité, entraînent les Européens à venir y faire une visite. Monuments décrépis et lépreux, édifices récemment construits se juxtaposent sans que l’on prenne soin ni de réparer ni de détruire ; tandis que de nouveaux quartiers s’élèvent, d’autres sombrent lentement en ruines et déterminent des zones de terrains vagues emplis de décombres. Seuls émergent les minarets des quatre cents mosquées qui, à différentes heures du jour, font entendre, parfois avec un décalage, le long appel du muezzin. A gauche, Roberts évoque la citadelle, perdue dans la brume, ainsi que la silhouette des principaux monuments qu’il a par ailleurs reproduits : la mosquée de Qaïtbai au premier plan, à peu de distance de la muraille construite par Saladin et tant de fois restaurée, celle du sultan Hassan au loin, et, séparées de la ville par la marque horizontale argentée du Nil, les pyramides de Gîza, réminiscence d’un temps lointain, et dont les pierres des tombeaux qui les environnent ont laissé leur empreinte, ça et là, dans les murs de Saladin. Voir et être vu. Fidèle à son habitude, Roberts campe une autre dans le sens inverse regardant en direction de la citadelle ; il évoquera, comme convenu dans son programme, les tombeaux des Mamemouks.
Son tour d’horizon égyptien ne s’arrête pas aux seuls monuments. La vie nocturne l’intéresse tout autant. Cédant à l’imagerie orientale, il reproduit deux danseuses et un groupe de musiciens. Accompagnées de deux joueurs d’un instrument à archet, le kamanga âgoûz, et d’une femme frappant sur un tambourin, deux danseuses, les reins ceints d’un mouchoir, interprètent des danses traditionnelles. Les figures, dans le cas présent, n’ont rien à voir avec celles des almées, éloignées du Caire par le Pacha d’Égypte, Méhémet ‘Alî, et qui ont fait fantasmer des générations d’Européens sur les rives du Nil, et dont certains ont reconnu qu’il s’agissait d’un spectacle assez vulgaire. Les danseuses présentent cependant les caractéristiques assez comparables à celles des almées, car elles portent sur elles, accrochées à leurs cheveux ou réunies autour de leur cou, leurs principales richesses. Il était en effet de tradition en Égypte de taxer ces danseuses sur ce qu’elles ne pouvaient porter sur elle. Le talent se jugeait au nombre de piécettes d’or et aux médailles qu’elles portaient sur elles. Il est certain que Roberts n’a pu résister à la tentation de reproduire une des scènes qui font partie des spectacles qu’appréciait la population cairote, très encline à assister à des saynètes, à des pièces de théâtre — introduit avec l’Expédition d’Égypte —, à des danses ou à l’audition d’une musique des instruments traditionnels et dont les planches de l’Expédition d’Égypte communiquent les différents modèles.
Mais le voyage en Égypte n’est pas pour autant terminé puisque David Roberts est amené, lors de son périple en Terre Sainte, à côtoyer à plusieurs reprises le génie pharaonique en empruntant le trajet qui le mène à Sainte-Catherine du Sinaï. Après avoir passé le mois de janvier à compléter les dessins effectués au Caire, il prend le départ le 29 janvier, certain de revenir en Angleterre avec “ les carnets de dessin les plus riches jamais venus d’Orient ”, et, ajoute-t-il, “ le jeu en vaut la chandelle ” (J. 29 janv.) Il est, le 10 janvier à Suez, le 12 février aux Sources de Moïse. Le 16 février, il entreprend l’ascension du plateau qui le mène au site splendide de Sérabit el-Khadem, où se dresse le temple d’Hathor, dame de la turquoise, ce qui ne va pas sans provoquer l’émerveillement de la part de Roberts qui n’imaginait pas trouver dans ces solitudes arides et battues par les vents un édifice pharaonique : “ Finalement nous atteignons le sommet et, à ma grande surprise, au lieu des quelques pierres que je m’attendais à trouver, je découvre un temple égyptien ” (J. 16 fév.1839). Après le périple qui le mène de Sainte-Catherine en Jordanie, en Palestine et en Syrie, il rembarque le 13 mai de Palestine pour Alexandrie. Son séjour est l’occasion d’être présenté à Méhémet ‘Alî par le consul général d’Angleterre, Patrick Campbell. Cette rencontre est immortalisée par une vue ouvrant sur la rade d’Alexandrie et permettant d’apercevoir au loin les navires de la flotte du Pacha faisant relâche ; elle met en scène l’entrevue du 12 mai 1839 accordée par Méhémet ‘Alî, Pacha d’Égypte, vêtu du costume traditionnel albanais, au consul-général britannique en Égypte, le colonel Patrick Campbell (1779-1857). Ce dernier présente au Pacha un projet de route internationale passant par l’isthme de Suez, rédigé par un jeune lieutenant, Thomas Waghorn, assis à sa gauche. David Roberts, en gants gris et tenant son chapeau à la main, s’est représenté, assistant à ce moment historique. Sa présence tient au fait que lui et Patrick Campbell sont des compatriotes, tous les deux étant d’origine écossaise. Un scribe consigne l’entretien, tandis que derrière la silhouette du Pacha, qui fume le narguilé, se tient le fameux Boghos Youssef bey (1768-1844), arménien d’origine, et interprète privé du Pacha. C’est lui qui, entre 1817 et 1844, avait la haute main sur les firman délivrés à ceux qui voulaient accomplir des fouilles en Égypte et en prélever des antiquités. Le groupe qui correspond à de lourdes tentures rouges qui caractérisent Méhémet ‘Alî et son groupe, dans l’ombre, tranche d’avec les Britanniques placés sous la baie, en pleine lumière, tandis que deux serviteurs en costume albanais s’avancent de la droite pour servir le café. Roberts est en effet revenu à Alexandrie avant de s’en retourner vers l’Europe ; l’entrevue lui permettra de modifier légèrement le jugement qu’il avait émis sur le Pacha lors de sa rencontre sur le Nil. L’analyse que Roberts trace de la politique de Méhémet ‘Alî est exempte d’aménité. Le peintre souligne les défauts d’un état sacrifiant le bonheur de ses sujets au profit d’une modernisation dont le but est l’entretien de la flotte et de l’armée, dans la perspective de se rendre indépendant de la Porte.
On sait qu’à l’entretien assistaient également des personnes distinguées comme Linant de Bellefond — qui rédigea un projet de percement du canal de Suez —, le Vén. Henry Tattam (1789-1868), spécialiste des manuscrits coptes. La vue semble manquer de naturel. Roberts, qui n’avait pas son matériel sur lui, a retracé la scène de mémoire. La route imaginée par Waghorn vit le jour entre le Caire et Suez, marquée par sept étapes. Cette route, avant que naquit le canal de Suez, permettait de relier la mer Rouge au Caire puis, plus tard, de gagner Alexandrie par la voie de chemin de fer, construite en 1853. Roberts est ainsi témoin d’un des principaux épisodes de la lutte diplomatique qui opposa les partisans du chemin de fer (projet anglais) et ceux du percement de l’isthme proposé par la France.Les conditions de soldat sont tellement rudes, qu’afin d’éviter d’être versés dans l’armée, les hommes préféraient se couper les doigts ou s’énucléer à l’aide de mort aux rats ; certains, sachant que les Coptes n’étaient pas requis pour le service militaire, allaient même jusqu’à se faire tatouer une croix sur le bras.




